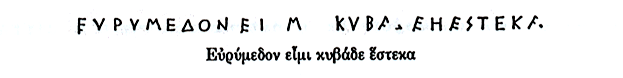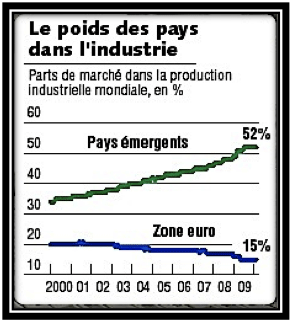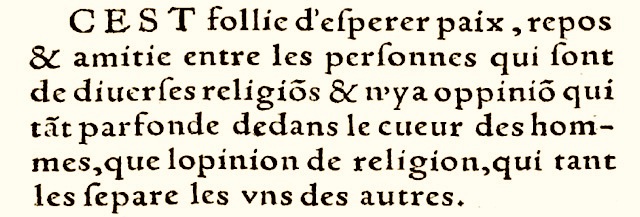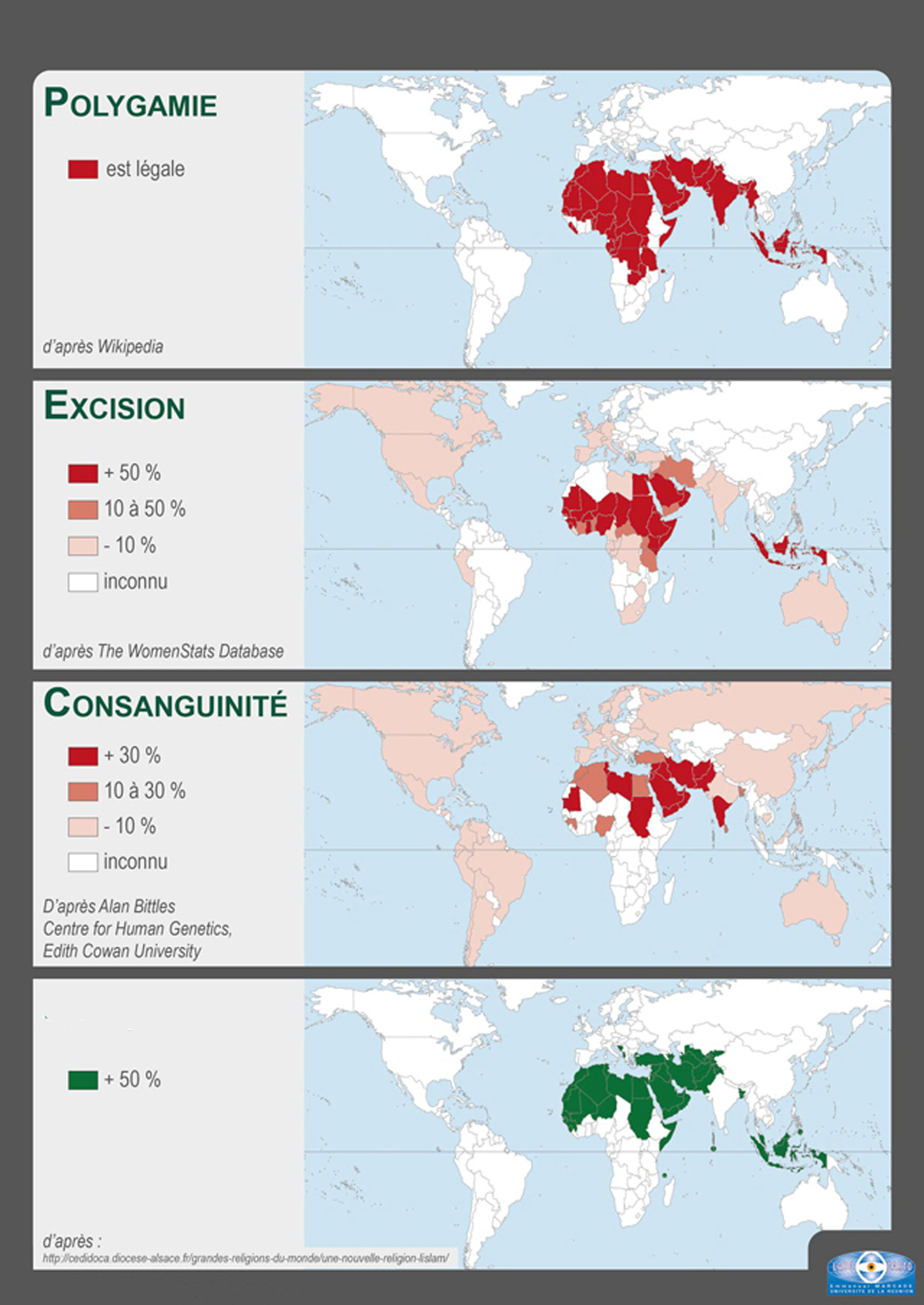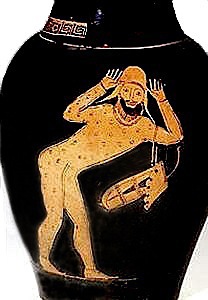|
Chapitre 19
La reconnaissance de la forme humaine :
figures de l'altérité, de la morale et du droit
(les "trente glorieuses" et les trente pleureuses)
"L'âme à l'état originel est prête à recevoir n'importe quelle influence, bonne ou mauvaise.
Comme le dit Mohammed, le Prophète : 'Tout enfant naît à l'état naturel.
Ce sont ses parents qui font de lui, un Juif, un Chrétien ou un Mazdéen'."
Ibn Khaldun
(1332-1406)
(Discours sur l'histoire universelle)
"L'humanité est une, et tous les hommes sont semblables en ce qui concerne leur création
et toutes leurs dispositions naturelles ; personne ne naît éclairé."
Bartolomé de Las Casas
(1484-1566)
(Second Mémoire à Charles-Quint)
Thème :
Existe-t-il un universel de moralité ?
De la colonisation au multiculturalisme, avatars de la territorialité…
En scannant la quotidienneté des années 80 (réfractée dans le prisme des médias), on peut voir à l’œuvre, révélé par la confrontation des forces qui travaillent les sociétés libérales, un processus qui met en évidence le conflit de la territorialité et de la moralité – précipité du « choc des civilisations » qui alimente la quotidienneté d'aujourd'hui. La cohabitation au sein de la société industrielle de populations culturellement dissemblables pose la question de leur devenir commun : assimilation (à la société d'accueil) ou entretien des différences originelles quand la revendication identitaire entend légitimer des juridictions séparées.
L’expansion européenne, avec la rencontre d’autres civilisations et d’autres hommes, a des causes et des conséquences démographiques et économiques. L’Europe de la Découverte a mis en place un réseau d'échanges et une déportation d'hommes qui sont à l'origine de ce qu'il est convenu d'appeler le « développement ». « Sans esclavage, argumente Marx, vous n’avez pas de coton, sans coton vous n’avez pas d’industrie moderne. C’est l’esclavage qui a donné la valeur aux colonies, ce sont les colonies qui ont créé le commerce du monde, c’est le commerce du monde qui est la condition nécessaire de la grande industrie mécanique » (lettre à Annenkov, 28 décembre 1846, Marx, K., Œuvres, Économie, 1, Paris : Gallimard, 1965, p. 1441). Deux siècles après l’abolition de l’esclavage, l'Europe va importer de ses colonies ou de ses zones d’influence une main-d’œuvre qui contribuera substantiellement à la prospérité de ce que l’on a dénommé, en France, les « Trente glorieuses ». Au-delà de leurs traits communs, ces deux procédures de mise en œuvre de la force de travail, travail servile et travail immigré, portent des conséquences culturelles spécifiques :
- L’esclave est créolisé ; pour en faire un outil dans un procès de production qui n’est pas le sien, la plantation lui dénie toute autonomie matérielle et culturelle (l’esclave qui vient d’être déporté est dit bossale, incapable de parler, comme s’il portait une muselière, bozal) ; la seule justice possible pour ses descendants est la réparation, c’est-à-dire, paradoxalement, alors que son altérité est stigmatisée, l’assimilation (aux valeurs de la société qui l’a déporté).
- L’immigré, mobilisé pour sa force de travail, garde sa culture, produit d’une autre écologie. Pris dans un procès de production dont il est, lui aussi, un acteur passif, il s’adapte par nécessité à ces conditions matérielles et se ressource à ses origines pour exister, son indentité culturelle étant indifférente à son employeur. La formule classique « Ce que le grand-père veut oublier, le petit-fils veut l’apprendre » caractérise sans doute ce que l’on a dénommé les hyphenated identities, mais ouvre aussi à une autre contradiction, dont résulte le multiculturalisme : la cohabitation d’hommes qui partagent un lieu de vie commun et entretiennent des allégeances contraires.
On rappellera ici le jugement porté en 1822 par Auguste Billiard, à propos de l'esclavage à l’île de La Réunion, pour mesurer sa pertinence à cette autre contradiction de la division du travail qu’est l’exploitation du travail immigré: "Qu'il suffise d'observer que créer une colonie avec la servitude, c'est vouloir bâtir sur le principe de sa prochaine destruction" (Voyage aux colonies orientales, 1822, Paris, Ladvocat, p. 317).
L’histoire officielle, c’est celle qui rend compte de l’activité économique et sociale des pays libéraux, avec son antagoniste : le « monde du travail » – mais aussi la « réaction », soit les diverses formes de conservatisme social, critique des révolutions sociétales associées au libéralisme. L’histoire parallèle, avec son potentiel de ressentiment, c’est celle des laissés pour compte des ruptures économiques, salariés natifs et population immigrée, engagés dans une même régression identitaire qui les découvre opposés (alors qu’ils étaient solidaires dans leur revendication face au « patronat »). Les trois décennies qui succèdent aux Trente glorieuses illustrent, en effet, le revers du « miracle économique » européen, les facteurs du miracle (ses « acteurs passifs ») étant soudain au centre du jeu politique dans un monde en récession. La tourmente économique d’après-guerre, dernier avatar de la « révolution industrielle » et de la « Grande Transformation » selon Polanyi, tirant à soi et consumant les ressources énergétiques, matérielles et immatérielles, a transfiguré l’environnement physique et humain des pays développés. Le « miracle » a, aussi, laissé derrière lui : friches, crassiers, sous-produits, corons, ghettos… C’est sur les ruines d’un monde obslolète et dévasté que doit se faire la recomposition d’hommes tirés de leur isolat par le « développement » et condamnés à cohabiter. Cette France de « deux Français sur trois », « libérale et réconciliée », dont rêvait Giscard en 1984 (Deux Français sur trois, Paris : Flammarion, 1984) va être mise en échec par le délitement économique d’une société néo-libérale et inégalitaire.
Les protagonistes dissemblables de cette même histoire se définissent en fonction de leur proximité et de leur intérêt dans le procès de production en cause : - l’entrepreneur demandeur de main-d’œuvre, acteur du déplacement de population en cause et consommateur de sa force de travail ; - l’immigré tiré d’un environnement économique traditionnel, qui entrevoit dans cette migration une amélioration des conditions de vie des siens ; - le « français natif » à divers degrés entraîné dans l'aventure économique en cause, en contact direct ou en compétition avec l’immigré ; - le proche ou le descendant d’immigré quand la crise et le défaut d’intégration font de lui un marginal… Les trois décennies qui succèdent aux « Trente glorieuses » illustrent le revers du « miracle économique » européen, les facteurs du miracle (ses « acteurs passifs », toutes origines confondues) étant soudain au centre du jeu politique.
En se pourvoyant en main-d’œuvre dans les anciennes colonies, le patronat pensait peut-être avoir à traiter avec une « classe ouvrière » conforme aux normes de sa culture. Les grèves de l’automobile de l’hiver 1982-1983 (voir infra) ont montré qu’il pouvait y avoir une interprétation spécifique du syndicalisme chez les travailleurs immigrés. Paris-Match du 17 février 1983 rapporte ainsi que, pour le responsable C.G.C-métallurgie, un syndicalisme « arabe ou immigré [était] en train de naître ». Mais c’est moins son caractère « ethnique » que sa tonalité religieuse qui interpelle alors, le premier ministre, Pierre Mauroy, déclarant : « Nous respectons pour tous les travailleurs la liberté de religion comme la liberté syndicale. Mais il est clair – et je serai intransigeant sur ce sujet – que l'expression religieuse ne peut pas être institutionnalisée dans les entreprises qui sont avant tout des lieux de travail dont la finalité est la production de biens et de services ».
C’est une autre expression de l’immigration (qui ne figure pas dans le calcul de l’économie libérale et que les politiques n’ont pas anticipée) qui va se substituer à ces acteurs, soudain visibles, d’une « production de biens et de services » en crise : du début des années 80, ici considérées, aux années 2000, l’économie française perdra deux millions d’emplois industriels. Elle ne partage qu’une chose avec l’immigration des Trente glorieuses : une identité différentielle dont la discordance et le dissentiment sont accusés par l’absence de raison sociale justifiant sa présence en terre étrangère. Chômage, marginalité, ségrégation urbaine… assignent à cette immigration surérogatoire un parcours de vie où la protestation d’existence est en effet vécue comme une protestation d’identité et où la religion, privée ou prosélyte, tient lieu de maîtrise et de territoire.
Avec ce sujet de nature macro-économique (quand on le pose en termes d’utilité) se met naturellement en place un questionnement sur le processus de reconnaissance du semblable et sur les fondements de la morale. Cette confrontation à la différence culturelle et à ses droits fait en effet apparaître les motions d’ouverture et de fermeture chez les acteurs concernés, exposant la genèse des évidences identitaires. A partir des données factuelles en cause, peuvent donc être examinés les scénarios culturels qui engramment la reconnaissance ou le refus de l’autre. L’exposé de l’environnement socio-économique et de son évolution dans les années 80 montre comment le droit au sol contraint l’exercice de la reconnaissance du semblable et comment l'élargissement de la moralité procède de processus naturels associés à la juvénilité. En rappelant, à l’aide d’observations sommaires, comment la reconnaissance s’opère dans le vivier d’une génération, cette génération qu’on a parfois appelée la « génération morale », il est en effet possible de mettre en évidence les processus en cause et de fonder la morale en faisant l’économie de la morale.
On commencera par la prise en compte d’un registre subalterne de cette confrontation de la morale et du territoire (conflit de territorialité), quand l’idiome de la dominance sexuelle est mobilisé pour en exprimer les enjeux. Inattendue quand on disserte de la morale, la prise en compte d’exemples « inappropriés », graffiti racistes ou arguments xénophobes, fait partie de l’instruction. Dans l’écume de la quotidienneté s’expriment ainsi, ajustés à l’environnement socio-économique, les fondamentaux de l’humanité, faisant apparaître la « modernité » dans sa signification historique. Un intérêt de ce « balayage » est de situer les valeurs de l’extrême-droite, soit l’envers moral de la modernité libérale, dans le spectre des stratégies politiques partageant le même soubassement culturel. Aussi antinomiques soient-ils, libéralisme et fascisme procèdent de la même histoire et se réclament des mêmes valeurs historiques. Comprendre que les crimes contre l’humanité sont des crimes de l’humanité, comme il a été rappelé, c’est aussi comprendre, spécifiquement, comment ils procèdent de l’histoire européenne et d'une réquisition du droit au sol. Le propos est aussi, symétriquement, d'appréhender comment les attendus du territorialisme peuvent prospérer dans les populations stigmatisées.
Révélés et réactivés par la crise économique de la société française des années quatre-vingt, les fondamentaux du droit au sol s’expriment dans une idéologie qui crédite ceux qui se réclament du fait d’être « déjà là », d'un empire juridique et politique sur ceux qui arrivent, constituant une communauté naturelle où la biologie se conforte de culture. Il n’échappe pas que, dans la gradation des engagements souvent réaffirmée par J.-M. Le Pen : « J'aime mieux mes filles que mes nièces, mes nièces que mes cousines, mes cousines que mes voisines, etc. »... (le 28 janvier 1988 à « L’heure de vérité » sur Antenne 2) on peut reconnaître à la fois l'axiomatique de la sélection de parentèle théorisée par la sociobiologie : (Hamilton, W. D., « The genetical evolution of social behaviour », Journal of Theoretical Biology, 1964, 7, 1-52.) et les choix sociaux du système de parenté dit descriptif («…The true family in its modern acception » selon Lewis Morgan, 1871, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family : Smithsonian Contributions to Knowledge, vol. XVII, Washington, p. 492, par opposition aux systèmes classificatoires) propre aux sociétés eurasiatiques. Ce « choix de société », cette « hiérarchie des sentiments et des dilections » comme dit J.-M. Le Pen (Radio Le Pen, 2 mars 1984) c’est l’épure des sociétés stratifiées. De surcroît à cette revendication, est posée une inégalité entre les hommes dite « ethnologique » par J.-M. Le Pen : « J'établis bien sûr une distinction à la fois entre les êtres, les peuples et les nations […] Je ne peux pas dire que les Bantous ont les mêmes aptitudes ethnologiques que les Californiens, parce que cela est tout simplement contraire à la réalité » (Les Français d’abord, Paris : Carrère-Lafont, 1984, p. 168). L’objet de cette proclamation des fondamentaux se veut défensif : protéger l’ « indigène » qu’est devenu le français d’un « retour de colonisation » non maîtrisé.
L’universalisme est nourri par la croyance que l’expansion des valeurs de l’Occident a pour conséquence le bonheur de tous les peuples… La poussée des extrême-droites exprime non pas le délitement de cette croyance, mais le reflux de cette expansion. La décolonisation et l’immigration postcoloniale ont importé au sein des nations colonisatrices une altérité autrefois caractéristique du « dehors ». Synonyme de souveraineté, i. e. doté de la capacité d’objectiver les autres, « être blanc » c’était être élevé dans l’évidence d’une position de domination et d’éducation, et, banalement, ne pas avoir à se poser la question de sa propre couleur. La postulation de l’égalité de tous les hommes, théorisée et exportée par l’homme blanc a été le support, pratique et théorique, du « développement ». Puisque tous les hommes sont égaux et que le monde est fini, tous sont justiciables de l’échange. Vue sous cet angle, la lutte pour l’émancipation et l’égalité des droits est inséparable de l’expansion européenne. « Toute la terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations, relève Paul Valéry en 1931 […] Plus de roc qui ne porte un drapeau ; plus de vides sur la carte ; plus de région hors des douanes et hors des lois ; plus une tribu dont les affaires n’engendrent quelque dossier et ne dépendent, par les maléfices de l’écriture, de divers humanistes lointains dans leurs bureaux. Le temps du monde fini commence » (Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, Paris : Stock, 1931, p. 35). Le Blanc monopolise ainsi, ingénument et naturellement, la leçon d’humanité et sa juste cause…
La bonne conscience des politiques et des écrivains de la colonisation a été nourrie par un délire pseudo-scientifique expliquant le plus souvent l’expansion européenne et justifiant sa mission civilisatrice par la supériorité de la « race blanche ». « Le noir pur sang, écrivent par exemple les réunionnais Marius et Ary Leblond, auteurs du Miracle de la race (1914), accepte simplement, passivement, et presque religieusement, la domination du blanc qu’il sent supérieur, ou bien il la repousse sauvagement, comme quelque chose d’impur ou de démoniaque » (« La rivalité des races blanche et noire dans les pays de domination française », Mercure de France, IV, 1900, p. 90-91). Cette évidence de suprématie, qui dispense un groupe d’hommes d’avoir à répondre de son aséité, trahit une réalité historique qui est contingente et transitoire. En appeler à sa couleur, c’est signer son exception à cette évidence et, en l’espèce, désespérer de la capacité de la « civilisation » à rayonner. Le Blanc qui se compare, en effet, manifeste son propre désarrroi (il apparaît alors que le « Blanc » est de différentes couleurs – et tout sauf blanc – ce qui montre que la « blancheur » n’est pas une désignation chromatique mais qu’elle procède d’une définition négative : la couleur est l’attribut du « non-Blanc », celui qui applique le nuancier étant non assignable, « blanc »). Objectivé, passé à l’épreuve du particularisme, le « Blanc », « Français d’abord », « enraciné », est un « indigène » comme les autres et en réclame le statut. Cet indigène, découvert en plein cœur de la civilisation, est un Blanc privé de sa quiddité et de son histoire : assignable.
Ainsi quand « blanc » devient à son tour une couleur assignable, détachée de sa pseudo valeur chromatique, comme on peut le voir dans les délibérés des procès intentés par ceux qui se déclarent victimes de racisme « anti-blanc ». Entre autres : en septembre 2018, le parquet de Paris ouvre une enquête pour « provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit », suite à la diffusion du clip d'un rappeur dans lequel il appelle à « pendre les Blancs ». Le rappeur justifie ainsi des paroles qui défient la citation : « J'envoie un message d’unité et d'identité noire. L'homme noir à des capacités intellectuelles et physiques comme n'importe quel être humain. Nous sommes tous des êtres extraordinaires ». « Blanc » est alors visé en tant qu’héritier d’une tranche d’histoire. Ainsi quand l’UNEF tweete, pendant l’incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019, par sa vice-présidente : « Je m’en fiche de Notre-Dame car je m’en fiche de l’histoire de France », ajoutant : « On s’en balek [= on s’en bat les couilles] objectivement c’est votre délire de petits blancs ». On attribue à cette étudiante un précédent tweet, daté du 29 décembre 2017, ainsi libellé : « On devrait gazer tout (sic) les blancs cette sous race ». L’interprète de ce « gazouillis » étant elle-même chromatiquement (pour qui ratifie le nuancier en cause) « blanche » d’origine marocaine, c’est bien l’histoire qui est visée et « blanc » doit signifier ici, dans ces proclamations de victimes, quelque chose comme « sous-race (engeance) de chrétien-colonialiste » qui macule tout ce qu’elle touche, la « ligne de couleur » étant, en réalité, une ligne de conduite, celle de la déprédation, historique et politique, de la planète. La cause est entendue : « Le nouveau projet collectif des Occidentaux : disparaître sans laisser de trace » titre une tribune du Figaro du 31 décembre 2019, expliquant que, sous couvert de vouloir diminuer son empreinte carbone, l’idée de ne laisser aucune trace de vie a saisi l’homme blanc. Mixte de Jeanne d‘Arc et de Cassandre, la Grande Faucheuse écolo lui assigne en effet le destin de servir de compost à une nature qu’il a dénaturée.
Ce cas de figure, moderne dans son expression, n’est pas sans précédent, au moins formel. L’idéologie de l’extrême-droite exprime une pathologie de la dynamique d’expansion européenne, expansion qui a précisément produit, dans les colonies, une classe d’hommes en situation de marginalité qu’on appelle les « Petits-Blancs ». L’évolution récente des sociétés libérales met en lumière un processus de disqualification sociale que ce rapprochement avec la structure coloniale peut mettre en évidence. Aux colonies comme en métropole, la ligne de conduite de la classe moyenne (ou son équivalent) se conforte de sa distinction avec les « déclassés », ceux qui sont définitivement hors système. Mutatis mutandis, c’est une même relation à trois termes qui se met en place, en métropole cette fois, avec le français dit « de souche », confronté à l’immigré et à l’« establishment » (ce terme étant pris dans son acception populiste, soit l'homologue du « Gros Blanc » aux colonies) et qui n’a que sa couleur à faire valoir pour se distinguer. A Saint-Domingue, le baron Pamphile de Lacroix définit ainsi les « Petits Blancs » : « …hommes sans existence qui fuyaient quelquefois l’Europe pour des crimes, et qui, grâce à leur épiderme blanc étaient étonnés de retrouver sous le ciel des Antilles la considération qu’ils ne méritaient plus. La qualification générique de petits blancs désignait tous ces individus. Les noirs avaient pour eux une haine d’instinct ; mais les sang-mêlés, chez qui l’éducation développait le sentiment gradué des convenances avaient pour les petits blancs un mépris raisonné, parce qu’ils les voyaient réellement ce qu’ils étaient, ou des aventuriers cherchant fortune, ou des salariés à gages, et souvent même des hommes dégradés ; ils refusaient d’indignation les égards exigés par les préjugés de la couleur. Alors les petits blancs les réclamaient par des vexations et des outrages » (Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint-Domingue, par le lieutenant-général baron Pamphile de Lacroix, Paris : Pillet aîné, 1819, tome premier, p. 21-22).
Le titre de la couleur est supposé comporter des conséquences sociales qui ne se vérifient évidemment que si son titulaire est engagé dans un processus économique d’exploitation. Or, précisément, le « Petit Blanc » est tout à fait marginal dans ce processus quand il n’est pas lui-même pris dans cette exploitation. Comme il est exposé à propos du peuplement de l’île Bourbon (voir), les « Petits blancs » sont des marginaux économiques. Qualifée de « robinsonnade », leur écologie se rapproche davantage de celle des chasseurs-cueilleurs que de celle des agriculteurs. C’est aussi le portrait que William Bird, deuxième du nom, planteur de Virginie, fondateur de la ville de Richmond dresse des habitants de « Lubberland » (le Pays de cocagne), paradis de l’indolence et de l’abondance sans travail, dans une relation de son voyage dans le sud des Etats-Unis en 1728 (ici cité dans l’édition de William K.Boyd : William Byrd's histories of the dividing line betwixt Virginia and North, Raleigh : The North Carolina Historical Commission, 1929, p. 92).
Surely, écrit-il, there is no place in the World where the Inhabitants live with less Labour than in N Carolina. It approaches nearer to the Description of Lubberland than any other, by the great felicity of the Climate, the easiness of raising Provisions, and the Slothfulness of the People […] To speak the Truth, tis a thorough Aversion to Labor that makes People file off to N Carolina, where Plenty and a Warm Sun confirm them in their Disposition to Laziness for their whole Lives.
Dans un chapitre de son Down in Tennessee and back by way of Richmond, publié en 1864 (New York : Carleton), intitulé « The “poor whites” », James Gilmore décrit dans des termes proches sa rencontre avec les mean whites, « the most wretched specimens of “white trash” [he has] ever seen » (p. 63), qu’il distingue des poor whites à proprement parler et dont il évalue le nombre à moins d’un demi million. Adonnés à l’alccol, voleurs, paresseux, incestueux, nés blancs, mais affichant un blanc douteux : « with skins and hair colored like a tallow candle dipped in tobacco-juice » (p. 184), « tel du suif trempé dans du jus de tabac », culturellement assimilables aux indiens et aux noirs (peau blanche, masques noirs) ces mean whites sont, à l’en croire, un véritable concentré des vices sociaux : : They are indolent, shiftless, and thieving ; given to whiskey-drinking, snuff-dipping, clay-eating, and all manner of social vices. Brothers intermarry with sisters, fathers cohabit with daughters, and husbands sell, or barter away, their wives, as freely as they would their hounds, or as the planter would his slaves » (p. 184).
L’apellation Poor white trash (déchet blanc) née dans le sud esclavagiste ('Leff him gwo hisseff; Jule 'tends on gemmen: he doan't 'tend on no poo' white trash — he doan't, lit-on dans le parler du sud restitué par Gilmore - op. cit., p. 106) qualifie, dès lors qu’elle renonce au travail, la déchéance d’une population racialement destinée à prospérer : The great mass of poor whites, as I have said, are a very different people. The poor white man labors, the mean white man does not labor ; and labor marks the distinction between them (p. 189). Proféré par un Noir, ce qualificatif, poo' white trash, souligne l'incongruité, dans le monde de la plantation, du Blanc dénué de la capacité d’asservir, de fait hors système. Nowhere but in the Slave States is there a class of whites so ignorant and so degraded as are these people (p. 188), note Gilmore et, comme l’exprime un titre d’Eugene D. Genovese : dans ce milieu, Rather Be a Nigger than a Poor White Man (« Rather Be a Nigger than a Poor White Man : Slave Perceptions of Southern Yeomen and Poor Whites », Éd. Hans L. Trefousse. Toward a New View of America : Essays in Honor of Arthur C. Cole. New York : Burt Franklin & Co, 1977).
C’est donc bien dans un monde vidé de son sens ou en déplétion, quand celui qui n’est pas en mesure d’occuper la place que lui assigne l’histoire entend se manifester et rester dans le jeu, que se révèle la sauvegarde de dernier recours : le préjugé de couleur. S’il ajoute évidemment le droit du premier occupant au titre du « Petit Blanc » des colonies, le « Petit Blanc » de métropole s’en distingue aussi de multiples façons. Ce qui est significatif, c’est la relation à trois termes qui se met en place dans ces configurations, l’autochtonie répliquant ici la couleur. La crise économique qui frappe les sociétés libérales renvoyant en périphérie partie de ceux qui croyaient au travail et à l’ascension sociale, ils sont de plus en plus nombreux, membres de la classe moyenne ou de la classe ouvrière, à se reconnaître dans le discours d’exclusion du Front national. Hier infréquentable, associé aux marges sociales et à une caricature de l’autorité, le Front national, « dédiabolisé », devient « respectable ». Cet apparent glissement vers le centre correspond, non pas à une évolution de ses valeurs, mais au glissement de fait de l’électorat modéré vers les extrêmes – extrêmes qui deviennent du coup, au moins statistiquement, avec ses tribuns, de recours sinon « respectables ». S'identifiant aux valeurs dominantes et perdant pied, les gens « respectables » se trouvent de fait entraînés vers un illusoire « retour aux fondamentaux » qui fait l'économie de deux siècles d'histoire. Le caractère chimérique et réactant de ce retour en arrière est patent : le « petit Blanc » d'aujourd'hui est évidemment ce que le système libéral a fait de lui, chez lui (et non plus l'aventurier déclassé parti à la conquête du monde). Ce qui apparaît clairement quand on voit sur la brèche de cette défense des valeurs chrétiennes, purs produits du monde petit-bourgeois par quoi l'Occident, en effet, se singularise par rapport aux « autres », les leaders ou les porte-paroles des communautés homosexuelles. Expression et pointe avancée de l'éducation libérale, stigmatisé par l'invasion des « sauvages » (en 2011, un mouvement homosexuel projette de faire défiler une gay pride dans le quartier musulman de Londres en réponse à l'apparition d'affichettes proclamant une « Gay free zone » sous l'invocation d'Allah), l'« homo-nationaliste » réinvente le racialisme en défense de sa singularité, renversant l'éthotype sexuel de la dominance coloniale en donnant son exception culturelle, étendard adventice – mais symbolique – du libéralisme et dernier avatar du suprémacisme blanc, pour programme politique.
L’approfondissement objectif de la crise (près de 50 % des jeunes non diplômés au chômage en 2015) se mesure à la réalité subjective de cette « dédiabolisation » des extrêmes : quand la parole des évêques dont le sermon commence cette recension (voir infra), adoubant le diable, invité à discuter théologie (M. Le Pen invitée à l'université d'été catholique d'été de Sainte-Baume, le 29 août 2015), se change en gage de respectabilité. Il suffira de marquer pour le présent développement cette formule en vertu de laquelle la perte de la dominance ou de ses symboles enclenche un processus de défense et de réhabilitation à double cible : l’autre, l’inférieur dont le « Petit Blanc » ravale l’identité, le même, le supérieur dont il conteste la sauvegarde des fondamentaux de la civilisation. Dans le discours du « Petit blanc » s’exprime une rétraction du système de dominance, sorte d’invagination de l’histoire, la société se ramassant sur ses formes embryonnaires (ou collatérales). Fondamentalement, les valeurs de la droite libérale et de la droite extrême sont bien les mêmes, mais dans cet état originel où il n’est pas nécessaire d’inféoder l’autre homme à la production des richesses, comme si les européens n’étaient pas sortis de l’« enclos de l’Europe ».
Un rapport de l’OCDE d’avril 2019, intitulé : Under Pressure : the Squeezed Middle Class
(OECD, 2019, Paris : OECD Publishing)
Le rapport définit comme appartenant à la classe moyenne les foyers earning between 75 % and 200 % of the median national income (p. 13) et concerne la période qui va du milieu des années 1980 au milieu des années 2010. Dans l'ensemble de l'OCDE, le revenu global des classes moyennes s'est dégradé par rapport à celui des 10 % les plus riches. Sur trente ans, le revenu médian a progressé trois fois moins vite que le revenu des 10 % les plus riches. « Du milieu des années 1980 au milieu des années 2010, tous pays de l’OCDE confondus, la proportion de foyers de classe moyenne est passée de 64 % à 61 % » (p. 19). Aujourd’hui, deux salaires sont nécessaires pour faire partie de la classe moyenne, et l’un des deux doit être très qualifié (p. 27). L’augmentation constante des prix pour l’habitat, pour la santé et pour les services explique que « plus d’un cinquième des foyers de la classe moyenne dépense plus qu’il ne gagne » (p. 13). Ce groupe social, like a boat in rocky waters (p. 13), se sent vulnérable : 40 % de ses membres estiment ne pas pouvoir faire face à une augmentation soudaine de leurs dépenses ou à une chute de revenus. Cette inquiétude sociale s’exprime intimement dans la crainte pour l’avenir des enfants : 60 % des parents (70 % en France) pensent que leurs enfants ne préserveront pas leur statut social (p. 26). De fait, 70 % of the baby boomers were part of the middle class in their twenties, compared with 60 % of the millenials (p. 13). En France, la moitié des pauvres (moins de 50 % du revenu moyen) a moins de 30 ans (10 % plus de 60 ans). Informatisation, robotisation, globalisation ont changé les données du marché du travail. « Le rêve de la classe moyenne reste de plus en plus un rêve pour beaucoup »… La charge fiscale qui pèse sur les revenus du travail étant plus élevée de près de 13 points en France (par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE : Les impôts sur les salaires 2019, Paris : Éditions OCDE), cette performance prédestine la classe moyenne en cause à devenir la chambre d’écho de cette frustration politique.
Dans le discours du « petit blanc » s’exprime une rétraction du système de dominance, sorte d’invagination de l’histoire, la société se ramassant sur ses formes imaginaires ou virtuelles. Anthropologiquement, les valeurs de la droite libérale et de la droite extrême sont bien les mêmes, mais dans cet état originel où il n’est pas nécessaire d’inféoder l’autre homme à la production des richesses, comme si les européens n’étaient pas sortis de l’« enclos de l’Europe » et comme si cette expansion colonisatrice n’avait pas fondamentalement transformé le droit. La partie se joue ailleurs, on le sait : non dans le repli identitaire, mais dans l’internationalisation des acteurs et des capitaux. C’était la question posée par Paul Valéry en 1919 : « L’Europe deviendra-t-elle ce qu’elle est en réalité, c’est-à-dire : un petit cap du continent asiatique, ou bien l’Europe restera-t-elle ce qu’elle paraît, c’est-à-dire : la partie précieuse de l’univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d’un vaste corps ? » (« La crise de l’esprit », 1919, in Variétés, Paris : Gallimard, 1957, p. 995). Après s’être répandu sur le globe, l’homme blanc découvre donc qu’il n’est pas seul au monde quand sa superbe, soumise à la concurrence, est défaite par la « couleur ». Concurrence symbolique en sport, morale et matérielle en économie. L’émule passe le maître. La mise en œuvre des valeurs et du mode d’être occidental dans les colonies ou les zones d’influence se veut « civilisatrice ». A l’idéal-type du pionnier décrit par Tocqueville (voir supra) : un homme solitaire voué au labeur du défrichement qui prend racine dans un pays vierge (« Cet homme inconnu est le représentant d'une race à laquelle l'avenir du Nouveau Monde appartient, race inquiète, raisonnante et aventureuse qui fait froidement ce que l'ardeur seule des passions explique ») succède celui de l’instructeur éclairé, voire du lettré à l’écoute. Les années 30, avec les épopées type « Croisière Jaune » à la gloire de l’automobile, ouvrent aussi un épisode d’ethnographie. Dans le style de la « Croisière Noire » (Colomb-Béchar -Tananarive, 1924-1925), la mission Dakar-Djibouti (1931-1933), dirigée par l’ethnologue Marcel Griaule, collecte ainsi pour un idéal musée de l’Homme conçu par la métropole colonisatrice. Ressources culturelles, en l’espèce, mais aussi naturelles, si les populations noires, enrôlées dans les conflits des européens et leurs aventures coloniales, après avoir démontré leur valeur militaire peuvent aussi briller dans les compétitions sportives. Les exploits de l’afro-américain Jesse Owens, qui obtient quatre médailles d’or aux jeux olympiques de Berlin en 1936 (alors que la délégation française n’a obtenu que 19 médailles – et l’Allemagne 89) sont une révélation. La Fédération Française d’Athlétisme associée au journal L’Auto conçoit, en 1936, une mission de prospection sportive afin d’« étudier sur place les possibilités athlétiques des indigènes de l’Afrique Occidentale Française (A.O.F.) ». Jacques Goddet, directeur du Tour de France (il créera le journal sportif L’Équipe en 1946) justifie : il s’agit de découvrir des athlètes susceptibles de « nous représenter dignement […] en attendant que la race française veuille bien consentir à s’occuper de sa propre santé » (J. Goddet, 1936, cité par cité par Stanislas Frenkiel et David-Claude Kemo Keimbou : « La Mission F.F.A./L’Auto : “Pourquoi négliger nos noirs d’Afrique?”, (3 décembre 1937 – 15 janvier 1938) », Modern and Contemporary France, Volume 18, Issue 1, 2010, p. 37). Maurice Bandeville, un responsable associatif de l’athlétisme, interpelle dans L’Auto deux semaines après la cérémonie de clôture des Jeux : «Pourquoi négliger nos noirs d’Afrique ? ». Il explique que ce « serait […] une erreur de conclure à des qualités particulières chez le nègre américain […] Pourquoi resterions-nous inertes devant l’initiative américaine? […] Les causes de la supériorité physique de la race noire, tout au moins parmi ses éléments les plus sains, doivent être attribués au fait que les indigènes africains sont restés plus près de la nature qu’une autre race : ils n’ont pas subi les effets dégradants d’une civilisation très avancée, suivie d’une longue décadence. Mettons-nous à l’œuvre sans tarder d’un jour, pour figurer plus décemment à Tokyo en 1940 que nous venons de le faire à Berlin » (Bandeville 1936, art. cit., p. 37).
Jacques Goddet, cité plus haut, qui dirigera le Tour de France (de 1936 à1986) dans la tenue chromo du safariste qui chasse le buffle (casque colonial, short et chaussette au-dessus du mollet) pourrait être la figure, dans le monde du sport, de ce type de « meneur d’hommes » qu’était le colon. Lors d’obsèques quasi nationales aux Invalides en décembre 2000, parmi les éloges funèbres, Jacques Chirac salua la mémoire de « l'un des inventeurs du sport français »… Mais le monde du sport change radicalement dans le siècle. Le suprémacisme blanc en matière sportive est bel et bien révolu (e. g. : Taboo: Why Black Athletes Dominate Sports and Why We're Afraid to Talk About It, Jon Entine, New York : Public Affairs, 2000). (Jacques Goddet s’était révélé déjà à contretemps dans un éditorial de L’Équipe où il relevait la suprématie de la race blanche en natation.)

Jacques Goddet, en 1952, du haut de son cabriolet Hotchkiss, voiture de direction du Tour de France
C’est par le biais de confrontations symboliques de type compétition sportive que le paternalisme de l’homme blanc commence, en effet, à se fissurer, quand il apparaît que l’enrôlement nationaliste (ci-dessus) met en scène le conflit racial, refait l’histoire et pose la question des compétences des « races ». Lorsque cette confrontation a pour cadre le « noble art », sa portée est immédiatement politique. La victoire de Jack Johnson, pour le titre de champion du monde des poids lourds, sur le boxeur blanc Jim Jeffries, le 4 juillet 1910 à Reno au Nevada, déclenche des émeutes raciales. Comme l’écrit l’historien Thomas Sowell à la mort de Joe Louis à propos de son combat contre Max Schmeling (1936 et 1938) : How he fared in the ring mattered more to black Americans than the fate of any other athlete in any other sport, before or since. He was all we had (Los Angeles Times du 14 avril 1981).
Dans le champ de la compétition économique, avec des conséquences immédiatement matérielles et pas seulement morales, c’est la concurrence des pays d’Asie qui a le plus sérieusement affecté le sentiment de supériorité de l’homme blanc. Alors que son empire s’est établi sur la religion du travail, le mode de production asiatique a montré les limites du modèle occidental dans la compétition mondiale – qu’on peut résumer d’un mot quand Wu Jianmin, ambassadeur de Chine à Paris de 1998 à 2003, confie : « La Chine a bien ri quand la France a adopté les 35 heures » (loi n° 1998-461 du 13 juin 1998)… La comparaison des parts de marché des pays dits émergents et de la zone euro dans la production industrielle mondiale illustre ce décrochage institutionnel de la compétition économique, supposé rendre la vie plus belle. Entre autres illustrations, celle-ci parue dans les Échos du 16 avril 2010 résume la chute (et la désillusion) des Européens :
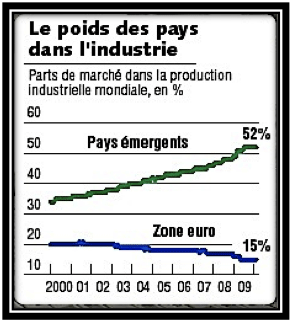
La reprise mondiale, après la crise financière de 2007-2008, a mis en évidence l’écart croissant entre les pays asiatiques et les pays d’Europe de tradition industrielle, qui ont perdu 3,4 millions d’emploi sur la période concernée. En décembre 1995, devant les grévistes de la gare de Lyon en lutte contre la réforme des retraites, le sociologue Pierre Bourdieu déclarait : « Je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent, depuis trois semaines, contre la destruction d'une civilisation […] ». Lui qui sait Ce que parler veut dire (1982) ne croyait pas si bien dire. C’est en effet la fin d’une époque, sinon d’une civilisation, qui se marque avec les luttes syndicales sous l’étendard conservateur de la défense des « droits acquis » (acquis par le système productif des Trente glorieuses). Naturellement mis à mal par la concurrence des pays émergents, en travail, en intelligence, en esprit d’entreprise, les acquis sociaux (la « richesse nationale »), indexés à l’impérialisme économique des pays occidentaux, sont contraints de s’adapter à cette déflation : en 2018, la Chine assurait près de 30 % de la production manufacturière mondiale… L’« homme blanc », qui se distrait de ses déconvenues en dansant sur des musiques exotiques devenues musiques du monde, doit désormais se représenter sur une palette d’humanités dont il n’est qu’une expression – parmi d’autres. Sauf à se prévaloir d’un droit d’exception.
Voici donc, dans les pages qui suivent, assumés, triviaux et répétitifs (répercutés dans la chambre d’écho des mass media et alimentant une sociologie de comptoir), les principes du droit au sol proclamés au sein même des métropoles colonisatrices, alors même que leur hégémonie s’étiole et qu’une nouvelle économie mondiale se met en place. Ils posent que le « droit du premier occupant » qualifie son titulaire d’une suprématie juridique et politique « inaliénable », pour user d’un terme à la charge à la fois juridique et symbolique. Apparenté à la proxémie, le droit au sol, dominance et gestion de l’espace caractéristique des espèces – émotionnel avant d’être rationnel – constitutif de l’habiter (ordinaire : cf. le japonais kore/sore/are, ou sacralisé : cf. le théologème : « L’Arabie saoudite est une mosquée » – voir par ailleurs sur ce site), est ce droit d’exception. La mise en cause, directe ou indirecte, du droit au sol provoque une réaction de défense dont les partis d’extrême-droite donnent une justification à la fois primaire et argumentée. La crise de la nation est manifeste quand ses assujettis, notamment ceux que l’on groupe dans la catégorie de « classe moyenne », adeptes désabusés de la religion du travail (quelque peu discréditée par la loi plus haut citée), vivent comme une spoliation l’émargement des « autres », juridiquement égaux et visiblement différents, à l’« État-providence ». Celui-ci ayant fait de « ceux qui travaillent », par défaut – les élites ayant la ressource, directement ou indirectement, de la mondialisation et des expédients de l’« optimisation fiscale », alors que la classe moyenne, assignée à résidence sous l’œil panoptique de l’administration, est assujettie dans ses frontières – les sujets privilégiés de l’imposition qui supporte l’« assistance » (cette « persécution fiscale » étant un leitmotiv de leurs doléances). Les politiques nationales, mises en œuvre par des dirigeants discrédités – la crise ayant déréalisé la rhétorique politique –, impuissantes à contrôler les effets de la mondialisation, font en effet de ceux qui croient aux « valeurs », si l’on en juge par les manifestations qui se réclament du « pays réel », le principal embarras intérieur.
Manifestation pour l’école libre, contre la loi Savary, en juin 1984 – Le Figaro titrant : « Le 24 juin 1984, le jour où la droite a pris la Bastille » ; manifestation contre le « mariage homosexuel » en janvier 2013 ; jacquerie des « gilets jaunes » contre les « élites », en novembre 2018. Aussi originale qu’imprévue, la révolte des « gilets jaunes » est l’irruption spectaculaire de citoyens qui ont « décroché » et qui se donnent, eux aussi, pour le pays réel. Coïncidant avec le mouvement en cause, le vote pour les européennes de 2019 a vu s’effondrer les trois principaux partis de gouvernement (PR : 8,5 %, PS : 6,2 %, PC : 2,5 %) pour laisser face à face (conformément à la polarisation de l’emploi et des statuts sociaux visée ci-dessus) ceux qui sont « en marche » et ceux qui sont « en marge », qui s’exposent et qui bravent et bloquent le « système » sur les giratoires. Au soir des élections, le porte parole du Rassemblement National déclarait sur France 2 : « C'est une victoire du Rassemblement national [23,3 % des voix]. C'est la victoire des français méprisés, matraqués, insultés par Emmanuel Macron ».
Une étude de l’INSEE de novembre 2017, intitulée « Des cols bleus aux cols blancs : trente ans de mutations de l’emploi » (1982-2014), met en évidence la relation entre la disparition des emplois industriels et l’inflation de l’emploi public. « Depuis 1982, titre le Figaro à la parution de cette étude, les ouvriers ont autant disparu que les fonctionnaires ont augmenté » (de fait, depuis 1968, deux fois moins d'ouvriers et trois fois plus de cadres…) La réponse des gouvernants à cette mutation économique sans retour est en effet l’aggravation de la dette nationale (donc de la pression fiscale) : emplois publics, emplois « aidés », doublons administratifs, fonctionnarisation des métiers de santé… En masquant l’impuissance à résoudre la crise, cette politique en redouble les effets en la faisant porter à « ceux qui travaillent ». A l’inverse, l’appartenance au « système » serait démontrée par la tolérance à toutes les formes d’hétérodoxie, organiquement ou idéologiquement engagées dans la production de la valeur d’échange. La perte de dominance clamée exprime en réalité une inégalité sociologique produite par le développement naturel de la société libérale. L’élite n’est pas affectée, à la différence des acteurs passifs concernés, par les déplacements de populations qu’elle engendre. C’est précisément par là que s’exprime sa dominance territoriale : capacité à déporter une main-d’œuvre et insensibilité aux conséquences. Le « néo-libéralisme » est ainsi le système qui permet aux multinationales, profitant de leur taille et de leur ubiquité, de peser sur les États-nations (optimisation fiscale, chantage à l’emploi…), laissant aux gouvernements en cause la ressource de répercuter cette charge sur ceux qui n’émargent pas à l’aristocratie de la « nouvelle société » – cette fois quasi planétaire – laissés pour compte ou soutiers de la nouvelle chaîne productive.
« Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (1789) :
« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. »
Bien que procédant de la même histoire et des mêmes valeurs fondatrices, ces fortunes contraires rappelent que l’inégalité est constituante des sociétés stratifiées. La célèbre phrase de la préface de la Critique de la raison dialectique (qui est aussi son épitaphe malheureuse) : le marxisme est l’« indépassable philosophie de notre temps » (Paris : Gallimard, 1960, p. 9), ou le jugement d’Emmanuel Lévinas (invité d’un journal télévisé d’Antenne 2) : « Le communisme, c’est la morale ajoutée à la politique », expriment l’impossible égalité des hommes dans une société de ce type. Ainsi donc, si la mondialisation est l’horizon, humain et professionnel, d’homo liberalis – quand il se révèle en mesure de s’approprier tout environnement : « nations », « ethnies », « cultures », variables d’ajustement, font partie de l’entropie du système – ce changement d’échelle, adaptatif et prospectif, condamne l’homme du commun confronté à la différence à ce réflexe de saisie de l’identité, essentiellement réactif et involutif. Ce qui intéresse ici, c’est, au-delà des surévaluations de l’« indigénisme » d’ici et d’ailleurs, avec son chauvinisme ou son intégrisme, ce qui se révèle, sous les formations et les codes de la modernité, d’une réalité primaire qui conditionne les possibilités du vivre ensemble. Cette extrémité – cet extrémisme des « petits blancs » de l’intérieur ou des prophètes d’une terre de promission – d’avoir à ester en civilisation ou en religion pour exister, met en vedette l’aventure de la modernité avec ses conséquences, collatérales mais nécessaires. Symptôme d’une crise de l’économie et de la modernité, sous-produit et choc en retour paradoxal de l’expansion européenne, cette territorialisation du droit, résurgence, inavouable ou dérisoire, mais soudain manifeste, d’une contrainte de l’espèce à laquelle le moderne entend faire exception, la revendication du droit au sol n’est pas insignifiante. Aller « Au Front » ou sonder la condition immigrée, c’est faire l’ethnographie d’un monde non officiel, réfréné ou souterrain, avec l’objet d’en qualifier les lignes de force et la cohérence critique – et de faire apparaître ainsi quelques contraintes et servitudes qui conditionnent le présent.
Exorde
La consultation de la presse des années quatre-vingt qui constitue la source principale du dossier ici présenté (pages 19, 20 et 21) ne confirme pas seulement la mauvaise qualité du papier journal (à la lignine jaunie et oxydée par la lumière, à la texture fragilisée par l'acide de la colophane) : ces traces matérielles d'une actualité si proche et si lointaine permettent aussi de mettre en perspective les questions d'aujourd'hui touchant ce que l'on dénomme le "multiculturalisme". Un point de friction des cultures en contact – il paraît subsidiaire mais il est constitutif – concerne le statut juridique des sexes. Les questionnaires passés aux candidats à l'immigration, qui se résumaient dans les années soixante à un examen médical et anthropométrique, portent aujourd'hui sur des questions du type : Un mari a-t-il le droit de battre sa femme ? Que feriez-vous si votre fils était homosexuel ?... (circulaire du Bade-Wurtenberg, janvier 2006) et révèlent une limite du modèle occidental.
La création au Canada, en Ontario, en octobre 2003, d'un tribunal islamique d'arbitrage institutionnalise cette résistance à la parité en affichant la subordination du droit civil à la religion et cette opposition apparaît crûment quand les gynécologues des hopitaux publics sont récusés ou agressés par des musulmans : "Les gynécologues-obstétriciens hommes devront-ils désormais être protégés par la police pour exercer leur métier ?", demande un communiqué du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, en octobre 2006.
Ils traduisent la suspicion d'une norme désabusée quant à l'efficacité du prosélytisme silencieux de son envahissante réussite matérielle (suspicion d'ailleurs contraire à la liberté de pensée qui constitue le support juridique de sa capacité d'innovation ; vide supra : chapitre 8 : Sur l'innovation) et la découverte, sinon la prise de conscience, que la paix libérale, l'imposition de la paix blanche à la planète, est reçue comme une guerre par les autres civilisations. On fête le 11 septembre, ce towering day, jour monumental de l'Histoire, dans le Londonistan, le Molenbeekistan ou dans la banlieue d'Amsterdam. A priori armées pour recevoir, au prix d'une civilisation du droit et d'une neutralisation de la croyance, toutes les croyances, les sociétés libérales se posent aujourd'hui en inquisitrices des confessions et de l'intime conviction. Alors qu'à l'aube des "trente glorieuses" l'immigration répondait à un problème d'énergétique, on s'inquiète aujourd'hui de culture et de cette singulière permanence des identités, malgré la généralisation des échanges et les migrations des hommes. L'espérance wéberienne d'une modernité caractérisée par la sécularisation de la société et l'uniformisation des civilisations achoppe sur la résistance des cultures à l'assimilation. Un officiel turc a ainsi pu déclarer, à l'intention de la communauté turque installée en Allemagne, que "l'assimilation [était] un crime contre l'humanité".
Michel de L'Hospital,
La harangue faite par Monseigneur de Lospital en la presence du Roy, ledict seigneur tenant ses grans estatz en sa ville d'Orleans, au moys de janvier mil cinq cens soixante et ung
(Paris, 1562, p. 15-18)
Les sociétés dites « développées », fondées sur l’inégalité (le développement étant prosaïquement ce processus qui a pour objet la production de biens et de services et qui mobilise des agents d’exécution sans considération de leur origine et de leur culture, on l’a répété) professent que tous les hommes sont libres et égaux en droit. En réalité indifférentes aux autres, elles se représentent comme les mandataires de la coexistence de toutes les humanités, ses idéologues faisant un préalable de l’égalité de toutes les valeurs (videlicet : toutes les cultures se valent, à condition qu’elles renoncent à être ce qu’elles sont – sauf, circonstance improbable eu égard à l’élision des distances et à la multiplication des échanges, à végéter dans leur isolat). Les sociétés développées sont devenues, de fait, multiculturelles par l’immigration massive d’un prolétariat issu des anciennes colonies et par le développement du commerce et des services. Regroupés par origine ou par confession, les acteurs passifs du développement aspirent, naturellement, à reconstituer dans ce milieu étranger les conditions de leur maîtrise du monde, la religion étant le moyen plus expédient pour ce faire. Quand la religion est une religion familiale, de type culte aux ancêtres, elle relève de l’opposition privé/public, conformément au cadre juridique des sociétés libérales. Il en va autrement quand elle a pour visée de réglementer la vie familiale et civile jusque dans ses aspects publics. Et quand, sur fond d’histoire coloniale, ce « communautarisme » se développe comme une péripétie du « choc des civilisations » qui a marqué, au fil des siècles, l’histoire de l’Europe et du Proche-Orient et que ses zélateurs, mettant en avant des valeurs religieuses et identitaires se prévalent du droit des sociétés d’accueil, les limites philosophiques d’un système convaincu que toutes les croyances se valent et qu’elles peuvent coexister apparaissent crûment. Toutes les cultures se valent, sauf celle qui est en mesure de le dire en désacralisant le rapport de l’homme au monde. Toutes les cultures se valent dans l’œil du cyclone marchand…
La question générique est celle de la capacité d’accueil et de la capacité d’adaptation des partenaires concernés. Si l’on rapproche l’espérance de la période « SOS-Racisme » (rapportée plus haut) et sa désillusion d’aujourd’hui, la chronologie de l’« intégration » fait apparaître un temps de latence auquel les attentats du G.I.A. des années quatre-vingt-dix mettront fin. En effet, et par exemple, malgré l’« épreuve » qu’a été la première guerre du Golfe pour les musulmans français, il n’y a eu aucune mobilisation publique « pro-arabe » (voir : « La citoyenneté à l'épreuve : les musulmans pendant la guerre du Golfe », Dominique Schnapper, Revue française de science politique, 1993, 43-2, pp. 187-208). Fondée sur des sondages, cette étude concernait en réalité des musulmans intégrés à la société française et dont la ligne de conduite était plutôt de ne pas se faire remarquer pendant la durée d’un conflit pouvant mettre en question leur appartenance (et leurs moyens de vie). Malgré la solidarité « arabe » révélée par le conflit (Salem Kacet, Le Nouvel Observateur du 29 janvier 1991), « il n’y eut, au cours de la période, aucune manifestation pour soutenir l’action du gouvernement ou pour s’opposer à elle, ni aucun incident entre populations ou avec les forces de police » (Schnapper, p. 190). Cet optimisme sociologique (c’est cet état des lieux qui justifiera aussi, aux yeux des politiques, le constat de l’inutilité et la décision de suppression du service national, le 1er janvier 1997), était en réalité aveugle au contingent de la population immigrée marginalisée par la société d’accueil. Rétrospectivement, c’est dans les squats des halls d’immeubles et dans les prisons qu’il aurait fallu aussi sonder la « citoyenneté ». La délinquance se révèlera être l’introduction la plus commune au terrorisme. La culture musicale des banlieues en était une première expression avant que l’islamisme en justifie la radicalisation.
« Lutte des classes » et « guerres de religion »
Du milieu du dix-neuvième siècle à la fin du vingtième, la contradiction principale des sociétés développées est l’opposition capital/travail. Elle en résume le mode de production et l’histoire politique, magnifiant la liberté et déclassant le travail servile (comme l’a montré « expérimentalement » – voir supra – la faillite économique du leader sudiste, John C. Calhoun, vice-président des Etats-Unis de 1824 à 1832, maître d’esclaves pour qui le propriétaire de l'usine devait aussi être le propriétaire de sa main-d'œuvre, seul moyen de remédier, selon lui, à la contradiction capital/travail). En cette fin de vingtième siècle, pas un espace qui n’ait été touché par la raison matérielle et qui n’ait été « mondialisé ». Des penseurs proclament alors ingénument la « fin de l’Histoire » de cette humanité convertie à la marchandisation et promise à la démocratie. Mais la structure inégalitaire des sociétés stratifiées relance l’Histoire qui renchérit, en effet, en superposant à l’opposition capital/travail l’opposition Nord/Sud (les actionnaires-citoyens des pays du Nord exploitant et déportant la force de travail et les ressources des pays du Sud). Dans les sociétés d’immigration, la revendication des exploités va (aussi) s’exprimer sous forme d’une résistance qui emprunte ses armes à la religion. Alors que, dans la société mono-culturelle et dans une perspective matérialiste, la religion était interprétée comme un moyen de domination au service des puissants (« l’opium du peuple »), en société multiculturelle, elle revêt une fonction différentialiste et peut devenir, en raison de l’histoire et des conditions sociales, une théologie de la libération.
Des années 1960 aux années 2010, la mondialisation des économies a internationalisé la « lutte des classes » et parachevé la mise en interdépendance des hommes :
- les « capitalistes » sont des sociétés anonymes dont les principaux actionnaires sont des fonds d’investissement à la recherche du meilleur dividende dans l’ensemble des bourses mondiales ;
- le travail d’exécution, dans cette « usine » exponentielle qu’est la planète, est accompli selon un système d’attribution au moins disant qui met la main-d’œuvre planétaire en concurrence ; ce système est idéalement représenté par le « Turc mécanique » de la société américaine Amazon (Amazon Mechanical Turk - MTurk), où les turkers (« travailleurs du clic » – ou « têtes de Turc ») sont mis en compétition selon un protocole de sous-enchère internationale : à qui acceptera l’exécution au moindre prix de la tâche mise à l’encan ;
- le « premier choc pétrolier », en 1973, a mis en évidence le rôle stratégique de l’énergie primaire, dont la transformation et la consommation alimentent l’économie des pays développés ; le contrôle de cette énergie, qui a principalement pour origine le golfe Persique (qui concentre les deux tiers des réserves mondiales de pétrole brut), a motivé les deux guerres, dites du Golfe, et fait du Moyen-Orient l’épicentre de la violence mondiale ;
- le XXIe siècle ouvre sur le constat que si nous n’avons qu’une terre, nous n’avons aussi qu’une seule histoire.
Radicalisme…
Un trait commun de la radicalisation des luttes sociales, c’est sa puissance de séduction sur des jeunes en rupture (on l’a rappelé plus avant). Aux différentes variantes du « matérialisme dialectique » et de la « cause du peuple » (i. e. de la classe ouvrière) des années 70-90 (pour reprendre l’intitulé d’un de ces groupes révolutionnaires) paraissent répondre les différentes expressions du fondamentalisme islamique, embrassées par des jeunes « des banlieues » pour leur ferment rédempteur ou subversif. Quelque trente années après ses propres crimes, un membre d’Action directe se dit admiratif (Le Parisien du 7 mars 2016) devant le « courage » des islamistes qui ont mitraillé des foules paisibles. L’assassinat de Georges Besse en 1986, PDG de la Régie Renault, motivé, selon les termes de la revendication d’Action Directe, par les « dégâts sociaux provoqués par les décisions de licenciements massifs » visait un symbole du capitalisme industriel quand la personne physique du « patron » résumait l’exploitation ouvrière. (Quand les lettres de l’oppression patronale : « BERLIET » [Paul] écrivent le mot « LIBERTÉ » - voir ci-dessus.) Mais la lutte des classes que les « brigades révolutionnaires » entendaient servir s’est mondialisée et la guerre pour le contrôle des ressources énergétiques s’exprime aujourd’hui dans l’opposition Islam/Occident. Dans les banlieues des villes industrielles, des enfants non désirés de l’immigration des « Trente glorieuses », ré-islamisés, font leur le programme « tuer pour être tué ». Rapporté à celui des activistes d’extrême-gauche, le caractère le plus spectaculaire de ce terrorisme, c’est son inspiration religieuse et (si l’on peut dire) sa régression rationnelle : du fanatisme marxiste au fanatisme islamiste. On croyait que la raison matérialiste avait fait le tour de la planète et c’est la superstition qui triomphe… Les pétro-monarchies subventionnent le salafisme qui a converti ces prosélytes et l’État islamique (lorsqu’il avait la main sur les ressources pétrolières d’Irak et de Syrie) les lance contre les mécréants. Avec cette terreur qui se réclame de l’islam, ce n’est pas sa position sociale qui détermine le choix de la cible, mais l’appartenance religieuse – qui recoupe l’opposition géopolitique en cause.
Ce choc des civilisations en société d’immigration est représenté dramatiquement en l'espèce, après la sidération du 11 septembre 2001, par l'assassinat du réalisateur néerlandais Théo van Gogh, en novembre 2004, auteur d'un film inachevé sur l'islam, Submission, qui stigmatise l'oppression des femmes par la religion de Mahomet. Le meurtrier, Mohammed Bouyeri, 26 ans, membre d'une organisation islamiste composée principalement de jeunes néerlandais d'origine maghrébine, déclare avoir agi « au nom de sa religion », enchérissant qu'il referait la même chose s'il venait à être libéré : « J'assume pleinement mes responsabilités. J'ai agi purement au nom de ma religion » ; « Je peux vous assurer que si je venais un jour à être libéré, je referais exactement la même chose, exactement la même chose » (Le Monde du 7/12/2005)… La scène de cet assassinat est d'une particulière boucherie. Bouyeri tire à huit reprises sur van Gogh qui circule à vélo. Alors que van Gogh gît à terre et implore pitié, Bouyeri lui tire plusieurs balles dans la tête et l'égorge comme un mouton, le laissant quasi décapité. Il lui plante ensuite dans la poitrine un couteau dont la lame transperce une liste nominative des cibles de l'organisation, où le nom d'Ayaan Hirsi, députée néerlandaise d'origine somalienne, co-auteur des textes et du scénario de Submission, figure en tête. La publication des « caricatures de Mahomet » dans le quotidien danois Jyllands-Posten le 30/09/2005, en réaction à l'auto-censure provoquée par l'assassinat de Théo van Gogh, déclenche, dans les pays musulmans, protestations diplomatiques, manifestations populaires et appels au boycott, soit l'apologétique qui arme les fanatiques.
La « paix blanche »
L’activisme en cause s’affirme en réaction à l’expansion occidentale. Étendard religieux d'une résistance sociale, politique ou identitaire, il se légitime comme un islam de (re)conquête qui trouve ses armes dans les textes sacrés et dans l'histoire. Il proclame indirectement le reflux du modèle libéral. Pour le dire d’un exemple prosaïque : pour qui a appartenu à la « génération de 1968 », il était possible et banal d’aller en 2 CV de Paris à Katmandou ou de Paris à Tombouctou, destinations autrefois mythiques de l’imaginaire européen. Les pays traversés s’avéraient pacifiques et paraissaient jouer sans problème le jeu du touriste. C’était l’époque où le fils d’ouvrier découvrant la ville africaine était agréablement surpris de s’entendre héler par les petits marchands, à la sortie des supermarchés où s’approvisionnent les expatriés et les fonctionnaires, d’un : « Hé ! patron ! » (exprimant la dépendance historique et « naturelle » des « couleurs »)… En réalité, la « paix blanche » serait une guerre qui ne dit pas son nom. C’est le mot de Sartre à propos de la perception de la Chine par l’Occident : le voyageur est un militaire refroidi.
"A l’origine du pittoresque il y a la guerre et le refus de comprendre l’ennemi : de fait, nos lumières sur l’Asie nous sont venues d’abord de missionnaires irrités et de soldats. Plus tard sont arrivés les voyageurs – commerçants et touristes – qui sont des militaires refroidis : le pillage se nomme « shopping » et les viols se pratiquent onéreusement dans les boutiques spécialisées. Mais l’attitude de principe n’a pas changé : on tue moins souvent les indigènes mais on les méprise en bloc, ce qui est la forme civilisée du massacre ; on goûte l’aristocratique plaisir de compter les séparations. « Je me coupe les cheveux, il natte les siens ; je me sers d’une fourchette, il use de bâtonnets […]" (Préface à D’une Chine à l’autre, par Henri Cartier Bresson et Jean-Paul Sartre, Paris, Ed. Robert Delpire, 1954 ; reproduit dans Situations V, 1964, Paris : Gallimard, p. 7.)
Chez les « infidèles », ces terroristes sont les petits-enfants désœuvrés des soutiers des « Trente glorieuses ». Et il est clair, le court terme étant le principal horizon du capital, que les lendemains n’étaient pas son souci. Le développement des pays occidentaux a ainsi produit une inextricable promiscuité de dominants et de dominés qui échappe au schéma classique de l’exploitation du travail, prenant à défaut la maxime qui voudrait que tous les hommes trouvent naturellement et pacifiquement leur place dans le procès de production. Dans un tout autre registre, en effet, la religion est pour ces enfants surrérogatoires ce que le marxisme était pour les activistes des Brigades Rouges et d'Action Directe, une revanche politique et un moyen d'exister. Avec une supériorité évidente sur les religions agnostiques : celle-ci assure une place au Paradis. Le prêche de prophètes révélés par les conflits du Moyen-Orient a ouvert une terre de promission aux exclus et aux délinquants des banlieues (les prisons étant réputées être une école de radicalisation – alors qu’elles « devraient être » des centre de formation pour pallier, après-coup, à la « totale imprévoyance », selon la formule d’un ministre du Travail en 1982, citée plus haut, de l’immigration des « Trentes glorieuses »). La valeur de mobilisation de l'islam, enrégimentant aujourd'hui le ressentiment que les pays dits du Sud peuvent nourrir envers ceux du Nord, tient à sa puissance de cohésion et au fait que cette religion a historiquement incarné une domination politique et territoriale dont la nostalgie anime ceux qui veulent convertir la planète au Coran. Ce miroir identitaire, aussi anachronique soit-il, arrache les exclus et les dominés à leur condition.
Un « monde fini »
La crise des sociétés multiculturelles se comprend dans l’histoire longue des relations entre l’Occident et le reste du monde, quand le « monde fini » de Valéry (op. cit., 1931) est devenu un monde d’interdépendance (et non plus un monde unilatéral). Le « premier choc pétrolier » (1973) a montré que le « tout pétrole » des économies des pays développés engendrait une dépendance critique envers les pays producteurs, globalement identifiés comme « arabes » (voir supra). Ceux-ci étant eux-mêmes dépendants des économies en cause, où est la contradiction ? Aux yeux de l’opinion, dans l’évidente rupture d’inégalité que constitue cette dépendance. Si l’on en croit la légende d’un dessin de Jacques Faizant paru dans Le Figaro du 4 octobre 1974 (reproduit plus haut), les pays industriels seraient devenus les « colonies » des « Arabes ». Cette dépendance a aussi valeur symbolique dans l’opinion de la communauté immigrée, bien que l’équation sentimentale « pétrole = islam = richesse », si elle manifeste, si l’on peut dire, que l’âge d’or et la domination de l’islam sont toujours d’actualité, soit sans effet sur la condition des soutiers des pays développés. La manne du pétrole enrichit les pays producteurs, conditionne la prospérité des pays industriels, donne du travail à « Billancourt », enfante les bidonvilles, puis les « cités »… Les pays qui vivent de la rente du pétrole rachètent leur luxure en construisant des mosquées. En effet, en auraient-ils l’intention, avec leur « système tribal et arriéré » (selon les termes de l’ayatollah Khamenei, visant l’Arabie Saoudite, en juin 2017), ils ne seraient guère en capacité d’assurer le développement économique et de ravaler la condition des musulmans dépourvus. L’enrichissement en question est une conséquence, fortuite et providentielle, du développement des sociétés industrielles. Il est plus expédient d’entretenir la croyance que de transformer le réel. Pour le sujet qui nous intéresse, une conséquence de cette dépendance qui ravale la superbe des « croisés » est de conforter la croyance et ses expressions.
La Terre de promission des exclus
Quoi qu’il en soit des causes profondes, une cumulation de causes manifestes est invoquée pour expliquer le déchaînement de cette violence : la disqualification sociale, l’appartenance religieuse – celle-ci étant supposée aggraver celle-là –, le nihilisme adolescent (sur le mode des mouvements terroristes années 80 type Bande à Baader ou Action Directe…). La séduction du radicalisme musulman sur des jeunes désœuvrés et sans avenir est évidente. Sur la disqualification sociale, rien, en effet, n’ayant été prévu pour les enfants des immigrés (le cahier des charges des Trente glorieuses se résumait, on l’a rappelé dans de précédents chapitres, au présent immédiat) la marginalité et la délinquance paraissent résumer leur condition. (Depuis 2013, Eurostat demande aux pays européens d'intégrer le trafic de drogue et la prostitution dans leurs comptes publics, ce qui revient aussi, en quelque sorte, à avaliser administrativement le partage social de la délinquance. Une statistique de l’INSEE de 2018 évalue ainsi à 3,1 milliard d'euros par an, avec « un risque de sous-estimation », la marché de la drogue en France. Le « cannabis » serait ainsi, après l’Éducation nationale et la SNCF, le troisième employeur français…) Mais ce qui distingue la délinquance des « cités » de la délinquance ordinaire, c’est évidemment la transcendance (si l’on peut dire) que peut lui conférer la religion, quand le crime contre la société consacre des « martyrs ». La question posée est donc celle de la continuité de la marginalité sociale au « futur radieux » de la croyance religieuse, ou : comment l’exclusion peut trouver remède dans une théocratie. C’était la réclame de l’État islamique aux transfuges ou convertis européens quand il les incitait à le rejoindre (et c’est bien ce qui différencie ce mouvement des autres formes de radicalité, type Al-Qaida, et qui explique sa séduction sociale : la moitié des français ayant rejoint l’État islamique sont des femmes) : il fait briller une Terre promise aux déracinés, inutiles dans les pays d’immigration et rejetés quand ils retournent au pays de leurs pères, un État qui réalise la prophétie, qui donne une place dans la société, un sens à la vie sous la charia, une épouse et le Paradis.
Comment, alors que la validité de la compréhension scientifique du réel est, chaque jour, démontrée par la maîtrise technique de la matière et du vivant, accorder crédit aux explications religieuses du monde ? C’est que la religion répond à des besoins qui sont rien moins que rationnels : grégaires, mystiques, sécuritaires, identitaires…, constituants de la créature émotionnelle qu’est l’homme et qu’elle marque du sceau du transcendant. Les religions n’ont pas la même histoire ni la même fonction. Une même religion peut inspirer des sentiments mystiques à ses fidèles et des ardeurs guerrières à d’autres. Au sein des sociétés libérales, leur prétention universelle et totalisante, partagée par toutes, ne pose pas question. Privée, plurielle, neutralisée par une certitude égale et contraire des autres religions, cette prétention est, comme telle, anecdotique. Ainsi, les croyances « exotiques » des immigrés n’affectent pas la force de travail pour l’exploitation de laquelle ils ont été déplacés. Il s’en faut : l’exercice de sa religion, tapis volant qui permet au fidèle, à l’heure de la prière, de réintégrer sa matrice identitaire est un moyen d’adaptation. L’islam de mémoire des immigrés de première génération, l’islam de résistance des traditionnalistes ou l’islam de subversion des djihadistes ne répondent évidemment pas aux mêmes configurations sociales.
Quand l’allégeance permet de passer du statut de dominé à celui de dominant
En dernier ressort, ce sont bien les engagements et les actes que la croyance religieuse est en mesure de justifier qui interrogent dans cette forme inédite de « lutte des classes » produite par les Trente glorieuses, quand les enfants des immigrés gagnent leur paradis en se vengeant de leur humiliation sociale. Quand on parcourt, par exemple, le check up que Mohamed Atta, l’un des terroristes du 11 septembre 2001, a dressé avant de perpétrer le crime de masse qu’il a programmé, ou son testament de (The Guardian du 30 septembre 2001 ; Le Point du 19 janvier 2007), on ne peut qu’être stupéfait par le mélange de méticulosité pragmatique et de délire qu’ils manifestent : marche à suivre pour la réussite de l’attentat préparé de longue date et rétribution divine dont Atta s’assure en s’enveloppant les organes génitaux pour être en capacité de jouir des vierges qui l’attendent au paradis… On dira que toutes les religions sont ainsi faites de routines pratiques et d’espérances métaphysiques et que leur empire est quasi universel. C’est le lieu de rappeler cette remarque de Julien Benda que nous avons citée à plusieurs reprises : « C’est la rançon d’une éducation rationaliste de nous rendre étrangère à peu près toute l’espèce humaine » (La jeunesse d'un clerc, Paris : Gallimard, [1937] 1968, p. 31). Soit, mais dans le monde fini d’aujourd’hui, aux hommes et aux cultures inexorablement imbriqués, s’il est une fonction de la religion qui doit être neutralisée, c’est bien sa fonction territoriale et son exclusivisme où puisent les intégrismes. Cette guerre surgit de la cohabitation, dans les sociétés industrielles, de deux mondes qui, juridiquement, ne font qu’un, mais qui vivent sous un apartheid de fait. Un reportage d’un quotidien américain de 2008 (Washington Post du 29 avril 2008), réalisé à la maison d’arrêt de Sequedin, estimait que « 60 % à 70 %» des détenus de cette prison étaient musulmans (alors qu’ils représentent « à peine 12 % de la population totale du pays »). L’un des terroristes se réclamant de l’État islamique, âgé de quarante ans, aura ainsi passé quatorze ans de sa vie en prison. Les activistes en question sont vraisemblablement la partie visible d’un fanatisme convaincu mais silencieux. Comment les sociétés visées pourraient-elles donner une dignité à ceux-là qui n’ont qu’une place marginale dans le corps social et qui trouvent dans la contre-société rêvée que leur offre la religion un sens à leur existence ? Les consommateurs aux terrasses de café, les spectateurs d’un concert, la rédaction d’un journal satirique font sans doute une cible facile, mais sont aussi symboliques du mode de vie que les intégristes et les exclus envient et exècrent : festif, païen, individualiste, insouciant, créatif… Un policier qui patrouille dans les cités déclare : « Ces jeunes détestent la société, vomissent leur amertume. Ils ne s’aventurent pas sur le terrain du terrorisme, mais ils cultivent une haine liée à la religion. Quand on patrouille, on entend?: “Y a les porcs?! Y a les porcs?!” ». La relation de conséquence et la gradation entre cette revendication identitaire, la délinquance, puis l’engagement politico-religieux sont résumés dans cette statistique d’Europol : sur 816 combattants étrangers de l’État islamique identifiés durant les six premiers mois de 2016, 67 % avaient eu auparavant des activités criminelles (trafics de drogue, d’armes à feu, d’êtres humains). Les prisons, où cohabitent les détenus de droit commun et les terroristes, sont les lieux naturels d’incubation de la radicalisation. La religion enrôle et donne un sens rétrospectif à la « galère ». La minute de silence du 16 novembre observée à la prison de Fresnes, en hommage aux 129 victimes des attentats du 13 novembre 2015, a été huée et ponctuée de : « Allah Akbar ! ». Dans son édition du 16 novembre, La Voix du Nord fait état de « cris de joie et d’applaudissements » dans les maisons d’arrêt de Vendin-le-Vieil et de Sequedin au moment où les attentats ont été portés à la connaissance du public. Un surveillant explique : « On croyait que la France avait marqué un but contre l’Allemagne, mais non, c’était des réactions à l’annonce des attentats de Paris »... Ce qui s’exprime dans ces ovations pour les assassins, au-delà de l’évidente volonté de provocation d’hommes privés de liberté, c’est une lutte sociale qui emprunte ses arguments à la religion. C’est ce que confirme le hashtag qui a prospéré sur internet : #jenesuispascharlie après l’attaque terroriste contre le journal satirique Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Le ministère de l'Intérieur révélait, le 9 janvier, que « 3 721 messages faisant l'apologie des attentats avaient été recensés sur les réseaux sociaux depuis l'attaque »…
Les revenants. Ils étaient partis pour faire le jihad, ils sont de retour en France,
David Thomson, Paris : Seuil - Les Jours, 20016
La lecture des entretiens que David Thomson a réalisés auprès de djihadistes permet de préciser sur le vif la représentation que l’on peut se faire de ces adeptes de l’islam radical engendrés par les banlieues industrielles. Deux mots reviennent dans leur bouche : « fierté » et « humiliation ». « J’ai toujours eu l’impression d’être inférieure du fait que j’étais musulmane » (p. 189) déclare une « revenante » qui déclare par ailleurs : « l’attentat de Charlie Hebdo, ah c’était un des plus beaux jours de ma vie » (p. 175). Un autre se souvient des réactions à cet attentat alors qu’il est incarcéré : une « euphorie générale » : « Ils ont crié, ils ont fait des takbir, on entendait des “Allahou Akbar” partout. Y a un bâtiment complet, on entendait que ça. C’était incroyable. C’est pour ça que je pense qu’ils sont vraiment nombreux. J’avais l’impression qu’ils étaient partout » (p. 130). « La proclamation du califat, développe David Thomson, est apparue [à ces recrues] comme un rêve à portée de main. Enfin un État où les humiliés de l’“islam authentique” passeraient du statut de dominés à celui de dominants » (p. 190). De fait, depuis 2012, environ 1100 français sont partis en Syrie, souvent en famille. Un djihadiste français en fonction à la frontière turque pour l’État islamique raconte l’afflux : « Au début, des centaines et des centaines par jour. Juste après l’annonce du califat, c’étaient des centaines. Après, par jour, c’étaient aux alentours de quatre-vingts, cent personnes, un truc comme ça pendant des mois. Mais une fois qu’il y a eu cette coalition, ça a fondu petit à petit » (p. 38). Les raisons sociologiques de cet « exode » (hijra) paraissent évidentes. A ceux qui vivent l’« humiliation » et l’absence de toute perspective de changement, l’État islamique offre une promesse de régénération sous la charia et une revanche théâtralisée dans la violence des vidéos de décapitation diffusées sur internet. Important leur culture de banlieue dans un cadre formellement religieux qui « ne propose pas tant [« à la population délinquante ou carcérale »] de changer de vie que de rester [la] même, tout en étant religieusement légitimé[e] » (p. 280-281), la vengeance de ces humiliés est une action de justice et leur barbarie une violence d’État.
Thomson relève la continuité de ces parcours : pour beaucoup, des chanteurs de rap qui passent sans rupture du « Nique la France » à l’injonction terroriste : « Exploser la France » (p. 257 et 259). Parmi les jihadistes étrangers, plusieurs rappeurs au succès relatif, l’allemand Deso Dogg ou le tunisien Emino. « Ce profil d’ancien rappeur gagné par la cause de l’État islamique est loin d’être isolé. Comme lui, la quasi totalité des hommes jihadistes que nous avons pu interwiever (une centaine depuis 2012) expliquent avoir baigné dans le rap avant de passer au jihad. » « Emino chantait sa haine de la police et son penchant pour les filles, la fête, l’alcool et la fumette. Deux ans plus tard, il postait sur Facebook une photo de lui à Mossoul au pied d’un drapeau géant de l’État islamique » (p. 261). L’internet, mass-media à toutes mains de la mobilisation et de la formation des djihadistes, devient une arme de guerre. Moyen de diffusion, de communication et de rencontre qui échappe largement au contrôle, c’est aussi un outil qui permet à chacun de se mettre en vedettte. Ainsi d’un français de Syrie qui « s’affichait beaucoup sur Facebook. C’était soit pour faire le beau gosse et montrer à ses potes en France qu’il était là-bas, soit pour narguer les services antiterroristes en France, soit c’était pour attirer des femmes » (p. 113). « Du rap au nashîd, [chant a capella d’origine religieuse vantant les exploits des compagnons du Prophète réinvesti par l’EI] tout change pour que rien ne change. Dans les deux cas, le besoin de reconnaissance, le narcissisme, les cibles sont les mêmes » (p. 262). Dans les banlieues d’Europe, le nashîd des origines est en effet un avatar du rap décliné dans les codes islamiques, un « rap islamique » (voir : Rythmes et voix d'islam: Une socioanthropologie d'artistes musulmans européens, Farid El Asri, Louvain : Presses universitaires de Louvain, 2015, p. 77, 137, 151). Un rappeur francophone se proclame « islamo-caillera » (« caillera » pour « racaille »). « La diffusion ouverte de cette idéologie dans l’internet public, relève Thomson, émerge véritablement en 2012 : c’est à partir de ce moment que des Français commencent à poster des photos d’eux en armes sur leur page Facebook. Or ce sont ces selfies postés de Syrie qui ont vraiment provoqué une accélération du phénomène. C’est une sorte de stade ultime de la téléréalité qui vend un “jihad 5 étoiles” comme expérience “LOL”. Pour capter le regard d’autrui, ses acteurs s’exposent avec un narcissisme et une quête de célébrité warholienne en prétendant agir en uniques garants de la religion » (p. 276). On trouve sur l’internet les opuscules intégristes interdits dans les librairies, des recettes de fabrication d’explosifs et des outils de communication cryptés, toute la chaîne de production terroriste…A cet égard, l’internet donne au rap les moyens de passer à l’acte. Sous-produits de la modernité industrielle, rap et djihadisme sont, en l’espèce, deux expressions du self de la haine sociale.
Le vertige de la foi précipite dans l’instant en un ensemble cohérent une expérience du monde qui renverse toutes les « galères » de la vie marginale. Il fournit à la fois l’explication de la dèche quotidienne et son remède. « L’EI s’inscrit dans la prophétie eschatologique musulmane et vend un statut valorisé au sein d’une utopie, celle d’une cité idéale pour tous les musulmans » (p. 77). Pour les candidats à l’exode, l’EI est en mesure de réaliser l’espérance d’aspirations existentielles, identitaires et matérielles. L’adhésion religieuse donne une réponse et des moyens à tous les registres de la vie humaine, à commencer par les plus communs. Aux yeux d’un « revenant », « la dimension religieuse de l’engagement jihadiste est fondamentale dans la plupart des cas, mais le facteur sexuel est également un élément de motivation […] c’est par cet aspect là que Daesch a réussi à attirer beaucoup de gens » (p. 114). Une « figure » du jihadisme parmi les Français de l’EI explique : « “Les gens qui veulent se marier, vous prenez une photo avec deux kalach comme moi”, et il a dit : “Vous allez voir pécho”. Lui s’est marié comme ça avec quatre femmes là-bas. Trois Françaises et une Tunisienne. Comme il avait quatre femmes, il avait deux appartements. C’est l’EIIL qui les lui avait fournis » (p. 113).
S’il existe un profil social pour faire allégeance, il existe aussi des déterminants familiaux et des rencontres décisives : une socialisation primaire dans la culture islamique (même si les parents ne sont pas pratiquants) et un passage par le salafisme. Les adeptes, après avoir vécu dans l’ignorance de la religion et dans le péché ont une révélation. « Z. considère aujourd’hui que, pour lui comme pour une majorité de français rencontrés en Syrie, le quiétisme a préparé le terrain et constitué un marchepied vers son basculement dans le jihadisme » (p. 99). Ils découvrent que ce pour quoi ils sont marginalisés et méprisés est en réalité un signe d’élection et que leur paradis est aux portes de l’Europe… Etre musulman n’est donc pas une propriété comme une autre, une appartenance à côté d’une autre, elle est exhaustive et exclusive. Le salafisme enjoint au musulman l’imitation du Prophète, le retour aux sources et le rejet des formes politiques modernes. La loi n’appartient qu’à Dieu. « Ce qu’ils veulent, ces gens, c’est pas l’islam de France, c’est l’islam tout court. Eux, ce qu’ils veulent, c’est la porte pour aller au paradis » (p. 98).
Encore faut-il croire… Quand bien même il se persuade qu’il n’est pas fait que de raison et que ses besoins les plus fondamentaux sont gouvernés par l’émotion, un esprit rassis a quelque peine à se représenter que des êtres doués d’intelligence puissent adhérer, sinon par habitude ou par conditionnement spécifique, autrement que métaphoriquement, sans y penser en quelque sorte, aux interprétations du monde et aux promesses qui sont délivrées par les religions, Paradis et Enfers compris. Depuis qu’homo sapiens sapiens peuple la planète, 110 milliards d’individus se sont succédés. Ça fait du monde. Or, pas un seul des quelque 100 milliards d’êtres humains qui ont sauté le pas n’a été en mesure de faire signe aux vivants. (Alors que, depuis qu’on sait communiquer, ce ne sont pas les outils qui manquent : peintures rupestres, signaux de fumée, scytales, quipus, messagerie cryptée…) Ce qui signifie raisonnablement qu’il n’y a rien de l’autre côté. Il n’y a pas d’après. Les seules preuves disponibles sont le fait de vivants. Qui ont cru voir. Qui ont rêvé. Qui ont été possédés par un esprit. – Ou qui brocardent : le 20 févier 1951, au lendemain de la mort d’André Gide, François Mauriac a reçu un étrange télégramme ainsi libellé : « L’enfer n’existe pas – stop – Tu peux te dissiper – stop – Préviens Claudel – stop – Signé : André Gide »… Il faut donc chercher ailleurs la nécessité et l’universalité de cette croyance dans l’au-delà. On opposera au raisonneur qu’il ne faut pas confondre foi et crédulité. Ainsi de la preuve de l’existence des houris du paradis (« Sur une échelle de motivation [à l’émigration en Syrie] de un à cinq, je mets les houris en troisième position » affirme un « revenant » - p. 114) administrée par l’observation suivante (racontée « par un Français de l’État islamique après la mort d’un de leurs camarades ») : « Il disait qu’il avait vu des traces blanches sur ses sous-vêtements. Il disait qu’il avait éjaculé après sa mort parce qu’il avait vu des houris. Il a dit : “Hashakoum, les frères, il a éjaculé, soubhanallah, ça veut dire que c’est la vérité ! Il y a bien des houris au paradis, les frères” » (p. 114-115). Le besoin de la créature de se représenter l’idéal et de le personnifier est irrépressible. Au fond, ce qui distingue ici une religion d’une superstition, c’est que la religion a beau comporter quantité de croyances naïves (peu importe), elle fait système et exprime l’économie générale d’une société donnée. C’est dans cette performance que réside sa nature propre, dans la relation d’expression entre l’organisation sociale et le dogme. C’est la société sublimée. Le fidèle se reconnaît dans cette idéalisation qui satisfait son désir de transcendance et de protection collective. Dans les cas de réislamisation-conversion en cause, où le besoin de croire est proportionnel à la deshérence, la révélation d’une appartenance supérieure efface les galères du réel et fait miroiter sur internet un monde idéal – la réalisation de cette utopie reposant, en l’occurrence, sur la capacité de l’État islamique à s’approprier les ressources pétrolières. Sans pétrole, pas de paradis. Ce mirage barbare qui a libéré la violence sociale des « cités » dans la géopolitique de la guerre pour le contrôle des gisements pétroliers révèle la violence contenue de la quotidienneté urbaine – et la capacité de mobilisation de l’islam.
Religion privée, religion publique
La religion est la pierre d’achoppement du « vivre ensemble », le point de friction du « choc des civilisations » visé. Mais il ne s’agit pas d’une opposition réellement frontale. Dans cette hypothèse, il faudrait se demander « combien de divisions » islam et christianisme seraient en mesure d’enrôler – et faire le constat d’une mobilisation bien inégale. Églises vides (ou fréquentées principalement par de vieilles femmes) et mosquées pleines (œuvrant à l’éducation masculine). Cette guerre (l’islam contre les « croisés ») campe une opposition asymétrique. C’est que les religions en présence sont de nature bien différente. Dans les sociétés dites chrétiennes, la maîtrise du réel est de nature profane et l’emprise de la religion, qui tient dans sa capacité à réduire la complexité du réel et dans sa puissance de conditionnement, est marginale ou déviante (de type sectaire). La religion y a fixé le droit civil, ainsi qu’il a été rappelé, mais son appareil théologique et liturgique est devenu allégorique, la science et la technique ayant substitué des réponses matérielles et vérifiables – profanes – aux réponses symboliques et rituelles. Elle est réduite à son épure, soit à la structure sociale qu’elle a légitimée. People of no religion outnumber Christians in England and Wales, titre le Guardian du 23 mai 2016. La proportion de personnes qui cochent la réponse : No religion aux enquêtes démographiques (NatCen British Social Attitudes, 2014), alors qu’elles ont reçu au moins une teinture d’éducation religieuse, est en augmentation constante. Une enquête sur la sécularisation des 16-29 ans en Europe révèle qu’à la question : « Considérez-vous que vous appartenez à une religion ou à une confession religieuse ? », la réponse : « Non, aucune » atteint 91% en République tchèque, 80% en Estonie, 75% en Suède, 70% au Royaume-Uni et 64% en France (La Vie du 20 mars 2018).
A l’inverse, un trait caractéristique de l’islam, c’est son emprise orthopraxique qui conditionne tous les aspects de la vie quotidienne. L’image d’Épinal des prosternations collectives ou les astreintes du ramadan suffisent ici au propos. Dans le culte comme dans la vie sociale, la police des attitudes s’exerce par l’imitation et la grégarité. Le fidèle se doit de répéter les gestes du Prophète, supposés inspirés par Dieu. Cette orthopraxie fonde la croyance selon laquelle il n’est aucun domaine qui échappe à la religion et convainc que les matières les plus triviales (et les plus inattendues pour un moderne) relèvent de son magistère. Ainsi (entre autres exemples et au risque de heurter l’honnêteté), peut-on lire dans le Guide Pratique du Musulman, Abrégé des principaux décrets religieux des juristes musulmans contemporains et notamment de l'Ayatollâh Sayyed Ali Al-Sistâni (édité par la Cité du Savoir en 2003 au Canada) : « article 36 : Lorsqu'on veut entrer aux toilettes, il est recommandé d'y avancer d'abord le pied gauche, d'avoir la tête couverte et de s'asseoir là où on ne peut être vu. Il est aussi recommandé de placer le poids de son corps sur le pied gauche et, en sortant du lieu d'aisance, d'avancer d'abord le pied droit »… Il n’y a aucun espace de la vie du musulman pieux, pourvu d’un répertoire d’invocations adaptées à toutes les situations, qui échapperait à la religion. La foi ne consiste pas seulement en pensées et en prières codifiées et répétitives, mais en gestes et en routines (dressage qu’on peut observer à des degrés divers dans la plupart des religions) par lesquels, comme l’écrit un exégète, le fidèle « enlace le corps imaginaire de la loi » (et est enlacé par lui). Ces automatismes ont une évidente valeur adaptative mais ils entretiennent aussi, dans un monde en perpétuelle transformation, une rigidité (une mise en sommeil de l’esprit critique propre à toute croyance) proportionnelle à la profondeur de la foi. De l’alimentaire au vestimentaire, le musulman est ainsi conditionné par un mode de vie ségrégatif et dépréciatif de toute autre humanité (le halal décrète impure la nourriture des autres ; le confinement et la tenue de ses femmes résument l’urbanité du fidèle). Un rapport de l’Institut Montaigne (daté de septembre 2016) fondé sur une enquête de l’IFOP expose que « plus de 80 % [des musulmans], toutes les classes d’âges confondues déclarent acheter toujours ou parfois du halal […], que 80 % des musulmans interrogés souscrivent à l’affirmation suivante : “Les enfants devraient pouvoir manger halal dans les cantines scolaires” » (p. 33) et qu’« environ 65 % des musulmans – de religion ou de culture – se déclarent favorables au port du voile » (p. 35).
Dans la société multiculturelle, constitutionnellement désacralisée, l’intégrisme religieux répond à une demande identitaire différentialiste. Il ne s’agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s’agit d’être. D’exister par allégeance à ce qui distingue. Si l’on entend par religion ce que les démocraties occidentales qualifient comme tel : un corpus de métaphores sur l’origine du monde et des croyances privées censément indifférentes au fonctionnement de la société, le problème avec l’islam en société d’accueil, c’est son aspiration (tacite ou déclarée) à réglementer tous les aspects de la vie sociale. Pour les musulmans, la charia est d’ordre divin, elle est évidemment supérieure à la loi des hommes. C’est Dieu qui a décidé de la supériorité du musulman sur le non-musulman, de l'homme sur la femme, etc. Propre à la généralité des religions, une fois admise cette naïve et nécessaire autolâtrie, il n’y a pas de problème de coexistence avec l’islam en tant que religion, soit une métaphore et un code de conduite privé. Il y a difficulté quand cette emprise physique de règles et de valeurs datant du VIIe siècle (et suivants), qui réifie une configuration historique et culturelle passée, s’impose littéralement au croyant d’aujourd’hui. Si le roi du Maroc, Mohammed VI, « commandeur des croyants », a promulgué une ordonnance (le 6 février 2016) visant à « supprimer des programmes et autres manuels d’éducation religieuse de toutes les matières susceptibles de nourrir l’extrémisme » dans l’esprit des musulmans, c’est qu’il y a un réel problème avec des sermons et des instructions lorsqu’ils sont compris à la lettre. La sourate 9. 29 du Coran énonce : « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour Dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre [juifs et chrétiens], jusqu’à ce qu’ils versent la capitation [jizya] de leurs propres mains, après s’être humiliés ». Une information de l’agence Reuters du 18 juillet 2014, rapporte que les membres de l’État islamique, après avoir envahi la ville de Mossoul, ont diffusé un communiqué à l’intention des chrétiens : We offer them three choices: Islam; the dhimma contract - involving payment of jizya; if they refuse this they will have nothing but the sword. C’est l’instruction coranique. Les vidéos de décapitation diffusées par l’État islamique répondent à l’injonction du Coran : « Les mécréants, frappez-les au cou ! » (47. 4), etc. Le fidèle ordinaire, pétri d’imprécations anachroniques (un bon musulman répèterait « dix-sept fois par jour l’invocation [al-Fatiha] : “Guide-nous sur le chemin droit, non pas le chemin de ceux contre lesquels tu es en colère [les juifs], ni le chemin des égarés [les chrétiens]” »), doit se garder, s’il le comprend, du premier degré du texte sacré – sauf à rallumer les incantations guerrières du Coran de Médine (postérieur à l’année 622), celui de la conquête… La surreprésentation de déséquilibrés dans le terrorisme islamique met en effet la lettre de la foi en question.
Il a été rappelé et répété dans les pages qui précèdent que, dans la suspension du conditionnement pseudo-spécifique en quoi consistent les cultures et les religions, la reconnaissance de la forme humaine est « naturelle ». Les sociétés industrielles sont, de fait, plurielles et indifférentes aux croyances privées, elles constituent le vivier idéal du libre jeu de la reconnaissance. Alors que, dans cette suspension fonctionnelle des identités propre à l’acte économique, les conditions paraissent réunies pour une intégration réussie des immigrés dans une société égalitariste (l’école républicaine éduque tous les enfants à la même enseigne et tient que tout homme trouve sa place au sein de la société en fonction de ses talents), pourquoi, révélée par les attentats du Groupe Islamique Armé (G.I.A.) de l’année 1995 (la mort de Khaled Kelkal, lors de la vague d’attentat de l’été 1995, est suivie d’émeutes dans la région lyonnaise) et l’acmé terroriste de l’État islamique des années 2010, cette haine meurtrière des enfants des cités envers « la société » ? Avec ceux que l’on appelait alors les « Français musulmans d’Algérie », l’appel de main-d’œuvre en cause a aussi concerné massivement des ressortissants espagnols et portugais, en quête d’un « futur radieux », soumis à des conditions de vie identiques – et, le plus souvent, invisibles.
Voir, par exemple, Le drôle de mai, chronique des années de boue, de José Vieira (2008), documentaire sur les immigrés portugais installés dans les bidonvilles de la région parisienne dans les années soixante, et Souvenirs d’un futur radieux (2014) qui met en perspective, sur les mêmes lieux, l’immigration portugaise puis l’immigration rom, dont voici la présentation par son réalisateur :
« Souvenirs d’un futur radieux est l'histoire croisée de deux bidonvilles qui se sont construits, à 40 ans d’intervalle, sur un même territoire, hors la ville. À Massy, dans la banlieue sud de Paris, nous habitions un bidonville par temps de croissance, de plein emploi et d’avenir prometteur. C’était les années 60. Ils vivent dans un taudis dans un climat de crise, de chômage et d’exclusion. Nous sommes au début des années 2000. Ils viennent d’une région rurale où il n’y a pas de travail, où ils n’ont pas de terre. Pour la plupart ce sont des Roms, ils portent une lourde histoire. Ils fuient un pays où ils sont rejetés. Nous avions fui une société quasi-féodale, une dictature héritée de l’inquisition. Notre bidonville était peuplé de paysans pour la plupart analphabètes qui venaient de villages enclavés depuis des siècles. Nous venions du Portugal, ils viennent de Roumanie. Les regards croisés sur ces deux immigrations, traversés par des actualités des Trente Glorieuses et des années 2000, nous interrogent sur notre hospitalité, sur le traitement infligé par la France à ses étrangers, esquissent une mémoire commune des bidonvilles et témoignent que l’immigration est une histoire. L’histoire de gens luttant pour sortir de la misère, et persévérant, malgré les discriminations, dans leur combat pour la reconnaissance. »
L’expression sociologique des traits visés plus haut apparaît comme un frein à l’intégration des musulmans dans les sociétés libérales – intégration ordinaire s’agissant d’autres communautés. Au-delà des nostalgies politiques du passé revivifiées par l’islamisme, la vie sociale du musulman est, en effet, idéalement régie ou inspirée par des principes qui s’opposent au droit des pays d’accueil. C'est le dogme qui justifie cette spécificité. Alors que les économies mondiales ont progressé au XXe siècle en fonction de l'investissement des femmes dans le travail rémunéré, on l’a rappelé, les pays musulmans se singularisent, en effet, par ce qui paraît être un argument théologique majeur : l'inféodation juridique des épouses et des filles. Ces deux traits étant dépendants, on peut se demander ce qui, dans l'anthropologie musulmane, conditionne ce conservatisme.
Le « mariage arabe »
Si l’on interroge la littérature spécialisée, l'attention est immédiatement retenue par un classique des études de parenté qui concerne, précisément, ce que l'on appelle le « mariage arabe », soit le mariage préférentiel d'un fils avec sa cousine parallèle, la fille du frère de son père – type de mariage qu'on oppose, dans les sociétés anciennes, avec le mariage avec la cousine croisée, expressif, lui, de l'échange et de l'exogamie. (Sur la philosophie du mariage proche, voir supra : « Transmettre le patrimoine génétique, transmettre le patrimoine économique… ») Le mariage avec la cousine parallèle exprime une endogamie qui tranche avec l'intention d'usages partagés par la plupart des sociétés. Les appelés du contingent français ayant participé à la guerre d'Algérie, revenant au pays, stigmatisaient la famille nord-africaine par l'expression grossière, significative d'une incompréhension manifeste (tranchant avec leurs propres usages matrimoniaux) de « famille tuyau de poêle ».
Depuis l'ouvrage de Robertson Smith (Kinship and Marriage in Early Arabia, Cambridge, 1885, réédité avec un additif en 1903), le mariage préférentiel avec la bint 'amm, c'est-à-dire avec la fille de l'oncle paternel a fait l'objet de nombreuses études. Nous suivrons ici les travaux de Joseph Chelhod (« Le mariage avec la cousine parallèle dans le système arabe » dans : L'Homme, 1965, tome 5 n°3-4. Etudes sur la parenté, p. 113-173), alliant recherches de terrain, étude statistique et histoire, qui constate que « ce mariage préférentiel qui serait d'origine préislamique, est observé aujourd'hui [à des degrés divers] un peu partout dans le monde arabe » (p. 115). Cette question de la prévalence du mariage proche dans le monde arabe a fait l'objet d'une publication récente du « Center for Arab Genomic Studies » de Dubai (« Consanguinity and reproductive health among Arabs », Ghazi O. Tadmouri, Pratibha Nair, Tasneem Obeid, Mahmoud T. Al Ali, Najib Al Khaja and Hanan A. Hamamy, Reproductive Health 2009, 6:17), à laquelle nous renvoyons. Les auteurs relèvent que les taux de consanguinité dans les pays arabes, qui sont « les plus élevés au monde » (les mariages entre cousins germains pouvant représenter jusqu'à 25% et 30% des mariages), sont aujourd'hui en augmentation dans plusieurs pays comme le Qatar, le Yémen et les Émirats.
"Dans le mariage arabe tel qu'il fonctionne encore chez les Bédouins, écrit Chelhod (en 1965), le clan se replie sur lui-même, prend ses femmes dans la parenté agnatique la plus proche au point de frôler l'inceste, et le neveu n'offre apparemment à l'oncle paternel aucune compensation matérielle en contrepartie de la main de sa fille […] Dès sa naissance, la fille est considérée comme la fiancée virtuelle de son cousin paternel. Une différence d'âge, même importante, ne semble pas constituer un obstacle sérieux à l'exercice de ce droit coutumier" (p. 120).
Ce droit est transmissible, il est reconnu en priorité au fils aîné du frère du père, puis à ses frères cadets, par ordre de séniorité. « Tu oublies que nous sommes frères et que ton devoir est d'offrir ta fille à mon fils sans mahr [douaire] », dit un héros des Mille et une nuits cité par Chelhod. Le douaire est en effet inversement proportionnel au degré de parenté. La coutume reconnaît donc au neveu « des prérogatives sur la fille de son oncle paternel, qui sont presque égales à celles du père. Il serait possible de comparer ses droits à ceux d'un co-propriétaire » (p. 172). On faisait grand cas des enfants issus de ce type de mariage : on les appelait les mahd, c'est-à-dire ceux dont l'extraction est sans mélange, dont le sang est pur (p. 144). Par opposition, le mariage avec la cousine croisée matrilatérale est licite mais dévalué. II est significatif que dans le langage trivial d'Alep, relève Chelhod, les prostituées soient appelées « les filles de la tante maternelle » (p. 152).
L'ancien droit successoral arabe ne reconnaissait aucun droit à la femme (« pas plus qu'aux enfants d'ailleurs »). « N'hérite, disaient les Médinois, que celui qui participe au combat et défend les biens » (p. 170). Or, « les fils de nos fils sont nos fils, mais les fils de nos filles sont des fils d'étrangers » (p. 138). Pour obvier à ce risque de l'extranéité, il convient de se marier entre soi. La vie nomade, explique Chelhod, à la fois errante, belliqueuse et individualiste, achève de replier la cellule de base sur elle-même et « rend le mariage exogamique dangereux pour les preneurs, humiliants pour les donneurs. […] La femme, cette richesse “mobilière” et transmissible, est convoitée par les agnats. On tient donc à la garder dans le patrimoine familial au même titre que la terre » (p.171). Du fait de l'inflexion du droit successoral par l'islam et alors que la sédentarisation tempère les ardeurs belliqueuses qui justifiaient ce mariage proche, l'intérêt pour ce type de mariage ne se dément pas puisqu'en épousant la cousine paternelle, on garde sa part d'héritage dans la famille. Quoi qu'il en soit, le régime successoral musulman consacre une endogamie caractéristique et une inégalité juridique de l'homme et de la femme dont on retrouve l’intention dans diverses pratiques associées – non exclusivement – à l'islam.
On peut être étonné des débats contradictoires qui ont pu avoir lieu dans le cours du XIXe siècle sur les effets de la consanguinité, opposant « consanguinistes » et « anticonsanguinistes », les uns expliquant les effets nocifs de la consanguinité, les autres son absence de conséquences, voire ses effets bénéfiques. Ce qui montre au moins le défaut d'évidence cruciale (à l’époque) sur un sujet incompris et, de ce fait, ouvert aux préjugements. L'ouvrage de A. H. Huth, The Marriage of Near Kin (Londres, Longmans Green, 1887, 2e éd.) contient la bibliographie quasi complète de ces écrits. « Les nombreux mémoires publiés, écrivent Sutter et Tabah à ce propos, frappent surtout par l'ardeur des protagonistes » alors que leurs conclusions pèchent par la faiblesse statistique et l'imprécision de leurs données… (Sutter Jean, Léon Tabah : « Effets des mariages consanguins sur la descendance ». Dans : Population, 6e année, 1, 1951 pp. 59-82, p. 60). C'est le développement de la génétique mendélienne qui a permis d'identifier les risques engendrés par ce type d'union, soit la probabilité de rencontre de deux allèles mutés.
La philosophie du mariage proche n'est évidemment pas une exclusivité du monde arabe et musulman. En Grèce classique, l'épiclérat, soit la possibilité pour un homme ou pour son fils d'épouser la fille de son frère quand celui-ci décédait sans héritier mâle, consacrait un mariage consanguin (voir : « Transmettre le patrimoine génétique…»). Les exemples bibliques sont tout aussi fameux : Abraham épouse sa demi-sœur Sarah ; Isaac épouse sa cousine Rebecca (de préférence à une fille de Canaan) ; la fille d'Haran, Milca, épouse son oncle, Nachor – au XVIIIe siècle le mariage oncle-nièce restait licite pour les juifs de l'île de Rhodes (John D. Cushing, The fisrt laws of the state of Rhode Island, 1983). Cette stratégie du mariage proche, dans le déni des évitements naturels, s'autorise de motivations identitaires ou économiques. Les conséquences de ce type de mariage n'apparaissent pas dans les argumentaires ou récits en question.
Un exemple aujourd'hui classique des études médicales touchant la pathologie de la consanguinité (récemment médiatisé et politisé) est constitué par le profil spécifique de la population d'origine pakistanaise en Grande-Bretagne où le mariage entre cousins est valorisé et peut concerner une proportion importante des unions. Recherchant les causes des anomalies congénitales dans une population de nouveaux-nés à Bradford, au nord de l'Angleterre où vivent différentes communautés, Sheridan et alii mettent en évidence le risque de malformations génétiques lié au mariage de ce type (The Lancet, volume 382, No. 9901, p1350-1359, 19 october 2013. « Risk factors for congenital anomaly in a multiethnic birth cohort : an analysis of the Born in Bradford study ». Leeds Institute of Biomedical & Clinical Sciences).
Le programme « Born in Bradford » est une étude à long terme d'un groupe de 13.500 enfants nés de mars 2007 à décembre 2010. Sur les 11.396 dossiers médicaux de nouveau-nés étudiés, 386 (3%) présentaient une anomalie congénitale : malformations physiologiques (cardiaques, nerveuses, urinaires, pulmonaires) et chromosomiques (trisomie 21). Ce taux (305,74 pour 10.000 naissances viables) est près du double de celui de la moyenne nationale britannique (165,90 pour 10.000). Le taux de mortalité infantile, supérieur lui aussi au taux britannique moyen dans les familles d'origine pakistanaise, a le plus souvent pour cause ces anomalies congénitales. Parmi les 5127 nouveau-nés d'origine pakistanaise, 1922 (soit 37%) procédaient d'unions de cousins germains. Après une recherche multifactorielle, les chercheurs estiment qu'un tiers (31%) de toutes les anomalies observées chez les enfants d'origine pakistanaise peuvent être attribuées à cette consanguinité qui occasionne un doublement du risque de malformations et de retard mental.
MailOnline : 23 August 2010 The greatest taboo :
One woman lifts the lid on on the tragic genetic consequences of when first cousins marry By TAZEEN AHMAD
Sitting in the family living room, I watched tensely as my mother and her older brother signed furiously at each other. Although almost completely without sound, their row was high-octane, even vicious. Three of my uncles were born deaf but they knew how to make themselves heard. Eventually, my uncle caved in and fondly put his arm around his sister.My mum has always had a special place in her family because she was the first girl to live beyond childhood. Five of her sisters died as babies or toddlers. It was not until many years later that anyone worked out why so many children died and three boys were born deaf. Today there is no doubt among us that this tragedy occurred because my grandparents were first cousins.
My grandmother’s heart was broken from losing so many daughters at such a young age. As a parent, I can’t imagine what she went through. My family is not unique. In the UK more than 50 per cent of British Pakistanis marry their cousins – in Bradford that figure is 75 per cent – and across the country the practice is on the rise and also common among East African, Middle-Eastern and Bangladeshi communities. Back when my grandparents were having children, the medical facts were not established. But today in Britain alone there are more than 70 scientific studies on the subject.
We know the children of first cousins are ten times more likely to be born with recessive genetic disorders which can include infant mortality, deafness and blindness.
We know British Pakistanis constitute 1.5 per cent of the population, yet a third of all children born in this country with rare recessive genetic diseases come from this community.
Despite overwhelming evidence, in the time I spent filming Dispatches: When Cousins Marry, I felt as if I was breaking a taboo rather than addressing a reality. Pakistanis have been marrying cousins for generations.

"Tazeen Ahmad files a courageous and controversial report
on one of the great taboos of modern Britain"
In South Asia the custom keeps family networks close and ensures assets remain in the family. In Britain, the aim can be to strengthen bonds with the subcontinent as cousins from abroad marry British partners.
Some told us they face extreme pressure to marry in this way. One young woman, ‘Zara’, said when she was 16 she was emotionally blackmailed by her husband’s family in Pakistan who threatened suicide over loss of honour should she refuse to marry her cousin. She relented and lives in a deeply unhappy marriage. But others told me of the great benefits of first cousin marriage – love, support and understanding. To them, questioning it is an attack on the community or, worse, Islam […]
Des tests opérés à l'aide de la matrice de Raven par des chercheurs indiens sur des garçons musulmans de Jaipur âgés de 13 à 15 ans, normalement scolarisés en higher secondary schools (« Effects of inbreeding on Raven matrices », Agrawal N., Sinha S.N., Jensen A.R., Behavior Genetics, 1984, nov, 14(6):579-85) mettent en évidence un déficit de QI de 5 points chez ceux qui sont nés d'un mariage entre cousins germains. D'une manière générale, dans les sociétés constituées de sous-groupes endogames ou dans les patriclans où l'endogamie est coutumière, le coefficient de parenté (avec effet fondateur associé), (soit la probabilité pour deux sujets d'être porteurs d'un gène identique transmis par un même ancêtre) augmente et les croisements consanguins multiplient d'autant le risque de trouver des individus homozygotes pour des allèles délétères.
La claustration des épouses et des filles, ici significative d'une forte endogamie, alors que, dans la plupart des cultures traditionnelles de type patriarcal et où l'exogamie est coutumière, l'économie a contribué à affranchir les femmes de la sphère domestique singularise les sociétés musulmanes d'aujourd'hui (pour prendre un exemple parmi d’autres : en Corée du sud, 48 % des femmes mariées exerçaient une activité professionnelle en 2000 ; le rapport de l’Organisation Internationale du Travail : Emploi et questions sociales dans le monde - Tendances de l’emploi des femmes 2017 estime que la réduction de 25 % des disparités entre hommes et femmes sur le marché du travail d’ici à 2025 produirait un bénéfice de 5 800 milliards de dollars pour l’économie mondiale). Dans les sociétés eurasiatiques, les transactions matrimoniales mettent généralement en œuvre des systèmes à dot qui ménagent l'égalité (relative) des contractants dans une structure monogamique (Nullum sine dote fiat conjugium) et qui préparent l'égalité homme/femme telle qu'elle est inscrite aujourd’hui dans la loi. Dans les sociétés islamisées et à des degrés divers (de type swahili, par exemple), le douaire est considéré comme l'équivalent de la compensation matrimoniale telle qu'elle se pratique dans les sociétés subsahariennes (« prix de la fiancée » ou « prix de la descendance »). Le douaire, ainsi qu’il a été noté plus haut, est en effet inversement proportionnel à la proximité de parenté. Dans l’« État islamique », selon des informations rapportées par David Thomson (op. cit., p. 200), le mariage s’accompagne d’un paiement dont la femme est censée fixer le montant et dont la moitié doit lui être restituée en cas de divorce. Idéalement polygame, le mariage musulman, quand il n'est pas un mariage sans mahr (visé dans l'article de Chelhod), semble philosophiquement plus proche du mariage « par achat » que du mariage avec dot. Il relève d’une logique lignagère et patriarcale dont les sociétés d’accueil se sont émancipées avec des unités domestiques où les époux forment une « société de mariage » (koinônía), pour user d’une expression de Plutarque quand il veut caractériser le mariage par l’égalité juridique des conjoints. A cet égard, le monde musulman fait exception à l’éthique des sociétés eurasiatiques.
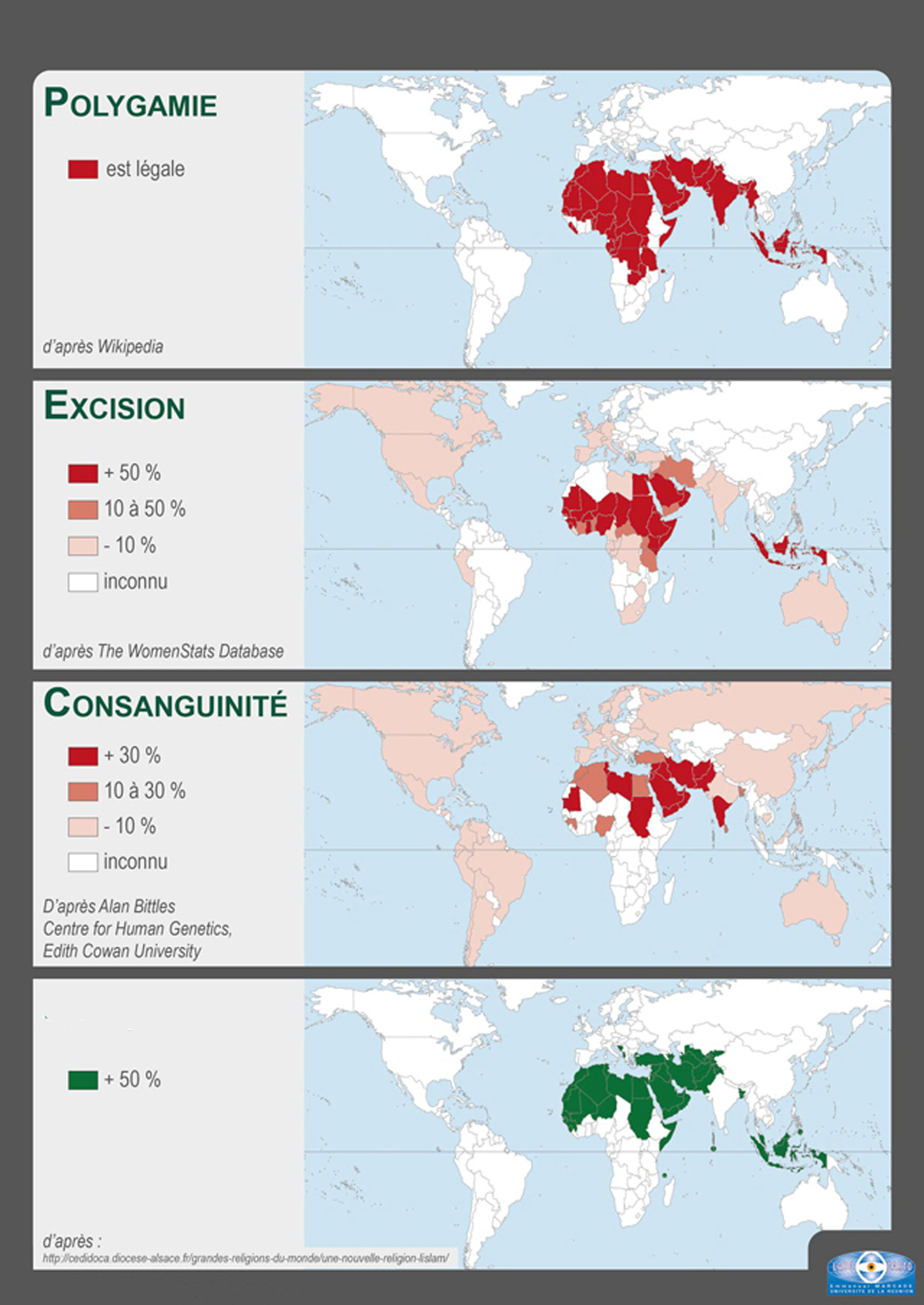
Voir : « Transmettre le patrimoine génétique, transmettre le patrimoine économique : paradoxes de la reproduction » :
« Une étude statistique portant sur 4005 mariages dans deux communautés musulmanes de l'Uttar Pradesh (Badaruddoza, M. Afzal, 1995, « Effects of inbreeding on marriage paiement in North India », Journal of Biosocial Science 27, 333-337) où le prix de la fiancée et le paiement de la dot sont coutumiers et peuvent coexister, met en évidence une relation inverse entre la compensation monétaire et la proximité consanguine.
On s'aperçoit qu'un certain nombre de traits se mettent naturellement en perspective sous ce chef du mariage entre soi et du statut de la femme : - l'inégalité juridique : selon la coutume, elle fait partie des biens successibles, héritable elle ne saurait hériter – héritent ceux qui combattent – et quand elle hérite sa part est moitié de celle de l'homme ; - la claustration (la « grille » de la burka, l'« œil de cyclope » des femmes voilées dans le Souf, les vêtements « sarcophages » – étymologiquement : qui mange la chair – si déconcertants à l'œil occidental…) ; - la mutilation sexuelle (l’excision et ses variantes ; on cible en priorité l'Afrique quand il est question d'excision, mais l'Indonésie, avec ses 205 millions de musulmans et où 95 % des petites filles sont excisées chaque année dans les centres de prière et les écoles au cours de campagnes organisées par la fondation Assalaam, est le premier pays concerné) ; - la polygamie… Ces données, sommairement exposées (qui rappellent a contrario, s'il était besoin, que l'évolution du statut juridique de la femme, traditionnellement assigné par la religion, accompagne la « modernité »), sont-elles constitutives de cette identité réfractaire à la société libérale ?
Books haram…
Dans la continuité de cette fermeture aux turbulences d’un monde en constante transformation, l’empire de la religion sur le savoir, qui offre sans doute une sécurité au croyant, constitue un facteur d’immobilisme évident. La mondialisation, qui met en vedette un développement basé sur la connaissance et sur la communication fait apparaître l'isolement des pays musulmans à ce titre. Selon le « top 50 » de l'« Index Translatonium » de l'UNESCO (qui enregistre les traductions dans le monde depuis 1979) le premier pays arabe, l'Égypte, arrive en 49ième position. Un rapport du PNUD de 2003 précise que « le total des livres traduits à partir l'époque d'al-Ma'mûn [calife abbasside qui régna de 813 à 833] jusqu’à aujourd'hui s'élève à 10 000 – l'équivalent de ce que l'Espagne traduit en un an » et que « dans la première moitié des années 1980 […], le nombre moyen de livres traduits par million d'habitants était de 4,4 dans le monde arabe (moins d'un livre par an et par million d'Arabes) quand il s'élevait à 519 en Hongrie et 920 en Espagne ». Quand on sait que la bibliothèque de Bagdad, fondée par Haroun al-Rachid (763-809), était un centre de traduction universel, qu’al-Ma’mûm, cité, échangeait des prisonniers byzantins contre des ouvrages rares détenus dans les bibliothèques et que le contingent de traducteurs recrutés par cette institution, polymathe et cosmopolite, a fait de la langue arabe, qui s’était politiquement imposée de l’Indus aux Pyrénées, la langue du savoir commun pendant plusieurs siècles, on mesure l’involution. La Banque islamique de développement établissait, en 2008, le constat suivant : « Les 57 pays à population majoritairement musulmane comptent sensiblement 23 % de la population mondiale, mais moins d'1 % des scientifiques qui produisent moins de 5 % de la science et font à peine 0,1 % des découvertes originales mondiales liées à la recherche chaque année » (documents cités dans Le Monde du 18 novembre 2010 ; voir : Eugene Rogan, « Arab Books and human development », Index of Censorship, vol. 33, issue 2 April 2004, p. 152-157). La Mésopotamie, là où a été inventée l'écriture, est aujourd'hui l’une des régions du monde qui compte le plus d'illettrés. C’est toute la différence de destin entre les civilisations qui font un usage ésotérique de l’écriture et celle qui en font un usage exotérique, selon que l’écriture est un moyen d’édification (à caractère sacré, le plus souvent) ou un moyen de libération (à fonction de communication). Quand le grec Charondas « ordonna que tous les fils de famille apprendroient à lire et à écrire sous des maîtres gagés par le public » (Les mœurs, coutumes et usages des anciens peuples pour servir à l’édification de la jeunesse, de l’un et l’autre sexe, François Sabbathier, Châlons-sur-Marne, 1770, p. 459), on peut dire qu’il ouvrit emblématiquement la civilisation de la connaissance et du partage du savoir. A l’inverse, au lieu d’être un outil public qui transmet le savoir ouvert à tous, l’écriture peut être le hiéroglyphe (étym. glyphe sacré) qui le réserve aux experts. Cet obscurantisme est résumé dans l'appellation de l'État islamique au Nigéria : Boko Haram : tout livre (book) autre que le Coran est diabolique (haram). Constantin Zurayq, un des fondateurs du panarabisme, expliquera ainsi la défaite des armées arabes devant le sionisme en 1948 (Ma’an Al Nakba [1948], tr. The Meaning of the Disaster Beyrouth : Khayat’s, 1956, p. 2 et p. 34) :
"Seven Arab states declare war on Zionism in Palestine, stop impotent before it, and then turn on their heels […] The explanation of the victory which the Zionist have achieved […] lies not in the superiority of one people over another, but rather in the superiority of one system over another. The reason for this victory is that the roots of Zionism are grounded in modern Western life while we for the most part are still distant from this life and hostile to it. They live in the present and for the future while we continue to dream the dreams of the past and to stupefy ourselves with its fading glory."
L'histoire s'est arrêtée avec le Prophète. La participation du fondamentalisme islamique à la science et à la technique se résume d'un mot : détournement. De fait, les publications les plus prestigieuses des pays musulmans sont des publications à caractère religieux. Le croyant vit ainsi dans un monde imaginaire où le réel est expliqué une fois pour toutes et sans discussion (alors que la science et la connaissance sont supposées se remettre en cause continuellement). La ressource du pétrole (la malédiction du pétrole) donne du crédit au dogme et finance les mosquées, entretenant la croyance que l'islam est toujours une religion de conquête. Pour cet islam, le monde se divise toujours en deux blocs : le Dar al Islam, « la maison de la paix » et le Dar al Harb, « la maison de la guerre » – et le djihad, combat pour la cause de Dieu, ne s’arrêtera que lorsque le monde sera converti (puisque, selon le Coran, tout homme est virtuellement musulman)… Socle de l’identité, sans doute, la religion exprime davantage qu’une histoire personnelle. Au sein de la ville cosmopolite, elle trahit, par ses manières d’être et de croire, le lieu de naissance et l’appartenance. Bien que se réclamant d’une même transcendance, les religions ne sont pas des corps de doctrine interchangeables. D’abord parce qu’étant totalisantes (elles expliquent le monde d’alpha à oméga), elles sont mutuellement exclusives et, le plus souvent et nécessairement, totalitaires. Leur caractère émotionnel et collectif justifiant ce passage du cognitif au répressif. Qu'est-ce que croire, sinon être persuadé que ce qui est dit dans les textes sacrés est une vérité absolue ? Et on peut légitimement considérer qu'en leur for intérieur, au-delà des discours politiquement corrects que doivent tenir leurs représentants officiels dans les sociétés libérales, la plupart des musulmans pensent que les assassins font justice en abattant les profanateurs (ce que les jeunes musulmans « des banlieues » articulent sans détour).
Facteur de ségrégation, la religion est le principal élément de résistance à l’urbanité d’aujourd’hui. « Je le répète : l'assimilation est un crime contre l'humanité. » « Loin de désarmer, le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré, mardi 12 février [2008] devant le Parlement turc, les propos provocateurs qu'il avait tenus dimanche en Allemagne, devant 20 000 personnes réunies à Cologne », rapporte Le Monde du 13 février 2008. La religion paraît bien être, en effet, ce môle hercynien des identités contre lequel achoppe l'espérance transculturelle. La croyance est un facteur de conflit et la révélation un démultiplicateur de haine. On pourrait, en l’espèce, paraphraser un mot, cité ailleurs : « La religion ajoute à la férocité naturelle de l’homme ». La religion, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, qui sacralise l’identité, le territoire, l’aséité, l’amour de soi, l’instinct de vie et de survie est de toutes les guerres. Les fondamentalistes, quels qu'ils soient, disent tout haut ce que les croyants pensent tout bas – et le mettent à exécution. Contre toute attente, mais nécessairement, les guerres qui visent les sociétés développées, procédant de la part la plus dévalorisée du corps social, sont des guerres qui ont la foi, l’histoire et l’identité pour étendard.
Les Palestiniens commémorent la Nakba (al-Nakba, « la Catastrophe », « le Désastre ») l’expulsion ou l’exode de 700 000 d’entre eux lors de la création de l’État d’Israël en 1948. D’après Eitan Bronstein, qui a enquêté sur les occurrences du mot « Nakba » dans la vie politique et culturelle en Israël (« A brief history of the “Nakba” in Israel » - article en ligne sur le site de l’ONG israélienne « De-Colonizer », mai 2016), la première utilisation du terme est le fait de l’armée israélienne : In July 1948, IDF [Israel Defense Forces] addressed with leaflets to the arab inhabitants of Tirat Haifa who resisted the occupation. In excellent Arabic, they called on them to surrender : « If you want to be ready for the Nakba, to avoid a disaster and save yourselves from an unavoidable catastrophe, you must surrender ». Bronstein relève incidemment que, dans les archives de la Hagana, la traduction en hébreu du terme en cause est « Shoah », the term used in Hebrew to the Jewish catastrophe in the 2nd world war. La portée civilisationnelle de cet événement a été discutée dans l’essai de Constantin K. Zurayq cité : Ma’an Al Nakba (« la signification du Désastre ») paru dès 1948 à Beyrouth après la déroute des armées arabes. « La défaite des Arabes en Palestine, écrit Zurayq, n’est pas une épreuve passagère ni une simple crise, mais un désastre dans tous les sens du mot, le pire qui soit arrivé aux Arabes durant leur longue histoire pourtant riche en drames » (p. 2). L’ouvrage d’Ariella Azoulay, From Palestine to Israel, a Photographic Record of Destruction and State Formation, 1947-1950, 2011 (London : Pluto Press), corrige l’histoire officielle en décryptant les images d’archive et témoigne de cette « double catastrophe », celle, vécue par les Palestiniens, mais aussi de cette catastrophic blindness still inhabiting the souls of Israeli Jews (p. 233). La Nakba a aujourd’hui une portée quasi universelle (au moins au sein de l’umma, la communauté des croyants), puisqu’elle résume et symbolise la condition des pays dits du Tiers Monde. La « question palestinienne », avec la création, au cœur du Moyen-Orient, d’un État perçu par les Arabes comme une émanation de l’Occident, est devenue l’étendard de l’opposition Nord/Sud (un communiqué du cabinet du premier ministre israélien, de septembre 2018, relève que « depuis 2009, l’Unesco a fait voter 71 résolutions condamnant Israël contre 2 pour l’ensemble des autres pays dans le monde »). Cette connexion de l’histoire mondiale et de l’histoire de l’immigration est en mesure de conférer une signification à la misère des banlieues et d’armer le « racisme édenté », celui des victimes. La religion, dans sa fonction identitaire, agit ici comme un puissant champ magnétique qui donne sens aux stigmates de l’histoire et à la limaille de la quotidienneté, faisant apparaître les lignes de force d’une réquisition mystique ou politique.
Dans une société séculière, l'ordre public échappe à Dieu. Que reste-il dès lors au croyant pour mettre sa foi en pratique ? Ce qui, dans sa vie privée, n'est pas contraire à la loi commune. Il lui faut vivre une sorte de schizophrénie herméneutique : la coutume lui est utile pour marier ses enfants (dans le cadre de la loi civile), enterrer ses morts, vivre en groupe, se représenter une vie post mortem et autres commodités, mais elle est inappropriée à organiser une société multiculturelle – sauf à ravaler (et à ghettoïser) les autres croyances. Dans le monde moderne, la religion n'est plus une affaire d'État. L’espace public est commun, ce qui signifie qu’il doit être débarrassé de tout ce qui n’est pas raisonnable (susceptible de démonstration). Historiquement, combattre le cléricalisme (l'affaire Calas ou l'affaire Sirven), c'était lutter contre les injustices commises au nom de Dieu. Cette suspicion circonstancielle est devenue une propriété constitutive de l’espace public. La caricature, banale et obligée en démocratie, est un instrument de désacralisation de l'autorité, celle des hommes comme celle de Dieu. (Voir : « Rire et démocratie : la comédie d'Aristophane ».) Elle fait partie du paysage. Comme la une de feu Hara-Kiri ou de Charlie Hebdo, placardée sur le kiosque à journaux et que l’on regarde distraitement en sortant du métro (sans nécessairement partager sa brutalité ou sa vulgarité).
Cet développement – introductif et sommairement exposé – rappelle, s'il était besoin, que l'évolution du statut juridique de la femme, traditionnellement assigné par la religion, accompagne la « modernité ».
« En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. »
(Matthieu 26, 34)
L’émotion suscitée par l’incendie de Notre-Dame de Paris, en avril 2019, invite à considérer, par comparaison avec ce qui vient d’être développé, la place singulière du christianisme dans la société libérale. L’émotion a été quasi universelle alors que l’incroyance est générale (jusqu’aux catholiques qui ne sont que 4,5 % à fréquenter chaque dimanche le culte dont la cathédrale Notre-Dame est l’expression – voir aussi les résultats des enquêtes précédemment citées : NatCen British Social Attitudes, 2014, La Vie, 2018). Même si le divorce est aujourd’hui patent entre l’« accroche narrative » du christianisme et la doxa commune (les politiques ont refusé cette mention des « racines chrétiennes de l'Europe » dans le projet de Constitution européenne de 2004), il est évident que le christianisme, c’est l’Europe. Comment l’Europe peut-elle avoir à la fois d’évidentes « racines chrétiennes », ici révélées émotionnellement par l’incendie de la cathédrale, et rejeter presque unanimement cette évidence ? C’est en effet sous les espèces, laïques, du « patrimoine » et de ce que celui-ci peut exprimer d’identité, d’un passé prestigieux mais révolu et qui ne saurait être une ligne de conduite, qu’est le plus souvent déploré le désastre en cause – et ce sont les milliardaires du luxe, Arnault, Pinault, Bettencourt (débiteurs du patrimoine culturel et du « chic » parisien) qui ont été les premiers et les plus spectaculaires donateurs pour la reconstruction du monument. Un paradoxe de l’homme européen est qu’il sait procéder de valeurs originellement portées par des croyances qui sont en contradiction avec le monde scientifique, matérialiste, individualiste qui conditionne sa ressource et son mode de vie – des croyances impraticables… Aveuglement, reniement, honte de faire figure de passéiste ou de donner à penser qu’on croit littéralement aux allégories religieuses, cette dénégation méconnaît le rôle qu’a pu jouer le christianisme dans la constitution du droit civil et dans la genèse de la pensée scientifique occidentale (comme il a été rappelé ici). Pour le premier point, l’explication est lointaine mais simple : les formes de la vie civile des sociétés occidentales tirent leur justification des choix de société du christianisme, eux-mêmes hérités du droit romain (monogamie, cellule domestique, héritage vertical et dévolution divergente). Le droit ayant supplanté la théologie, les sociétés européennes, devenues agnostiques, restent chrétiennes sans le savoir ou « pour la forme ». (En 2016, sur 54 500 mariages catholiques, 31 000 concernaient des non-pratiquants – si le droit autorisait les citoyens, pour prendre un contre-exemple, à avoir quatre épouses, ou substituait la ligne collatérale à la ligne directe, il cesserait d’être « chrétien »…) Pendant l’incendie de la cathédrale paraissait dans la presse une information qui peut sembler anecdotique, mais qui reflète les intérêts sociaux en cause : le classement des licences les plus demandées en 2019 sur Parcoursup (application web destinée à recueillir et gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur public français) qui place en tête le droit (256 264 demandes) et, en dernière position, la théologie (288 demandes). La « science de Dieu » n’éveille plus guère les vocations, à la différence de la science des lois du monde profane et bourgeois… Pour le second point, on peut rappeler comment le développement naturel de la théologie chrétienne produit son propre effacement. En divinisant l’âme (Dieu s’est fait homme pour sauver l’homme de sa nature charnelle), le christianisme crée une coupure radicale avec le monde de la « matière », objet de la science expérimentale. Blaise Pascal, savant, inventeur, philosophe et théologien, exceptait la science de l’intangibilité du dogme, science et croyance faisant l’objet de « droits séparés ». L’une procède de la Révélation, de l’autorité, explique-t-il, l’autre de l’expérience et de la raison. Leur mode d’être est donc radicalement différent. Le champ de l’argument d’autorité est celui de la théologie, dont les « principes sont au-dessus de la nature et de la raison », celui de la science, où la connaissance est cumulative, est celui de l’expérience (préface au Traité du vide [1651] Œuvres complètes, Paris : Gallimard, 1998, p. 452-458). (« Ceux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses, et formaient l’enfance des hommes proprement ; et comme nous avons joint à leurs connaissances l’expérience des siècles qui les ont suivis, c’est en nous que l’on peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres » - p. 456-457). Mais le dogme, confronté à l’accumulation des « expériences », notamment avec la découverte et l’exploration des « nouveaux mondes », intangible au temps d’enfance du comparatisme qu’était l’époque de Pascal, est devenu, lui aussi, sujet d’« expérience ». La considération de la matière selon ses propres lois suscite un mode d’intellection spécifique qui comprendra dans son champ, graduellement, insensiblement ou délibérément, ce qui relève de l’argument d’autorité : l’homme et sa théologie.
Maintenant, comment ce cœur de croyances, aujourd’hui obsolètes, qui s’est spectaculairement exprimé dans l’architecture de ce monument devenu patrimoine, a-t-il pu porter, accompagner ou signifier l’identité de l’Europe, lui ayant permis de s’exporter sur le monde ?
Pour considérer ce qui fait la spécificité (et qui a fait le succès) du christianisme dans l’éventail des religions, il faut (aussi) remonter aux origines. Le christianisme fait partie des croyances en rupture avec les rites néolithiques qui s’expriment dans les cultes de fécondité. Ce désenchantement de l’espèce peut être mis en rapport avec les limites démographiques de la transition néolithique (voir : « Le Christ et le mock-king : Notes pour une lecture anthropologique de la Passion »). Dans un monde saturé d’hommes et limité en ressources, les rites de renouveau qui exaltent la fécondité naturelle laissent les déshérités à leur sort. Cette désaffection des valeurs de vie s’exprime spectaculairement dans l’assimilation du croyant au sort ignominieux du Christ dont le calvaire sauve l’humanité de son destin de nature, la Passion pouvant se décrire comme un rite néolithique inversé. Le christianisme excepte l’homme du monde de la génération et de la corruption et soumet les cycles de la nature à sa loi. De Noël aux saints guérisseurs, les fêtes et les recours païens deviennent des médiations sur lesquelles se superposent des rites chrétiens. Dans une nature désacralisée, les rites néolithiques sont couverts du sceau de la modération. C’est, commente Alphonse Dupront, « l’acceptation d’un patrimoine humain traditionnel » dont les cultes ont été « disciplinés par l’Église », telles « les processions des frais matins des Rogations, à la fois vie de l’air et de la terre emmêlés » (« Puissances et latences de la religion catholique », Le Débat, 1980/5, n° 5, p. 12). Discipline et mesure sont les mots significatifs, quand les rites de fécondité célèbrent la démesure pour induire le retour des cycles naturels.
Cette émancipation religieuse du cycle agricole porte en puissance une conversion idéologique majeure puisque, brisant le cercle des recommencements, l’« éternel retour », et soldant la « religion néolithique », elle ouvre le monde et l’histoire. Économie du salut contre économie de la reproduction, elle prêche aux exclus qu’il existe une voie de rédemption. La question de la contagion de la nouvelle foi est posée. Le Christ n’est pas un dieu agricole, c’est un dieu urbain, un dieu des bas-fonds. Tacite (XV, 44) rapporte, à propos de l'incendie de Rome, que, parmi la lie de la plèbe romaine, les chrétiens apparaissaient comme des boucs-émissaires désignés et donne une information indirecte sur leur statut social. Mais comment comprendre que ce message fait de ressentiment (et de prophétique espérance) ait pu parler aux puissants jusqu’à devenir une religion officielle ?
Sans doute le message chrétien, en effet, avec son annonce du royaume céleste, doit-il être compris comme une contemption des valeurs d'ici-bas (cf. sa conception pessimiste du temps individuel : omnia vulnerant, ultima necat, peut-on lire au clocher des églises), mais ce procès contient en réalité une leçon de pondération et, en dernier ressort, d'administration des choses (voir : « Note sur le destin marial du prêtre »). Comme le rappelle Peter Brown dans une conférence sur les idées de Gibbon précédemment citée (Daedalus, n° 105, 1976, p. 73-88 « Gibbon's Views on Culture and Society in the Fitfh and Sixth Centuries ») : The rise of the Christian church is the story of the rise to great power in this world of an institution whose basis was a claim to be interested only in the other world (« L'essor de l'Église chrétienne est l'histoire de la réussite dans ce monde d'une institution bâtie sur l'allégation de ne s'intéresser qu'à l'autre monde » - p. 79). Cette « mystification » deux fois millénaire n'en est évidemment pas une, le dogme chrétien mythifiant mystiquement, en réalité, l'organisation sociale de la société stratifiée : monogamie, concurrence, travail… Le monde n’a pas « changé de base », il s’est trouvé une interprétation plus performante. Aux termes de ce nouveau contrat du créateur avec ses créatures, illustré par le sacrifice de son Fils, l’ascèse terrestre, propédeutique à la vie future est conforme à l’optimum démographique et à la performance sociale.
La morale chrétienne ne révolutionne pas la morale sexuelle. Elle rencontre les principes de vie des stoïciens et des néoplatoniciens. Le christianisme apparaît comme une eschatologie orientale greffée sur le positivisme du droit romain. Loin d’en contredire le message, cette greffe en sublime le propos. La réussite de son prosélytisme tient dans son assomption des valeurs matrimoniales dominantes. En leur conférant un modèle théologique, elle en rationalise la mise en œuvre. Le code en cause, c'est celui du mariage romain, en réalité, tel que représenté sur les sarcophages où l'on voit l'épouse en majesté à son côté de son conjoint. Cette morale sexuelle, concordia faite d'égalité, est juridiquement romaine avant d'être stoïcienne, puis chrétienne. Les individus ainsi représentés sont des pairs et l'image de leur couple exprime une relation d'égalité entre les familles (qu'exprime la pratique de la dot). C'est ce type « société de mariage » qui est idéalisé dans Les préceptes de mariage de Plutarque, composés vers l'an 100, prônant l'égalité juridique des conjoints – dans leur différence et sous la tutelle de l'époux – égalité économique et morale, l'union des corps étant l'image de la fusion des biens. Le mariage étant ici le support juridique de la transmission du patrimoine.
La transition néolithique a pour caractère la concurrence pour les terres fertiles et amorce un processus de stratification sociale, spécialisation et hiérarchisation, soit : une exclusion verticale, juridique, qui produit des dépendants et une exclusion horizontale, géographique, qui pousse à l’émigration… En Eurasie, l’appropriation des terres inspire des systèmes de parenté de type descriptif, ou à propriétés descriptives, qui distinguent les unités domestiques et qui promeuvent l’héritage vertical (divers développements sur la stratification sociale : passim). Le christianisme apporte un sens nouveau à une institution profane essentielle à la reproduction des sociétés stratifiées : le mariage. L'organisation des sociétés stratifiées, tant anciennes que modernes, repose, à la différence des sociétés à parenté classificatoire, sur la compétition économique et sociale et c'est ce qui explique, pour une part essentielle, le succès planétaire de ce plan de vie. Au fond, « porter la bonne parole » (voir : « Que signifie "Porter la bonne parole" ? Mission et colonisation »), c'est diffuser la martingale qui permet de prospérer en société stratifiée. En l'espèce, la leçon de morale commune du missionnaire touche à l'ascèse sexuelle. Elle définit une norme matrimoniale exprimée par la monogamie et le contrôle des naissances. Le pape François vient d'ailleurs, le 20 janvier 2015, d'en rappeler la substance en déclarant que les bons catholiques n'étaient pas des lapins (« Certains pensent, excusez-moi du terme, que pour être de bons catholiques, il faut se comporter comme des lapins, mais ce n'est pas le cas »). En réalité, cette norme répond à des contraintes économiques et successorales. La « paternité responsable » prend en compte le coût de l'éducation des enfants, mais aussi la consistance de la transmission générationnelle. On voit donc apparaître dans la métaphysique anti-naturelle évoquée des nécessités matérielles. Ce qui constitue, pour les occidentaux, des évidences culturelles : l'appropriation individuelle et la transmission de son bien à ses enfants ne sont nullement des pratiques universelles. Le système de parenté, les formes du mariage et la structure de la famille sont adaptés au mode d'exploitation des terres. Dans les sociétés stratifiées, il y a propriété individuelle alors que la propriété est collective dans les sociétés homogènes. Cette contrainte – cet idéal – de la transmission des biens à l'identique en ligne descendante entraîne un certain nombre de règles juridiques et de règles de conduite, un droit et une morale (voir : « Transmettre le patrimoine génétique, transmettre le patrimoine économique : paradoxes de la reproduction ») : - le nombre des héritiers est nécessairement mesuré : ce qui implique un contrôle des naissances et l'observation de principes de dévolution limitant le partage du patrimoine parental ;
- alors que la polygynie multiplie les bras et la descendance, la monogamie caractérise cette unité de production qui se transmet au fil des générations ; - la production d'héritiers légitimes engage également : virginité des filles et fidélité des femmes, soit diverses formes d'abstinence sexuelle.
Contrôle des naissances et monogamie caractérisent ainsi l'unité domestique des sociétés où les gens « ont du bien ». Ce que nous identifions comme la « morale chrétienne » se révèle être aussi, et peut-être d'abord, un mode de reproduction patrimonial. Ces préceptes de « morale bourgeoise », comme on dit aussi, sont en réalité caractéristiques des sociétés stratifiées où la différenciation sociale est constitutive, comme il a été rappelé. Voici ce qu'écrit Hésiode, précédemment cité, huit siècles avant l’ère chrétienne : « Travaille pour toi, ta femme et tes enfants, n’aie jamais à mendier ton pain à un voisin » (Travaux, v. 399-400), « Alors tu achèteras le patrimoine d’autrui au lieu de vendre le tien » - v. 341), Hésiode, ennemi de la guerre et ami de la concurrence : « Le potier en veut au potier, le charpentier au charpentier, le pauvre est jaloux du pauvre et le chanteur du chanteur », « cette lutte-là est bonne aux mortels » (v. 23-26). Dans les termes de cette vision du monde où l’Émulation, seule (qui « éveille au travail même l’homme au bras indolent » - v. 20, qui se réalise dans la justice et qui fait prospérer le bien) – et non la guerre –, est « profitable aux humains », la transmission du patrimoine est le premier souci : « Puisses-tu n’avoir qu’un fils pour nourrir le bien paternel, conseille Hésiode, […] et mourir vieux en laissant ton fils à ta place » (ibid., v. 375-378). La transmission de cette unité économique à l’identique en ligne descendante (« Ayez d’abord une maison, une femme et un bœuf de labour », recommande Hésiode, avec « tous les instruments qu’il faut, afin de ne pas avoir à les demander à un autre » - ibid., v. 405-408) entraîne des règles de droit et des règles de comportement. De même, le substrat juridique de la société de Jésus est celui d’une société inégalitaire. Hégésippe, écrivain chrétien du IIe siècle dont l’histoire et les écrits nous sont principalement connus par ce qu’en rapporte Eusèbe de Césarée dans son Histoire ecclésiastique (XX, 265 - 339) rapporte : «?Il y avait encore de la race du Sauveur les petits-fils de Jude qui lui-même était appelé son frère selon la chair. On les dénonça comme descendants de David. L’evocatus (= grade militaire d’un vétéran) les amena à Domitien; celui-ci craignait la venue du Christ, comme Hérode. L’empereur leur demanda s’ils étaient de la race de David; ils l’avouèrent; il s’enquit alors de leurs biens et de leur fortune : ils dirent qu’ils ne possédaient ensemble l’un et l’autre que neuf mille deniers, dont chacun avait la moitié ; ils ajoutèrent qu’ils n’avaient pas cette somme en numéraire, mais qu’elle était l’évaluation d’une terre de trente-neuf plèthres, pour laquelle ils payaient l’impôt et qu’ils cultivaient pour vivre ». La charité chrétienne prend le relais d’une parenté restreinte à l’unité domestique.
Le christianisme n'est évidemment pas la seule doctrine à enseigner les vertus du système eskimo (puisque c'est ainsi qu'on dénomme en anthropologie la nomenclature de parenté européenne) (voir : « Roberto de Nobili et la querelle des rites Malabares » in fine). Fondant l'unité domestique sur des préceptes saints, la supériorité historique du christianisme tiendrait dans sa philosophie de la mesure (de l’inversion des rites néolithiques à leur domestication). Cette utopie se révèle ainsi le médium le mieux adapté pour assumer cette transformation sociétale en quoi consiste le passage du « communisme » primitif à l'individualisme économique (de la parenté classificatoire à la parenté descriptive).
Concernant le destin propre de l’Europe, c’est bien cette Europe chrétienne, avec sa logistique morale et juridique, qui va s’exporter dans une aventure qui associe l’intérêt et la religion. La confrontation avec les autres civilisations met en évidence trois caractères de l’Europe : 1°) un mode d’organisation sociale propre qui se résume dans une conception restrictive de la parenté et dont les missionnaires sont les instructeurs (voir : « Que signifie… ») ; 2°) un état d’esprit porté sur le calcul économique (saint François-Xavier s’élèvera contre « ceux qui inventent quantité de modes de temps et de participes à ce malheureux verbe rapio, rapis » - lettre écrite de Cochin le 27 janvier 1545) et caractérisé par une conception de la vie terrestre conçue comme un accomplissement ; 3°) une mobilisation des « arts mécaniques », qui correspond à l’essor des sciences depuis la Renaissance et à l’accumulation des « expériences » visée par Pascal.
Ce concours de caractères s’illustre matériellement dans l’aventure de la navigation : esprit de découverte et capacités navales associés fondent l’expansion européenne. Nécessité, pression démographique, espoir d’un monde meilleur, mélange d’intérêt et de passion missionnaire (le « roi épicier », comme on l’a surnommé, Manoel, était aussi animé d’intentions politiques et religieuses) composent cet esprit d’aventure où puissance militaire, stratégie commerciale et prosélytisme sont liés. Les Découvertes offrent ainsi à la convoitise et à la curiosité d’une Europe chrétienne sécularisée un champ d’exploration et d’exploitation inouï. Par rapport aux économies asiatiques, suffisantes, cette frénésie, « ivresse maritime » associée à « l’idée de fortune » et de conquête, singularise une Europe économiquement en retard qui va enrôler les « arts mécaniques » dans sa quête de profits et de biens.
Le « pionnier » que Tocqueville voit à l’œuvre en Amérique (voir : « L'invention néolithique ou : le triomphe des “fermiers” ») « qui s’enfonce dans les déserts du Nouveau Monde avec la Bible, une hache et des journaux » (De la démocratie en Amérique, 1848, tome 2, p. 227) est « le représentant d'une race à laquelle l'avenir du Nouveau Monde appartient, race inquiète, raisonnante et aventureuse qui fait froidement ce que l'ardeur seule des passions explique, qui trafique de tout sans excepter même la morale et la religion » (Voyage en Amérique [1831] 1991, Paris : Gallimard, édition de la Pléïade, I, p. 373). « Sur ses traits sillonnés par les soins de la vie règne un air d'intelligence pratique, de froide et persévérante énergie qui frappe au premier abord » (id., p. 372). Dans une lettre à Chabrol, datée du 10 juin 1831, Tocqueville décrit ainsi, après avoir constaté qu'en Amérique « l'intérêt particulier n'est jamais contraire à l'intérêt général », « les deux caractères saillants qui distinguent ce peuple-ci […] : l'esprit industriel et l'inquiétude de l'esprit ». L'inquiétude : on peut dire le processus de différenciation qui est à l'origine de la stratification sociale et qui l'entretient. L’intérêt, la curiosité (uneasiness, l’absence d’aise, diagnostiquait le philosophe John Locke) et la conscience d’un monde ouvert produisent et mobilisent des artéfacts inédits. La science, descendue, selon le mot de Bergson, « du ciel sur la terre sur le plan incliné de Galilée » (L’évolution créatrice, Paris : Félix Algan, 1908, p. 362) met le monde matériel à portée…
Même si l’aventure scientifique prend l’exact contre-pied de l’Ecclésiaste, comme le souligne ironiquement Rimbaud en 1873 : « Rien n’est vanité ; à la science et en avant ! crie l’Ecclésiaste moderne, c’est-à-dire Tout le monde » (« Une saison en Enfer », Œuvres de Arthur Rimbaud, Paris : Mercure de France, 1924, p. 302), c’est un monde civilement christianisé qui lui donne corps, laissant les questions métaphysiques en arrière-plan pour ne s’intéresser qu’à l’expérience et au monde matériel. La notion de « progrès », qui résume le dogme de la modernité et qui anticipe un futur radieux, a une origine religieuse (voir, p. ex. : « Penser la régularité : la forme et le temps dans la société traditionnelle » in fine). A l’opposé de la circularité de l’éternel retour, l’idée de progrès a pour motif la conception chrétienne de la Parousie, seconde venue du Christ sur terre. Mais, le train du progrès, nourri par « l’expérience des siècles » (où Pascal voyait l’antiquité et l’autorité du temps présent), étant d’évidence plus matériel que moral, c’est une espérance terrestre qu’il se trouve, de fait, satisfaire. Le millénarisme est supplanté par le consumérisme. Pour la tradition, la vie humaine est un passage, « le temps est court » et l’on produit pour vivre dans l’attente d’un au-delà rédempteur. Le moderne jette toute sa foi, lui, dans la vie présente et le seul futur auquel il concède croire et devoir des comptes, un futur nécessairement hédoniste, est celui que lui accommode le crédit (credere) (voir : « Média-langue et culture-jeunesse, distance réfractaire et période réfractaire (3) » in fine). Le miracle de la modernité, c'est de faire du temps, non pas un opérateur de dégradation, mais un facteur de progrès, d’optimisme et d’optimisation. C’était la formule de Francis Bacon : « Le Temps, voilà le grand innovateur » (1625, Of Innovations). Le temps exhausse inexorablement le savoir et l’émancipe de cette « philosophie chrétienne » qu’Étienne Gilson définissait ainsi : « J’appelle philosophie chrétienne toute philosophie qui bien que distinguant formellement les deux ordres [la raison et la foi] considère la révélation chrétienne comme un auxiliaire indispensable de la raison » (L'esprit de la philosophie médiévale, Paris : Vrin, 1932, op. cit., p. 39). L'intérêt matériel met le sujet au centre des valeurs, consacre la primauté de l'individu sur la communauté et enrôle la transcendance dans l'aventure économique. Il faut une religion réformée pour prendre en charge ce nouvel acteur de l’histoire. Produit du chrétien réformé, homo liberalis est ce chrétien sans le savoir, croyant d’un futur mondain où le patrimoine tient lieu de conscience.
L'humanité de synthèse (la réunification de la famille humaine) n'est pas pour demain. C'est le versant "conservateur" de ce dossier.
L'édition de 1961 du Grand Larousse encyclopédique en dix volumes développe, au terme "Eugénésie", l'argumentation suivante : "Nom donné par Broca au croisement entre races différentes et dont les produits sont indéfiniment féconds [...] c'est le cas dans le genre humain [...] et l'on a vu là un argument en faveur de l'unité de l'espèce humaine. Mais l'eugénésie n'a pas été rigoureusement démontrée pour les produits issus de deux races très éloignées, comme le Blanc et le Papou, et il semble qu'elle n'existe réellement qu'entre les différentes variétés d'une même race". Un acquis des "trente glorieuses" (pour en rester à l'espace hexagonal qui constitue le "terrain" de cette enquête) et non le moindre, est probablement d'avoir démontré l'unité de l'espèce en dépit des pseudo-spéciations que sont les religions et les cultures. Minoritaires, certes, et emblématiques souvent, ces unions formées par la rencontre des hommes ont pourtant radicalement changé le visage des villes européennes. Ce qui nous paraît aujourd'hui parfaitement banal (à tout le moins insignifiant) est probablement ce qui étonnerait le plus un observateur d'hier. C'est le versant "progressiste" de ce dossier.
Cette tension entre les restrictions culturelles (ou pseudo-spécifiques) de la reconnaissance avec ses formes, par hypothèse, naturelles nourrit les débats et les engagements de la période concernée. Elle informe la matière de cette discussion dont la documentation provient, pour l'essentiel, des archives de la presse écrite et de celles de l'Institut National de l'Audiovisel. Les conclusions de cette investigation dans le temps court de la société française de l'après-guerre sont banales et on espère que leur mise en situation pour la période et l'espace concernés n'est pas inutile. La configuration de contact des cultures considérée confirme en effet :
 - que "l'homme est un loup pour l'homme" dès lors que l’accumulation est possible et qu’elle revêt un sens (la nécropole de chasseurs collecteurs stockeurs de graminées sauvages de Jebel Sahaba, en Nubie – c. 8000 – témoigne d’un nombre important de morts consécutives à un conflit armé, les squelettes portant des traces de pointes de flèche ou de sagaie) ; - que "l'homme est un loup pour l'homme" dès lors que l’accumulation est possible et qu’elle revêt un sens (la nécropole de chasseurs collecteurs stockeurs de graminées sauvages de Jebel Sahaba, en Nubie – c. 8000 – témoigne d’un nombre important de morts consécutives à un conflit armé, les squelettes portant des traces de pointes de flèche ou de sagaie) ;
 - que la généralité des dispositifs culturels de dominance et d'exploitation du semblable se justifie d'une appartenance collective entretenue par un réseau de parenté où l'économique et le matrimonial collaborent ; - que la généralité des dispositifs culturels de dominance et d'exploitation du semblable se justifie d'une appartenance collective entretenue par un réseau de parenté où l'économique et le matrimonial collaborent ;
 - que les cultures sont des systèmes de restriction de la reconnaissance prospérant sur la dévalorisation de l'autre homme ; - que les cultures sont des systèmes de restriction de la reconnaissance prospérant sur la dévalorisation de l'autre homme ;
 - que l'acceptation de l'autre homme est évidemment fonction de son utilité ; - que l'acceptation de l'autre homme est évidemment fonction de son utilité ;
mais aussi :
 - qu'aux marges des exclusivismes culturels se découvre une plasticité de la reconnaissance du semblable qui révèle la "nature humaine" naturellement "œcuménique" et naturellement une ; - qu'aux marges des exclusivismes culturels se découvre une plasticité de la reconnaissance du semblable qui révèle la "nature humaine" naturellement "œcuménique" et naturellement une ;
 - que l'homme est un être paisible et amical, comme tend à le montrer l'existence de dispositifs universels d'approche du semblable et de pacification et que c'est probablement la curiosité, cette disposition juvénile, qui, entretenant les échanges, a empêché la spéciation visée plus haut. - que l'homme est un être paisible et amical, comme tend à le montrer l'existence de dispositifs universels d'approche du semblable et de pacification et que c'est probablement la curiosité, cette disposition juvénile, qui, entretenant les échanges, a empêché la spéciation visée plus haut.
Deux cas de figure principaux dans le registre de cette confrontation des cultures (quelques exemples, réduits à une épure sommaire, pris hors du champ européen, matière du dossier présenté) :
 - c'est, argumenté en religion et naturalisé dans un système de castes qui repose sur la naissance et se perpétue par endogamie (la partition fonctionnelle des "états", varna, renvoie à la "couleur" et les "deux fois nés" sont en réalité ceux qui ont "quatre quartiers"), la domination des populations locales par des envahisseurs Arya en Inde ; l'assujettissement féodal des autochtones par des immigrants arabisés imposant leur tutelle grâce à la possession d'une "magie supérieure" dans le sud-est malgache (vide infra : Zafimahavita, Contribution à l’ethnographie d’un village du sud-est malgache : sur le “choc des cultures” ; l'hégémonie commerciale et matérielle d'immigrants chinois dans le Pacifique ; ou c'est la maîtrise économique d'immigrants Indo-pakistanais constitués en pseudo-caste dans les sociétés créoles et en Afrique orientale, monopolisant la collecte des productions de rente et imposant leurs conditions à des populations vulnérables, etc. ; - c'est, argumenté en religion et naturalisé dans un système de castes qui repose sur la naissance et se perpétue par endogamie (la partition fonctionnelle des "états", varna, renvoie à la "couleur" et les "deux fois nés" sont en réalité ceux qui ont "quatre quartiers"), la domination des populations locales par des envahisseurs Arya en Inde ; l'assujettissement féodal des autochtones par des immigrants arabisés imposant leur tutelle grâce à la possession d'une "magie supérieure" dans le sud-est malgache (vide infra : Zafimahavita, Contribution à l’ethnographie d’un village du sud-est malgache : sur le “choc des cultures” ; l'hégémonie commerciale et matérielle d'immigrants chinois dans le Pacifique ; ou c'est la maîtrise économique d'immigrants Indo-pakistanais constitués en pseudo-caste dans les sociétés créoles et en Afrique orientale, monopolisant la collecte des productions de rente et imposant leurs conditions à des populations vulnérables, etc. ;
mais c'est aussi :
 - l'adaptation et le métissage, quand les moyens de la fermeture, de la reproduction de l'identité ou de la domination font défaut, cette nécessaire intégration engageant un processus de créolisation. - l'adaptation et le métissage, quand les moyens de la fermeture, de la reproduction de l'identité ou de la domination font défaut, cette nécessaire intégration engageant un processus de créolisation.
Les identités, titres de méconnaissance du semblable, exploitent ou assujetissent dès qu'elles en ont les moyens – et déprécient toujours. Pas d'identité sans culture de la différence. À la stigmatisation du dominant répond d'ailleurs, logiquement, la contre-stigmatisation du dominé. Hannah Arendt (1973 : 11) note que l'étude de Jakob Katz sur les relations entre juifs et non-juifs au Moyen Âge (1962), révélant une tradition juive "d'hostilité souvent violente à l'égard des chrétiens et de non-juifs", suscita l'indignation et un sincère étonnement, tant les porte-paroles de l'historiographie juive étaient persuadés – et avaient persuadé les juifs – que le judaïsme "croyait à l'égalité entre les hommes".
"A cette époque [entre 1860 et 1870] même les juifs érudits tenaient sincèrement que le judaïsme n'avait jamais rien prêché d'autre qu'une éthique universelle. Quand les antisémites "scientifiques" des années 1880 découvrirent et publièrent des textes des anciennes autorités juives sur lesquels s'appuya la première forme d'antisémitisme, le pûblic juif en général fut non seulement scandalisé mais éperdu d'étonnement… Lors même qu'on eût supprimé toutes les inexactitudes de ces citations brandies par leurs ennemis, les juifs eurent bien du mal à se reconnaître dans ces enseignements qu'ils ne soupçonnaient guère" (Exclusion et tolérance, chrétiens et juifs du Moyen Age à l'ère des Lumières, trad. fr., Paris : Lieu Commun, 1987, p. 254-255).
Au-delà des déclinaisons contextuelles et des adaptations, c'est le culte de la continuité identitaire qui frappe, le besoin de se relier à l'origine, justifiant l'entretien de ces dispositifs de différenciation, perçus comme autant de moyens de persévérer dans son être. A l'instar de la barque de Thésée de l'exemple platonicien (elle est si vieille que toutes les planches en ont été changées et qu'il ne reste rien de la barque originelle supposée avoir servi à l'expédition en Crète), ce peut être la foi du souvenir qui fait loi, commandant le radoub et les ajustements. Imaginée mais première, la matrice originelle se perpétue ainsi dans les diaspora. Opératrice de la socialisation, elle paraît coextensive à la cœnesthésie individuelle et à la saisie du monde. Il est commun de constater que, lorsqu'il s'insère dans un autre système économique pour y trouver des ressources que sa propre économie ne produit pas, l'immigré investit celles-ci, non pas dans le système hôte mais dans celui d'où il tire ses valeurs. Le villageois comorien (pour prendre des exemples plus proches) devenu préposé des postes ou agent d'entretien en France va investir ses revenus dans un "grand mariage", cérémonie qui lui permet de prendre rang parmi les notables de sa société ; le bénéficiaire réunionnais du RMI, le cas échéant, dans un "service malgache" (vide infra : Madagascar-Réunion : Éléments de comparaison sur la représentation de l'ancestralité), cérémonie dédiée aux ancêtres, annexant les bienfaits de l'"État providence" ("l'argent Bon Dieu") à la fidélité communautaire ; le commerçant "zarab" de la Réunion dans le financement de mosquées ou d'écoles coraniques pakistanaises (vide infra : Vingt ans après, 2ième partie)... Comment pourrait-il en aller autrement s'il existe, comme pour l'acquisition de la faculté de parole, une période sensible au-delà de laquelle les fondamentaux de l'identité (quels que puissent être les aggiornamenti et les pétitions de bonne volonté) ne seraient plus modifiables ? Nous sommes des génies linguistiques à trois ans, nous devenons des infirmes linguistiques à la puberté. Le cas – discuté – des "enfants sauvages" et celui d'enfants privés de l'écoute normale du langage, confirmant l'existence d'un seuil temporel – aux environs de la septième année – au-delà duquel l'apprentissage d'une grammaire devient impossible, démontre la nécessité d'un modèle humain permettant à l'enfant de catégoriser les sons de parole et les flexions de langue mais aussi la valeur idéalement définitive de cette fixation. Il y a un temps pour apprendre et un temps pour ne plus apprendre, pour tout savoir (verrouillage commandé par le gène NgR1). La sensibilité, qui nous fait réceptifs aux mœurs de notre société nous fait aussi captifs de ces mœurs. "L'âme à l'état originel, écrit Ibn Khaldun, est prête à recevoir n'importe quelle influence, bonne ou mauvaise. Comme le dit Mohammed, le Prophète : 'Tout enfant naît à l'état naturel. Ce sont ses parents qui font de lui, un Juif, un Chrétien ou un Mazdéen'". (Discours sur l'histoire universelle) Cette naissance à la société, qui ferme la communauté des croyants en espèce (l'endogamie, à la manière d'une barrière d'espèce, y est généralement de rigueur) et qui fige l'état-civil en destin, justifiant le réalisme de cette observation proverbiale africaine : "Même quand il est devenu riche, le chien continue de manger des excréments", constitue évidemment le nœud gordien du problème – une cure de valproate (C8H15O2Na), peut-être ?… Les véritables "armes de destruction massive" – les introuvables Weapons of Mass Destruction – sont mentales, on le sait. Elles sont fabriquées – entre autres – dans ces écoles coraniques où l'on apprend à lire aux enfants en leur faisant épeler le mot djihad. "Les religions sont responsables des guerres" proclame un graffito ici commenté... Lors de la première guerre du Golfe, précisément, on a vu les clercs divisés selon leur appartenance culturelle. Même s'ils ont partagé les bancs des mêmes universités, intellectuels musulmans et intellectuels occidentaux se sont révélés irréconciliables. Tout ce que le Quartier Latin compte d'intelligence n'a pu convaincre les collègues musulmans du bien-fondé du requerimiento contre Saddam Hussein (« Une guerre requise », Libération du 21 février 1991, signé par : A. Finkielkraut, E. de Fontenay, J.-F. Lyotard, J. Rogozinski,. K. Ryjiik, D. Sallenave, P.-A. Taguieff, A. Touraine ; assemblées sur les sites universitaires, notamment à la Maison des Sciences de l'Homme, Bd Raspail, pour la période concernée, etc.). « Busherie » et « Saddam le bourreau » dos à dos.
« Lon dict que l'autre et principalle cause de sedition est la religion : chose fort estrange et presque incroyable ».
« C'est follie d'esperer paix, repos et amitie entre les personnes qui sont de diverses religions […] Les Juifz ont estime toutes autres nations comme estrangiers, et entierement les autres nations ont eu semblable oppinion des Juifz. Je laisse les Machometistes qui nous ont toujiours representez leurs ennemys, et nous eux […] Nous l'experimentons aujourdhui que deux François et Anglois qui sont d'une mesme religion, ont plus d'affection et d'amitié entre eux que deux citoyens d'une mesme ville, sujets à un même seigneur, qui seroyent de diverses religions, tellement que la conjonction de la religion est plus grande et lointaine que nulle autres. C'est ce qui separe le pere du fils, le frere du frere, le mary de la femme. […] La division des langues ne fait la séparation des royaumes, mais celle de la religion et des loix, qui d'un royaume en faict deux. De là sort le vieil proverbe : Une Foy, une Loy, un Roy… » (Michel de L'Hospital, La harangue faite par Monseigneur de Lospital en la presence du Roy, ledict seigneur tenant ses grans estatz en sa ville d'Orleans, au moys de janvier mil cinq cens soixante et ung, Paris, 1562, p. 15-18)
Le jeu, dans les rouages qui reproduisent cette nécessité, est donc limité – et contrôlé. Mais il suffit qu'il existe. La laïcité serait ainsi cette utopie qui offrirait au petit d'homme une forme paradigmatique commune à tous les hommes et qui lui apprendrait sa culture régionale (son isolat) comme une langue seconde. Ce qui protègerait du parti à quoi chacun adhère en son for intérieur : l'intime sentiment de sa différence et l'intime conviction de sa supériorité. Lorsqu'on mesure l'envol du progrès technique à l'absence de progrès moral, on doit bien conclure que la résistance à la reconstitution de la famille humaine a aussi pour principe de telles fermetures apprises dès l'enfance. Justifiée dans une écologie d'isolats, cette adaptation est en contradiction avec l'urbanité du village planétaire. Un apparent paradoxe des ces pages tient dans le fait que l'œuvre morale serait contenue dans les dispositifs innés de reconnaissance du semblable, la nature faisant la leçon à la culture (les processus naturels en cause étant eux-mêmes passibles d'une biochronologie qui en limite les effets).
La succession des intitulés des différentes pages indique l'ouverture du champ exploré dans ce dessein de circonscrire les principaux dispositifs de reconnaissance, le fil conducteur étant offert par les situations conflictuelles et les débats concernant l'immigration en France dans les années quatre-vingt, qui héritent des "trente glorieuses" et qui ouvrent ce que l'on nommera ici, par opposition, les "trente pleureuses". L'assemblage proposé, à la couture assez lâche, a d'abord pour objet de manifester la coexistence – et l'éventuelle relation de nécessité – de l'"idéel" et du "matériel". Le caractère répétitif de cette documentation – son rabâchage – privément répulsif – en signale l'intérêt pour une recherche d'invariants. Celle-ci se distribue sur deux versants opposés : celui de motions de fermeture, associées à la saisie corrélée de l'identité et de l'écosystème et justifiant un exclusivisme propriétaire, aussi bien rituel que matériel ; celui de motions d'ouverture, associées aux dispositifs spécifiques de reconnaissance. Le propos n'est pas de pointer les contradictions ou les aveuglements, mais de reconnaître les processus à l'œuvre dans ce "scénario" proposé par l'histoire récente. Le constat – le problème – étant qu'homo sapiens, programmé pour "absorber", sur le mode de l'empreinte, son environnement premier se révèle largement réfractaire à toute nouvelle empreinte, alors, pourtant, que la plasticité culturelle, à tout le moins la pulsation diastolique et systolique qu'il met en œuvre quand nécessité fait loi, s'avèrent plus que jamais requises dans un monde "globalisé".
Plan du dossier :
19.11 "Et ta sœur !" Différence des sexes et territorialité : relevé des grafitti de la Sorbonne, mars 1982
19.2 Variations sur le prochain
19.3 Quand la théorie de la société est la théorie du marché
19.4 Les "30 glorieuses" et les 30 pleureuses
19.5 De Tati à Tati
19.6 Gradations dans l'expression de l'allophobie et dans son aveu
19.7 Territoire, proxémie, proximité : le proche et le lointain
19.8 Appartenance commune
19.9 Guetteurs au créneau
20.1 Othello, ou la tragédie de l'apparence
20.2 Phénotypes et stratification sociale : la naturalisation du droit
21.1 L'empire de la liberté : la techno-structure par l'exemple, neutralisation des fonctions et des genres
21.2 Loi du renouvellement technique et conséquences...
21.3 Hormones et territorialité : la dominance à l'épreuve de la valeur morale de la différence
21.4 L'individu, sentinelle avancée de l'espèce (1) : liaisons
21.5 L'individu, sentinelle avancée de l'espèce (2) : déliaisons
21.6 Logique du vivant, morale du vivant
21.7 Médialangue et culture-jeunesse, distance réfractaire et période réfractaire
"La vis conjugue le cercle et la ligne", remarque Héraclite (frag. 59) : s'il est possible d'associer le mouvement circulaire et le mouvement rectiligne, l'objet est donc d'interroger quelques évolutions de la moralité et du droit et de servir ainsi la quête buissonnière d'invariants qui anime cette recherche.
Le nerf de la guerre
"Le ventre [...] emplit l'histoire." (Victor Hugo)
Parmi les données censurées par les idéaux de la modernité, en effet primaires mais aussi premières, celles qui concernent la symbolique de la dominance, trivialement sexuelle (ou matrimoniale). La guerre de Troie est ainsi réputée avoir une femme pour cause, l'enlèvement de l'épouse de Ménélas révélant un motif à la fois mythique et constitutif de l’alliance.

Girolamo di Benvenuto
Le Jugement de Pâris (vers 1500)

Poussin, L'enlèvement des Sabines (1637-1638)
L'enlèvement des Sabines répond, lui, au refus d'alliance opposé par les Sabins aux Romains. Ce rapt, échange unilatéral qui entraîne la rétorsion des pères et des frères bafoués :
"Ils sont vaincus, ces hôtes perfides, ces lâches ennemis; ils savent enfin qu'autre chose est d'enlever des jeunes filles, autre chose de combattre des hommes."
fait briller la tension qui sous-tend les tractations pacifiques dans les sociétés où les mariages sont "arrangés". L'alliance matrimoniale scelle la paix. C'est d'ailleurs l'"heureux dénouement" de l'enlèvement des Sabines, celles-ci s'interposant (infra) entre les combattants, devenus, de fait, des parents par ces unions consommées hors droit :
"Alors, les mêmes Sabines, dont l'enlèvement avait allumé la guerre [...] se jettent intrépidement, les cheveux épars et les vêtements en désordre, entre les deux armées [...] et s'adressant tantôt à leurs pères, tantôt à leurs époux, elles les conjurent de ne point se souiller du sang sacré pour eux, d'un beau-père ou d'un gendre [...] Si cette parenté, dont nous sommes les liens, si nos mariages vous sont odieux, tournez contre nous votre colère : nous la source de cette guerre, nous la cause des blessures et du massacre de nos époux et de nos pères, Nous aimons mieux périr que de vivre sans vous, veuves ou orphelines."
(Tite Live, Histoire Romaine - Livre I : Raptus Virginum)

Jacques-Louis David, L'enlèvement des Sabines (1799)
Agir se déclame emphatiquement par la maîtrise sexuelle et subir par la soumission sexuelle. En 468, Cimon bat les Perses sur l'Eurymédon : le soldat perse représenté sur ce vase à figures rouges dit : “Je suis Eurymédon. Je me penche en avant.” Les conflits de territorialité et de maîtrise se disent ainsi à travers les stéréotypes sexuels.
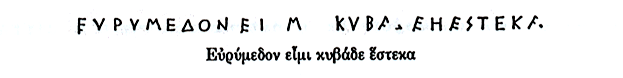
En 468, Cimon bat les Perses sur l'Eurymédon .
Le soldat perse représenté sur ce vase à figures rouges (v. 460) dit :
“Je suis Eurymédon. Je me penche en avant.”
(Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe)
Plan du dossier :
19.1 "Et ta sœur !" Différence des sexes et territorialité : relevé des grafitti de la Sorbonne, mars 1982
19.2 Variations sur le prochain
19.3 Quand la théorie de la société est la théorie du marché
19.4 Les "30 glorieuses" et les 30 pleureuses
19.5 De Tati à Tati
19.6 Gradations dans l'expression de l'allophobie et dans son aveu
19.7 Territoire, proxémie, proximité : le proche et le lointain
19.8 Appartenance commune
19.9 Guetteurs au créneau
20.1 Othello, ou la tragédie de l'apparence
20.2 Phénotypes et stratification sociale : la naturalisation du droit
21.1 L'empire de la liberté : la techno-structure par l'exemple, neutralisation des fonctions et des genres
21.2 Loi du renouvellement technique et conséquences...
21.3 Hormones et territorialité : la dominance à l'épreuve de la valeur morale de la différence
21.4 L'individu, sentinelle avancée de l'espèce (1) : liaisons
21.5 L'individu, sentinelle avancée de l'espèce (2) : déliaisons
21.6 Logique du vivant, morale du vivant
21.7 Médialangue et culture-jeunesse, distance réfractaire et période réfractaire
|
|
|