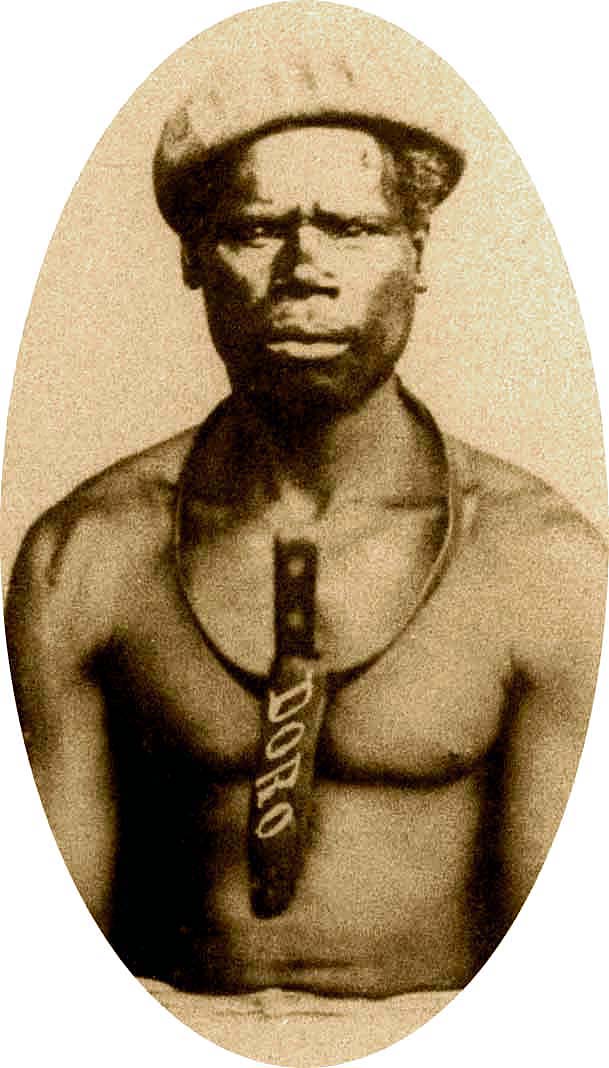|
Présentation du dossier pédagogique
Ancestralité, communauté, citoyenneté :
Les sociétés créoles dans la mondialisation
Le dossier est construit sur l'argument d'un séminaire de D.E.A. qui constituait une trame de recherche et un appel à contribution. La "feuille de route" proposée s'appuie, parallèlement à l'argumentaire, sur divers documents, dont des "notes de lecture", exposés ou contributions qui ont été mis en ligne (un certain nombre seront ajoutés) :
- Sucre blanc, misère noire : Le goût et le pouvoir, de Sidney Mintz.
- Des îles, des hommes, des langues, de Robert Chaudenson.
- Roots of language, de Derek Bickerton.
- Comment la parole vient aux enfants, de Bénédicte de Boysson-Bardies.
- Notes Jean Albany.
- Avant Babel, Génétique des populations et systématique des langues : hypothèses sur la langue mère.
- Introduction au débat de l'empirisme et de l'innéisme. D'un dialogue d'idées virtuel entre Leibniz et Locke : les Nouveaux essais sur l'entendement humain (1765).
- Introduction pour un "projet de recherche partagée" : Réunion, Maurice, Comores.
- Les langues régionales et d'Outre-mer, les textes essentiels du droit français ; Décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 1991 sur la notion de "peuple corse".
- Dossier de presse : La charte européenne des langues régionales (juin 1991).
- L'identité de l'identité. Les théories de l'identité et de l'ethnicité de Max Weber à Samuel Huntington : 1ère partie : l'exemple réunionnais. (Scan de notes de cours)
Ancestralité, communauté, citoyenneté :
Les sociétés créoles dans la mondialisation
(Séminaire de D.E.A.)
 On peut consulter sur le sujet (à la rubrique "anthropologie du droit" - voir page d'accueil) : On peut consulter sur le sujet (à la rubrique "anthropologie du droit" - voir page d'accueil) :
- “Le territoire de la langue”, communication à la séance plénière du colloque “Langues et Droits”, les 22, 23, 24 octobre 1998, Université de Paris X-Nanterre.
- “Habiter, cohabiter, vivre ensemble”, Alinéa, n°11, 2000.
- “Droit au sol et mythes d’autochtonie”, communication au colloque “Représentations de l’environnement et construction des territoires : Dialogue des disciplines ”, organisé par l’ICoTEM, Poitiers, les 11 et 12 octobre 2001.
 Pertinence scientifique du sujet ; adéquation avec la problématique régionale : Pertinence scientifique du sujet ; adéquation avec la problématique régionale :
L’appartenance à des communautés que la mondialisation fait de plus en plus larges – l’appartenance de la Réunion à l’Europe, par exemple –, met en évidence un conflit entre l’espace politique (la laïcité, le monde) et l’espace privé (la langue maternelle, la religion). Comprendre ce que signifie cette double allégeance, l’ouverture au monde et la revendication identitaire – que la modernité exacerbe en les représentant souvent comme contradictoires alors qu’elles sont complémentaires – c’est l’ambition du programme…
 Résultats attendus : Résultats attendus :
- Accéder à une représentation rationnelle des constituants de l’identité en plongeant dans la problématique des langues identitaires et des langues de communication (champ linguistique du projet : 1) grâce aux récents acquis de la neurologie et de la linguistique fondamentale.
- Mesurer les conséquences, juridiques et culturelles, du changement d’échelle lié à l’unification européenne en retournant à l’histoire de la Réunion et de l’Europe (champ sociologique du projet : 2), histoire et logiques identitaires affrontées, tels sont, sur les deux axes de recherche proposés, les résultats attendus.
1°)
 Contribution à la problématique des langues identitaires et des langues de communication Contribution à la problématique des langues identitaires et des langues de communication
 OBJET : L’ambition de cette première partie est la recherche d’outils susceptibles de formaliser une problématique spécifique aux langues régionales et aux créoles et de contribuer ainsi à la réflexion sur les questions identitaires associées aux revendications linguistiques. OBJET : L’ambition de cette première partie est la recherche d’outils susceptibles de formaliser une problématique spécifique aux langues régionales et aux créoles et de contribuer ainsi à la réflexion sur les questions identitaires associées aux revendications linguistiques.
Le responsable du programme a formalisé la théorie de cette approche dans une communication à la séance plénière du colloque international " Langues et droit " qui s’est tenu à l’université de Paris X en octobre 1998 (le texte de cette communication est annexé au présent document). Le programme a pour objet de développer cette problématique aux créoles et spécifiquement au Créole réunionnais.
 CHAMP ÉPISTÉMOLOGIQUE : Celui de la linguistique générale et de l’anthropologie cognitive. CHAMP ÉPISTÉMOLOGIQUE : Celui de la linguistique générale et de l’anthropologie cognitive.
 PROBLÉMATIQUE : Alors que la créolistique des créoles du français est essentiellement d’inspiration socio-linguistique et historique, il s’agit ici de rechercher, à l’aide des concepts de la linguistique générale, de la psychologie cognitive et de l’anthropologie, comment les acquis scientifiques récents de ces disciplines, concernant l’acquisition du langage chez l’enfant notamment, peuvent éclairer la genèse de la formation des langues et notamment celle des créoles. PROBLÉMATIQUE : Alors que la créolistique des créoles du français est essentiellement d’inspiration socio-linguistique et historique, il s’agit ici de rechercher, à l’aide des concepts de la linguistique générale, de la psychologie cognitive et de l’anthropologie, comment les acquis scientifiques récents de ces disciplines, concernant l’acquisition du langage chez l’enfant notamment, peuvent éclairer la genèse de la formation des langues et notamment celle des créoles.
Cette perspective fait apparaître, alors que la défense des langues régionales et des créoles est essentiellement identitaire, le caractère anthropologique, émotionnellement constitutif, des langues maternelles. Elle fonde en nécessité et valide scientifiquement une revendication qui n’est le plus souvent fondée que sur des arguments de nature réactive. L’approche neurocognitive met en effet en évidence le caractère modulaire des fonctions cérébrales et notamment l’opposition des " outils " que peuvent être les moyens de communication analytiques (mettant en œuvre des signes substitutifs) et les moyens de communication émotionnels (mettant en œuvre des signes participatifs). Cette opposition – classique – du digital et de l’analogique peut être mise à profit pour évaluer la part de la langue régionale et de l’identité régionale dans la conscience citoyenne. L’idée du programme n’est évidemment pas de se substituer à la production identitaire – parfaitement fondée au plan politique, mais qui n’a que peu à voir avec la recherche scientifique, même quand elle se donne pour telle – mais d’accéder à une représentation plus rationnelle des constituants de l’identité locale.
 PLAN DÉVELOPPÉ : PLAN DÉVELOPPÉ :
1°) Le champ théorique de la recherche : celui de l’anthropologie cognitive.
 A - Le problème de l’identité à la Réunion : (développement infra dans la 2° partie) A - Le problème de l’identité à la Réunion : (développement infra dans la 2° partie)
Les témoins cités :
Boucher, Lescouble, Houat, M.-A. Leblond, Albany
- Premier dossier : Étude de l’œuvre de M-A Leblond : des militants de l’identité réunionnaise (replacer dans le cadre historique).
- Cadre anthropologique de la recherche : la phénotypie des hiérarchies ou le “physique de l’emploi”
Quelques exemples
La noblesse française en représentation
Les Mbaya d’Amérique du sud
Ilotes et Spartiates
L’univers de Genji
Des fantômes sur les Hauts-plateaux
Hutu et Tutsi
Les Antemoro du sud-est de Madagascar
Le spectre des couleurs à la Réunion
- Permanence des types dans le métissage : les rites de démaillage à la Réunion
- Le matériau littéraire et l’anthropologie
- Premier dossier à étudier : Le Miracle de la race (1913)
Le destin de la couleur identifié au destin du rationalisme européen
La “ségrégation spontanée” et le cens éducatif
L’histoire de la Réunion selon les Leblond (Les Iles sœurs, 1946)
Effacer la macule de l’origine
La première colonisation
Le paradis réunionnais
Une identité assiégée
La hantise du mélange et son talon d’Achille
Analyse raisonnée du Miracle de la race
- Quels outils pour étudier l’identité ?
Les théories de l’ethnicité : de Weber à Huntington
L“enfance de l’art” : les théories émotionnelles de l’identité :
Comment la parole vient aux enfants
(Recherches en psycho-linguistique cognitive)
- Deuxième dossier : le retour au pays natal selon Jean Albany : la langue maternelle est le pays natal (voir notes de lecture Jean Albany). Un ouvrage de ce poète réunionnais, Vavangue, dont le thème est le retour au pays natal et la nostalgie de l’enfance (Jean Albany vivait " exilé " à Paris) contient la traduction d’un poème écrit en français 25 ans auparavant. Il est remarquable qu’un poème traitant de la nostalgie de l’enfance s’écrive au passé en français et au présent en créole : que la langue maternelle annule le temps – la traduction en maternel remontant le temps.
 B - Qu’est-ce qu’une langue ? B - Qu’est-ce qu’une langue ?
Nous apprenons à parler à nos enfants comme nous leur apprenons à marcher : ils sont déjà programmés pour cela. La remarque de Darwin : l’enfant babille naturellement (même l’enfant sourd). Rien à voir avec brasser, faire du pain ou écrire. Une disposition innée, un instinct pour acquérir un art…
- Ce détour théorique (le " plus long détour " selon l’expression platonicienne) est indispensable.
- L’épreuve du terrain ne l’est pas moins… maillages-démaillages, métissages-authenticités, héritages-innovations…
- Définir les outils théoriques propres à constituer l’objet de la recherche, présentation des hypothèses : " Le territoire de la langue : les deux natures ", communication au colloque international " Langues et droit ", Paris-X Nanterre, oct. 1998
- Légitimité "identitaire" et " culture identitaire ".
- Les outils seront donc ceux de la linguistique, de la psycholinguistique, de la critique littéraire, de l’anthropologie du droit, de l’ethnographie.
 2°) La " grammaire universelle " au secours des langues créoles. 2°) La " grammaire universelle " au secours des langues créoles.
Les théories du créole :
Hypothèse de Hjemlev, 1938.
C’est la théorie adoptée par R. Chaudenson, soutenue par des travaux sur l’histoire des zones où le créole s’est développé.
Hypothèse de Bickerton :
(Recherches touchant à la linguistique générale et non pas seulement à la créolistique)
- le créole, voie d’accès à la compréhension de la formation de la langue ?
- l’hypothèse de la " grammaire universelle " expliquerait le passage du pidgin au créole : il suffit qu’un groupe d’enfant soit exposé au pidgin (de leurs parents) à l’âge où ils font l’acquisition de la langue maternelle pour le transformer en créole (soit une langue grammaticale).
 3°) Le modèle linguistique est-il pertinent pour comprendre tous les faits de "créolisation" ? 3°) Le modèle linguistique est-il pertinent pour comprendre tous les faits de "créolisation" ?
Le processus de création d'une langue visé ci-dessus suppose le passage du pidgin dans le "moulin à paroles", la grammaire universelle de tout petit d'homme. Un processus inconscient propre à l'équipement neuronal d'homo sapiens sapiens (un génie linguistique à trois ans, un infirme linguistique passé la puberté – et bien avant). Existe-t-il une "grammaire universelle" de la religion ?
Supports :
- CHAUDENSON, R. 1995. Des îles, des hommes, des langues, Paris : L’Harmattan.
- BICKERTON, D. 1975. Dynamics of a creole system, London : Cambridge university press.
- BICKERTON, D. 1981. Roots of Language. Ann Arbor, Mich. : Karoma.
- [revue: BICKERTON, D. & commentators. 1984. " The language bioprogram hypothesis ". Behavioral and Brain Sciences, 7, 173-221.]
- BICKERTON, D. 1990. Language and Species. Chicago : University of Chicago Press.
- SIPLE, P. (ed.) 1978. Understanding Language through Sign Language Research. New York : Academic Press.
- KEGL, J. & IWATA, G. A. 1989. " Lenguage de signos nicaraguense : a pidgin sheds light on the " creole " ? ASL. Proceedings of the Fourth Annual Meeting of the Pacific Linguistics Conference. Eugene, Oregon : University of Oregon.
 3°) Comment la parole vient aux enfants… BOYSSON-BARDIES, B. de, 1999. 3°) Comment la parole vient aux enfants… BOYSSON-BARDIES, B. de, 1999.
La prosodie en regard de la " grammaire universelle " : l’enracinement et la communication. Antériorité de la prosodie sur la syntaxe dans l’apprentissage de la langue maternelle. Ses conséquences. Hypothèses.
Supports :
- BROCA P. “Sur le siège de la faculté du langage articulé”, Bulletin de la Société d’Anthropologie, 6, 1865, p. 337-393. Reproduit dans H. HÉCAEN et DUBOIS (Eds.), La naissance de la neuropsychologie du langage, 1825-1865, Flammarion, 1969, p. 108-121.
- LENNEBERG E., 1967,Biological foundations of language, New York, Wiley.
- GESCHWIND N. & GALABURDA A.M. 1987, “ Cerebral lateralization ...”, Archives of Neurology, 42, p.428-459, 521-552 et 634-654.
En appui :
- Bibliographie dans de BOYSSON-BARDIES.
[Contra :
- JAKOBSON R. 1941, Langage enfantin et aphasie, (trad. fr. 1969, éd. de Minuit) (établit une discontinuité radicale entre les productions du babillage et celles qui appartiennent au langage.)]
- CHOMSKY N. 1959 “A Review of Skinner’s Verbal Behavior”, Language, 35, p.26-58, (trad. fr. dans Langages, 4, 1969, n° 16, p. 16-49).
- CHOMSKY N. et HALLE M. 1968. The sound pattern of English, New York. Harper and Row.
Les recherches en psychologie cognitive conduites depuis le début des années 70 ont montré que le nourrisson savait discriminer la quasi-totalité des contrastes utilisés dans les langues naturelles : de voisement, de place, de mode d’articulation qui fondent les catégories phonétiques. C’est donc l’intonation qui est significative. L’attention de l’enfant se porte sur les caractéristiques de la voix en situation de communication.
Ces observations contredisent les propositions structuralistes de la grande époque : l’attention portée à la structure syntaxique ayant occulté la fonction de la prosodie - qui permet en réalité au nourrisson de la reconnaître et d’y accéder.
La prosodie offre en effet aux enfants la possibilité de segmenter la parole continue en unités de sens. La simplification des structures et l’intonation particulière qui caractérisent les formes verbales que les mères ou les adultes utilisent en parlant aux enfants facilitent leur segmentation syntaxique. Cet “emballage” prosodique est en général cohérent avec l’organisation des principales unités syntaxiques. Les relations entre les indices prosodiques et les indices syntaxiques ressortent ainsi de façon plus nette et plus fiable que dans le langage entre adultes. (Boysson-Bardies)
Dès cinq mois, les enfants montrent une préférence pour les histoires avec des pauses insérées aux frontières de propositions. À condition, toutefois, que l’histoire soit lue avec l’intonation caractéristique du motherese. Cet effet se maintient lorsque le contenu phonologique est effacé par un filtrage qui laisse la prosodie intacte mais “efface” les consonnes et les voyelles. Le rôle des indices prosodiques apparaît alors clairement. (Boysson-Bardies)
On peut penser qu’une asymétrie fonctionnelle correspondant à l’asymétrie anatomique observée chez les nouveau-nés sous-tendrait une tendance de l’hémisphère gauche à traiter les syllabes par opposition aux sons mélodiques ou aux sons non articulables dans les langues. Un auteur conclut de l’observation d’un enfant que : “son amour pour la musique et sa stratégie globale de production du langage sont peut-être reliés au développement de l’hémisphère droit, tandis que les stratégies analytiques seraient, elles, plus liées au développement de l’hémisphère gauche”.
L‘implication respective des hémisphères droit ou gauche avec leurs affinités respectives pour la prosodie et la musique d’une part et pour l’analyse de l’autre, explique sans doute, en effet, les préférences des enfants pour le traitement des composants prosodiques ou phonétiques de la parole. Les fonctions langagières pouvant être latéralisées dans l’un ou l’autre des hémisphères. Peut-être la forme future de l’intelligence et de l’imagination se devine-t-elle dans ces choix….(Boysson-Bardies)
 RÉSULTATS ATTTENDUS : RÉSULTATS ATTTENDUS :
L’idée de cette première partie du séminaire est de montrer, sans encourir la critique de surévaluation qui caractérise les discours identitaires :
- que les créoles ne sont pas des langues " enfantines " ou inférieures, mais bien des langues à part entière dès lors que le génie de la grammaire qui caractérise le petit d’homme s’en est saisi ;
- que ce sont les fondements mêmes de l’identité qui sont " engrammés " avec l’environnement culturel premier - ce qui apparaît notamment dans la manière dont l’enfant apprend la " grammaire universelle " dans la phonologie de sa langue maternelle - et que, par conséquent, il serait parfaitement inconsidéré de vouloir séparer les locuteurs natifs de ce constituant de leur humanité.
Il s’agirait donc de contribuer à réunir des données objectives pour appréhender l’opposition entre " langue de culture " et " langue de communication " et – peut-être – à dépassionner les débats auxquels elle peut donner lieu :
- La réalité ontogénétique – sinon phylogénétique, selon l’hypothèse de Jean-Jacques Rousseau dans l’Essai sur l’origine des langues – de la priorité de la prosodie sur la syntaxe dans l’apprentissage de la langue maternelle démontrant le rôle des données émotionnelles premières dans la formation de l’identité et dans l’accès à la double articulation.
- La réalité d’un double " outillage " linguistique qui répond à des besoins distincts (maîtrise du réel, d’une part et de la communication émotionnelle de l’autre ) montrant que l’opposition entre langue identitaire et langue de communication est une opposition fonctionnelle. Si cette différence reflète bien les circonstances historiques et politiques de la dépendance, il n’en résulte, d’évidence, aucune hiérarchie de langue ou de culture.
- Il devrait résulter de cette prise en compte de la modularité cérébrale mise en évidence par la neuropsychologie une reconsidération des parts respectives du rationnel et de l’émotionnel dans la culture.
(2°)
 Histoire et logiques identitaires : la Réunion et l’Europe Histoire et logiques identitaires : la Réunion et l’Europe
 Introduction Introduction
Intérêt de la recherche
“Il n’y a point d’événement aussi intéressant pour l’espèce humaine en général, et pour les peuples de l’Europe en particulier, que la découverte du Nouveau-Monde et le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance (...). Les productions des climats placés sous l’équateur se consomment dans les climats voisins du pôle ; l’industrie du Nord est transportée au Sud, les étoffes de l’Orient sont devenues le luxe de Occidentaux.”
Guillaume Raynal,
Histoire philosophique et politique des Établissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes
(1781)
Parmi les pays et les régions de l’Europe, l’île de la Réunion se spécifie par son éloignement extrême, sa différence culturelle et, pourtant, une histoire indissociable de l’Europe puisque, inhabitée jusqu’à son occupation par des colons français, elle advient à l’histoire dans le mouvement d’expansion des nations européennes. Celles-ci, avec la circumnavigation, effectuent la mise en relation des continents et jettent les bases d’une “société universelle”, selon les termes de l’auteur de l’Histoire de deux Indes, cité en exergue.
La loi de 1946 avalise d’ailleurs cette histoire en intégrant la Réunion (les “quatre vieilles” colonies - avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique) à l’espace français en tant que département.
C’est donc en toute logique que les programmes d’aide européenne lui sont destinés en raison de cette histoire commune et des spécificités de cette histoire : en tant qu’ancienne colonie de l’empire français, en tant que département français et en tant région européenne bénéficiant des termes du préambule du Traité qui confiait à la C.E.E., dès 1957, la mission d’“assurer le développement harmonieux des États membres en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés”.
Mais la Réunion est aussi, au moins depuis les années soixante, à la recherche d’une identité propre, répondant, non seulement à son histoire européenne mais encore à l’histoire africaine, malgache, indienne, chinoise de ses habitants, ces hommes que l’exploitation du café, des épices, du sucre a déportés, déplacés ou attirés dans cette île de l’Océan indien.
Cette revendication, la défense et l’illustration de ce qui s’est appelé ici, depuis 1981, “l’homme réunionnais”, se construit d’abord contre l’identité historique de la société de plantation. Le retour aux sources du peuplement, la recherche des traces enfouies sous les sédiments de l’économie coloniale constituent le but partagé et le miroir brisé des identités particulières des “communautés” réunionnaises à la recherche d’une identité collective.
Thèse : Si, dans un premier temps, l’intégration de la Réunion à l’Europe est en continuité avec la Départementalisation puis la Décentralisation – conséquences de l’appartenance à l’espace français – il apparaît aussi que l’appartenance à l’Europe peut être en mesure de modifier la relation dyadique avec l’ancienne colonie et de constituer un “dépassement dialectique” de cette opposition. En effet, l’identité culturelle peut désormais s’exprimer non plus nécessairement comme une opposition à la métropole, mais comme l’expression d’une diversité qui est le lot commun, à des titres divers, des membres de l’union européenne. La gestion de la diversité n’est plus frontale, elle devient multipolaire. La reconnaissance de l’identité n’est plus seulement une demande de réparation, elle relève d’une reconnaissance institutionnelle de la diversité...
Dans cette évolution, c’est le destin même de la culture européenne, au-delà des appartenances nationales, qui est en jeu, car l’universalisme des droits l’homme rencontre ici, comme en maints endroits où la colonisation européenne s’est faite en négation des cultures locales et du titre indigène, une demande d’identité particulière... Ce temps de post-nationalisme – où il apparaît que la dimension européenne transcende la dimension nationale – engage la réflexion européenne à la fois sur le destin commun des peuples qui composent l’Europe et sur la part que le Droit doit faire à la différence culturelle. L’idée européenne ne consiste pas seulement dans le dépassement des nationalismes, elle doit être aussi une réflexion sur le destin propre de l’Europe et sur ses limites. Ce qui constitue, au plan local, un changement de front peut donc, sans faire silence sur les stigmates de l’histoire, être la voie d’une reconnaissance culturelle qui s’impose, ou qui s’imposera, partout où il apparaît que l’uniformité de la norme opprime.
La spécificité de la Réunion tient évidemment au fait qu’il n’existe pas à la Réunion de population “autochtone” ni, à proprement parler, de culture traditionnelle au sens où la culture canaque ou la culture maorie peuvent constituer des entités juridiques opposables au droit moderne. “Certains sont nés sur la terre calédonienne”, écrit un lecteur qui “parle en tant que cafre”. “Je vis sur une terre réunionnaise qui n’a pas connu le vécu d’une vie primitive. Cette terre réunionnaise n’a pas porté la création de l’homme” (Le Quotidien du 17/12/99). Cette différence n’invalide pourtant pas, il s’en faut, la revendication d’identité. C’est ce sentiment d’identité - dont l’étude en cause cherchera à préciser la nature - que la reconnaissance des droits culturels doit satisfaire et il est posé ici que l’appartenance à l’espace européen peut y contribuer.
La complexité de l’histoire réunionnaise tient précisément au fait que c’est la société de plantation, une intention européenne, qui a fait la Réunion et que cette intention s’est réalisée principalement par le moyen de la traite et de l’engagisme, c’est-à-dire par le concours d’hommes enlevés à leur culture et que, cette histoire achevée, ceux-ci, abandonnés sur la friche des usines sucrières comme les acteurs passifs d’une intention qui n’était pas la leur, doivent trouver un sens à cette histoire arrêtée. Comment trouver une intention commune à cette coexistence née de circonstances historiques à la fois nécessaires et aléatoires, tel est le défi réunionnais.
Si l’intention originelle de la Réunion est européenne, sa réalité d’aujourd’hui est multiculturelle, faisant cohabiter, sous la légalité républicaine, cette identité première avec des communautés qui se réclament aussi d’une identité indienne, musulmane, chinoise ou africaine... Ce qu’on se propose de rechercher est l’évolution de cette identité réunionnaise, de la fin du XIXème siècle à nos jours. Le paradoxe étant que les deux auteurs qui nous serviront de référent pour comprendre ce que pouvait être la conception de l’identité réunionnaise au début du siècle (M-A. Leblond) se réclament d’une identité “européenne” (au sens de l’abbé Raynal), définissant celle-ci en opposition avec les identités des autres communautés (c’est le rationalisme en lutte et en butte aux superstitions et aux croyances des autres races) alors que la conscience européenne se trouve aujourd’hui faire droit à cette différence. Cette évolution, cette transformation, c’est ce que nous désignerons par l’expression de “révolution de la modernité” qui s’exprime notamment dans l’émergence du “droit des minorités”, des “droits culturels”, d’une régulation juridique supranationale et des doctrines de la “souveraineté partagée”.
Envisager l’identité réunionnaise dans l’Europe est donc un raccourci de cette histoire et permet d’observer – sans préjuger de l’avenir – comment, en un siècle, on a pu passer du devoir d’assimiler la différence à celui de protéger ses expressions.
 I - LES CONCEPTS I - LES CONCEPTS
Les théories de l’ethnicité, les concepts en discussion
La réflexion française sur l’ethnicité et l’identité reste tributaire d’une conception jacobine du pouvoir politique. L’idéologie républicaine de l’État-nation “à la française” est largement construite sur une dénégation de l’ethnicité : il n’y a pas de diversité ethnique dans la population française. Cette dénégation est aussi le résultat d’une violence historique dont l’histoire de la Vendée donne un exemple et que la lecture du Cheval d’orgueil de Pierre-Jacquez Hélias, par exemple, permet de comprendre du point de vue de l’indigène - cet indigène étant agrégé de grammaire. L’histoire de la République, la centralisation jacobine sont l’aboutissement de la formation de la nation française supposée résulter d’une union dans laquelle tous les particularismes régionaux se seraient fondus, leur propre folklore excepté. Et si le timbre de la raison républicaine est si pur, c’est que les provinces françaises (comme les belles qui, dans un même élan de dévotion, jettent leurs bijoux dans le métal en fusion de la cloche pour en sublimer le son), ont mis, sans reste, tous leurs particularismes dans le creuset de la nation. L’identité régionale a bien droit de cité, mais c’est en tant que composante de la nation indivisible. Ce qui ne peut exister à l’intérieur même de la nation, ce sont des “peuples”.
Parler d’ethnicité a été et reste, dans le champ de la sociologie française, et jusque dans les années 80, relativement déplacé, parce que c’est sembler reconnaître un pluralisme ethnique à l’intérieur d’une nation donnée en modèle pour sa capacité d’accueil et d’assimilation. A cette suspicion s’ajoute à la Réunion, les intentions autonomistes, voire indépendantistes, dans le mouvement de la décolonisation. On comprend, à l’inverse, que dans un pays comme les Etats-Unis, d’immigration plus récente et multiple, la question de l’ethnicité a pu constituer, dès le années 40, un objet d’étude parce qu’elle émanait d’un souci pratique et politique. Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale qu’on a découvert qu’il y avait en France, certes des Bretons, des Basques, des Occitans, des Corses, ce qu’on savait déjà, mais des Bretons, des Basques, etc. qui n’acceptaient pas la centralisation républicaine et revendiquaient une identité à part jusque dans ses conséquences politiques. Enfin, les “trente glorieuses” ayant amené en France des travailleurs venus des anciennes colonies que les “trente pleureuses” (qui ont suivi : voir : 19.4 Les "30 glorieuses" et les 30 pleureuses et pages suivantes) ont soudain rendus d’autant plus visibles qu’ils étaient devenus inutiles, il a bien fallu considérer que le modèle unique de l’intégration, de la modernité et de la citoyenneté n’allait pas de soi. Qu’il existait peut-être entre les hommes des barrières culturelles. Et on s’est donc mis à s’interroger sur la nature de cette identité particulière qui résiste à la communication, sur l’ethnicité.
C’est donc en France, essentiellement le “problème de l’immigration”, ou le “problème des banlieues” qui a mis l’ethnicité sur le devant de la scène. Mais à la différence des sociétés anglo-saxonnes où la différence ethnique ou raciale est officiellement reconnue, la Constitution interdisant de distinguer les citoyens selon leur race, leur origine ou leur religion, et la naturalisation de l’étranger ne s’accompagnant pas de sa “culturalisation”, à la difficulté conceptuelle à nommer s’ajoute une mauvaise conscience idéologique à devoir prendre en compte une réalité qui signe l’échec de l’assimilation et qui va contre l’unité nationale. Quand le modèle républicain se fonde sur l’opposition public/privé, la séparation de l’Église et de l’État, les identités “particulières”, à l’inverse, ou bien ne se satisfont pas du “commun dénominateur” qui définit l’espace politique (je veux mon propre espace politique ; cela équivaut à une reterritorialisation de l’espace régional), ou bien sacralisent l’espace public (la religion doit organiser l’espace public).
C’est donc un déplacement de la question, sinon un renversement copernicien qu’opère la réflexion sur l’ethnicité. Ce n’est plus le “centralisateur” ou l’”intégrateur”, le “travailleur social” qui pose et se pose la question : comment intégrer ?, c’est le citoyen ou le travailleur immigré qui déclare : “Je suis Breton avant d’être Français”, “Je suis musulman”, etc. Ce reflux de l’identité des grands ensembles vers les unités minimales paraissant d’ailleurs répondre à un élargissement des espaces. Cette réflexion va évidemment trouver dans le champ des D.O.M. une inflexion et une fortune propres.
Le succès des concepts d’identité, d’ethnicité, de multiculturalité fait apparaître la prééminence de la culture dans la psychologie et l’organisation sociale
Aux États-Unis, le terme d’ethnicité fait florès avec la publication, à partir de 1971, d’“un nombre impressionnant d’ouvrages, le plus souvent collectifs, qui le font apparaître dans leur intitulé” et la création d’une revue, Ethnicity, en 1974, donnant naissance à une véritable “industrie académique de l’ethnicité” (Basham et de Groot, 1977) - dont nous connaissons, mutatis mutandis une variante réunionnaise, au plan politique et culturel, à partir de 1981.
La vision “optimiste” de l’Ecole de Chicago qui voyait dans le métissage un enrichissement mutuel des groupes en contact est battue en brèche par les faits. En 1945, Warner et Srole avaient conclu une étude sur les groupes ethniques américains par la prédiction de leur disparition prochaine. “L’avenir des groupes ethniques américains semble être limité. Il est probable qu’ils seront rapidement absorbés. Quand cela arrivera une des grandes époques de l’histoire américaine aura pris fin” (295). Ces prédictions sont sous-tendues par une vision idéale de la marche en avant de la civilisation “qui projette dans une fraternité humaine sans frontière le sentiment ultime d’appartenance “ (la question est de savoir si cette espérance est “raisonnable” et si tout le monde y trouve son compte...). Elle traduisent également le credo libéral dans les progrès de l’individualisme comme possibilité croissante pour l’individu de se tracer lui-même un destin social (achievement) qui échappe à la contrainte du groupe d’appartenance et à la fatalité des statuts hérités (ascription). Rêve cosmopolite d’un accès à la civilisation scientifique rationnelle d’une société moderne universelle (Smith, 1981).
En fait, dès le début des années 60, ce modèle est mis en question. Glazer et Monyhan dans Beyond the melting-pot (1963) font le constat, à l’inverse de la prévision citée plus haut, de la vitalité des cinq principaux groupes ethniques de la ville de New-York (les Noirs, les Porto-Ricains, les Juifs, les Italiens, les Irlandais). Ils découvrent l’émergence de ce qu’on appellera la “nouvelle ethnicité” : la création d’identités ethniques distinctives basées sur l’expérience de la vie aux Etats-Unis plus que sur le maintien des vieilles cultures ethniques. Les groupes ethniques se maintiennent aux Etats-Unis comme collectivités caractérisées par une “solidarité diffuse persistante”. Pourquoi ? Parce que l’ethnicité est une dimension essentielle et universelle de l’identité humaine...
(Bibliographie sommaire dans : Théories de l’ethnicité, Poutignat, Streiff- Fenart, 1995)
 II - LE TERRAIN II - LE TERRAIN
 Introduction Introduction
Premier champ d’enquête : les expressions de l’identité réunionnaise :
- L’identité dans les sociétés créoles ;
- De Marius-Ary Leblond à Axel Gauvin, du Miracle de la race à Train fou.
(N. B. Cette partie est accessible sous sa forme développée – il s'agit de notes de cours – sous le titre "L'identité de l'identité [...] l'exemple réunionnais")
A la Réunion où le budget de la culture constitue, selon la formule d'un quotidien local, une “manne annuelle” de 140 millions de francs, la question de l’identité est “incontournable”. En effet, et pour des raisons parfaitement légitimes que nous évoquerons et qui tiennent à l’histoire, les colloques, les séminaires, les conférences sur la pluriculturalité, la multiculturalité, l’identité et autres aséités (a se : par soi) se succèdent. Il s’agit vraisemblablement autant d'y “faire de l’identité” que d’y réfléchir. C’est que ce qu’on nomme parfois ici le “malaise identitaire” qui additionne des difficultés économiques, sociales et urbaines, politiques et culturelles. Toutes ces difficultés paraissant se focaliser, s’exprimer ou s’expliquer dans une crise identitaire.
Marius et Ary Leblond, les deux auteurs qui nous servirons à présenter l’histoire coloniale de la Réunion, partageraient cet avis, à ceci près que leur diagnostic aurait, lui, la réaffirmation de la prééminence européenne pour remède – quand c’est plutôt dans l’affirmation de la différence que l’identité réunionnaise se recherche aujourd’hui. A ceci près – qui détonne évidemment avec les valeurs d’aujourd’hui – ces militants de la cause réunionnaise, délivrent en effet en même temps un audit économique de la Réunion du début du siècle et un “audit identitaire”.
Bien que les Leblond n’aient que peu vécu à la Réunion, ils ont été profondément marqués par leur enfance réunionnaise. Ary a pu dire que “le secret de sa vieillesse heureuse était le prolongement perpétuel du merveilleux passé créole qui ouvrit son existence” (Cazemage, p. 199). Dans les Îles sœurs, Marius Leblond parle du “sentiment filial, physiologique et câlin pour [l’]île “ (p. 20) Dans “L’île de la Réunion” (1923 et 1925). Nous avons si souvent exprimé... l’admiration qui montait de nos cœurs vers l’île natale avec l’encens du souvenir... Le Réunionnais porte toujours en lui l’amour “de la grande et de la petite Patrie” (20). On doit constater que ces parisiens ne sont pas contentés d’embaumer de leurs souvenirs créoles leur existence parisienne - et de les célébrer dans leur œuvre - mais qu’ils n’ont jamais cessé, en réalité, de plaider et d’agir pour la Réunion. Dans leur conférence “La Réunion et Paris”, par exemple (publiée en 1930), ils développent ceci. “L’autre jour nous faisions le tour de l’île, nous suivions la route de St-Benoit à St-Joseph, les yeux éblouis de la beauté des panoramas, et cependant les cœurs tristes. C’est que cette route est jalonnée de misères ; près des vacois dépenaillés s’effilochent dans des maisons éclopées de pauvres familles dont les carnations européennes se sont flétries, jaunies jusqu’aux tons de la vavangue (fruit de la Réunion). Nous nous sommes alors juré de faire tout ce que nous pourrions pour tirer de la croupissante désolation cette race attendrissante qui vit dans des paillottes aussi misérables que celles des indigènes du Sud de Madagascar, dans des cases dont le parquet est de boue, ne buvant que de l’eau de pluie, ne vivant que de ce que rapporte la confection des sacs [de vacoa], éteints par la résignation et par la fièvre dans les petites cases silencieuses embaumées de bégonias et des héliotropes comme des tombeaux. Aidez-nous, Mesdames et Messieurs, pour que nous arrivions à accomplir 1’œuvre de régénération avant que trop d’enfants ne meurent ! Soyons forts, unissons-nous, associons nos bonnes volontés, développons une activité à la fois commerciale et intellectuelle qui permette aux voyageurs de trouver dans notre Île, le reflet du grand foyer parisien.”(43) On ne saurait donner meilleur exemple d’un engagement moral et politique pour l’identité réunionnaise. Mais on voit par ce premier “sondage” dans l’œuvre des Leblond que l’œuvre de régénération en cause concerne les Petits Blancs (ceux que Marius appellera les témoins de “la première colonisation” “Je me sentis un profond respect très affectueux pour ces représentants de la première Colonisation” (IS. 69)) alors que c’est un sentiment de charité, mais non une identification qu’il exprimera envers “les Noirs de nos colonies”...
Voici donc le champ d’identité et le champ de militance des Leblond. Notre exploration aura pour objet de déterminer d’où procède cette identité et d’où procède cette militance.
On ne peut évidemment comprendre l’histoire de la Réunion sans l’histoire de l’esclavage et des sociétés pluri-ethniques inégalitaires. Et ce sera un domaine que l’enquête aura pour objet d’explorer.
 Thème de recherche n° 1 : Thème de recherche n° 1 :
De la logique des systèmes inégalitaires (qui exploitent les différences physiques en tant que signes ou preuves d’une inégalité) vers la constitution de systèmes égalitaires où la différence n’est pas socialement significative
Le cadre anthropologique de cette recherche est d’abord celui de l’interprétation que les sociétés humaines donnent ou ont donné de la différence physique entre les hommes. C’est cette approche, et seulement cette approche, qui peut faire apparaître la nature de cette “révolution de la modernité” à laquelle il est fait allusion plus haut.
Dans les sociétés pluri-ethniques inégalitaires donc, et notamment coloniales, la dominance se justifie - selon le point de vue du dominant - par l’adéquation entre le phénotype et la position sociale. Cette théorie a pour objet de figer la domination en somatisant les différences sociales et socialisant les différences physiques. De même qu’il y a, comme on dit vulgairement, un “physique de l’emploi”, il y aurait un physique - et donc une physique - du statut et des rôles sociaux. Ce qu’on peut illustrer d’un “exemple”, assez inattendu sous cette bannière : un jugement de Jean-Jacques Rousseau, l’inspirateur de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
“Un jour, rapporte Sébastien Mercier, l’auteur du Tableau de Paris, j’accompagnais Jean-Jacques Rousseau le long des quais. Il vit un nègre qui portait un sac de charbon ; il se prit à rire et me dit : ‘cet homme est meilleur sa place et il n’aura pas la peine de se débarbouiller, il est à sa place ; oh ! si les autres y étaient aussi bien que lui’...”
Le principe annoncé par cet exemple incongru serait le suivant : le secours de la différence visible permet de redoubler la réassurance sociale d’une satisfaction cognitive : la différence sociale repose sur une différence “génétique”, visible et supposée épuiser la nature de son porteur. Elle naturalise les fonctions sociales en autant de races qui se révéleraient être, en réalité, des espèces différentes (c’est ce qu’on appelle en biologie une “pseudo-spéciation”).
Deux citations :
“La peau blanche est un titre de commandement [...] la couleur noire est la livrée du mépris” (Girod de Chantrans, 1789).
“Ce n’est pas seulement l’esclave qui est au-dessous du maître, c’est le Nègre qui est au-dessous du Blanc” (de Chastellux, 1786).
Ce principe a évidemment pour corollaire (car tout cela n’est évidemment pas inscrit dans la nature) :
1°) la condamnation du métissage et
2°) l’exclusion des Blancs frappés par la déchéance économique
qui, tous deux, métissage et nécessité (donc dépendance), brouillent cette visibilité.
En effet : “C’est à l’ignominie attachée à l’alliance d’un esclave que la nation doit sa filiation propre.” (Malouet, 1788), l’esclave noir étant l’aubaine qui fait le Blanc à la fois blanc et prospère. Et cette opposition est si nécessaire que les Blancs sans esclaves peuvent, sinon doivent, être juridiquement assimilés aux sangs-mêlé: à Saint-Domingue, on les appelle les “nègres blancs” ou les “Cacas-Blancs” (Baudry des Lauzières, 1802). Ce qui n’est pas sans évoquer la stigmatisation des Petits Blancs de la Réunion. La propriété de l’homme de couleur, de même que la couleur du Blanc sans propriété sont des signes en réalité usurpés. Ce qu’on dit des Petits-Blancs à la Réunion doit sans doute en partie être compris ainsi... Avec cette différence qu’ils font curieusement l’objet d’une dévalorisation, si l’on en croit l’enquête de L. Labache, dans tous le milieux, y compris le leur. Tout cela est bien connu et on peut se demander s’il existe des sociétés pluri-ethniques où ne prospèrent de tels stéréotypes qui associent le phénotype au statut social, ayant notamment pour objet d’éterniser les statuts sociaux.
On sera donc en face de deux types d’idéologies :
- l’une construite sur l’opposition : idéalement sur l’opposition stéréotypée du Noir et du Blanc ;
- l’autre qui compose avec le brouillage des apparences, le métissage.
Dans un programme de reproduction d’inégalités somatiquement légitimées, le métissage est significatif et condamné quand il concerne un dominant (c’est la mésalliance ; c’est aussi ce qu’on appelle forligner). Mais il est indifférent quand il concerne des dominés. Le métissage devient un objet spéculatif et pédagogique qui montre la ligne. Dans le conflit historique - colonisation, traite, déportations - de groupes humains caractérisés comme “races”, l’émancipation investit le métissage, à l’inverse, de valeurs positives.
 Thème de recherche n° 2 : Thème de recherche n° 2 :
Le spectre des couleurs à la Réunion
A la Réunion, la pluri-ethnicité est légalement scotomisée (skotos, ténèbres obscur) mais omniprésente. Voici un échantillon d’exemples illustrant ces ambiguïtés.
Le premier - plusieurs fois entendu et peut-être fabriqué - qui fait partie de ces mots qui n’ont pas besoin d’être vrais pour être authentiques est dans la logique de “Nos ancêtres les Gaulois” répétés sur les bancs de l’école primaire au Sénégal ou au Mali. C’est une petite créole réunionnaise cafre qui rentre de l’école et qui demande à sa mère :
“Alors nout’ z’ancêt’ aussi l’étaient roses ?”
On voit par ce seul exemple :
- Les limites de la logique assimilatrice de l’école républicaine ;
- On voit aussi que nous sommes dans une société où la ségrégation de la différence physique n’a pas cours et où la simple histoire des différences visibles n’est pas enseignée - ce qui peut aboutir, au-delà de cette anecdote, à quelque “malaise identitaire” : “Qui suis-je, moi dont les ancêtres sont roses et qui ne le suis pas ?” ;
- On aperçoit aussi le caractère relatif des échelles chromatiques quand elles désignent la couleur de la peau : le rose et le blanc n’ont pas grand chose en commun sauf de n’être pas noir. Un blanc vraiment blanc, ça n’existe d’ailleurs pas ; un blanc comme une feuille de papier, ou “comme un linge” ne passe pas pour en être en très bonne posture et, en général, on ne donne pas cher de sa peau. Dans le qualificatif “blanc”, c’est évidemment “moins foncé que” qui est en cause et ce “moins foncé” est sublimé en blanc (opposé au noir dans l'échelle des couleurs). De même, dans le fin fond, dans le fond le plus obscur du continent noir, en Afrique centrale, on ne rencontre pas non plus de noirs, de noirs comme le charbon de Jean-Jacques Rousseau. Il y a d’ailleurs beaucoup de soleil et c’est pour cela qu’il y a des noirs... Mais c’est justement une autre question.
Bory de Saint-Vincent, auteur d’un Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique (1804) est un naturaliste qui visite la Réunion au début du XIXe siècle. Son guide est un certain Cochinard, “libre et chasseur de profession”. Se rendant au volcan, il s’arrête avec ce Cochinard à Saint-Joseph où il est l’hôte d’un nommé Kerautrai.
“En arrivant M. Kerautrai dit à sa femme qui se leva dès que nous entrâmes (celle-ci, précise l’auteur, était “grande, très noire”) ; tiens mon amie, voilà des blancs qui passent, fais les rafraîchir et donne à dîner. Aussitôt on nous porta de l’arack. M.Kerautrai fut très sensible à l’attention que nous eûmes de trinquer avec lui et de boire à sa santé. Il me tira après cela par la manche, me mena dehors comme s’il s’agissait d’un grand secret, et, en me montrant Cochinard il me demanda s’il était blanc s’il était libre ou s’il était noir ? Quoique Cochinard ne fut que libre et que sa couleur fut beaucoup plus que foncée, je répondis, sans hésiter, qu’il était blanc. Mets quatre assiettes cria Kerautrai à sa femme” (1804, pp. 310-1) (cité par Chaudenson dans Métissages : linguistique et anthropologie, L’Harmattan, 1992, p. 35)
Blanc et noir peuvent donc n’avoir qu’une valeur sociale et non chromatique, en vertu d’une conséquence énoncée plus haut : si le blanc sans propriété est noir, le noir propriétaire est blanc. Il y a, de fait, par exemple, des Gros Blancs malbars à la Réunion.
Mais ceci n’empêche pas le système d’être travaillé par une sorte de hantise et de fatalité de la couleur.
Voici un autre exemple : le “blanc bourbon”... Au chapitre Provinces de l’ouvrage d’E. Aubert intitulé Les Français (t. III), publié en 1842, on lit l’anecdote suivante.
“Dans les établissements voisins de Bourbon, on dit proverbialement blanc de Bourbon pour signifier gris ou noir. On dit à Maurice [c’est la vieille parenté à plaisanterie des “îles sœurs” : Quand tu lances un galet, il tombe toujours sur un Réunionnais, dit-on à Maurice] une dame tancer vertement ses blanchisseuses qui lui apportaient du linge d’une propreté douteuse. ‘Ça blanc, maîtresse, disaient les négresses avec l’hésitation du mensonge. Ça blanc, reprit la dame avec indignation, blanc de Bourbon, donc !“) (p. 368 Chaudenson, id. 33)
Albany (pour éviter que le soleil ne révèle leur véritable couleur...) “La mode de se promener comme un norvégien est maintenant revenue. Malheureusement le soleil vous fait retrouver la vraie couleur de votre famille”. (52)
Cela signifie qu’il y a un soupçon originel. Marius Leblond, écrit, par exemple, pour dissiper ce soupçon originel, cette macule de l’origine. “L’historien Guet, travaillant sur les Archives du Ministère de la Marine et des Colonies, fait ressortir qu’il a suffi de sept femmes de France “pour établir dans l’île un noyau de population française. Dès le 1er décembre 1674 l’Amiral Jacob de la Haye avait promulgué un édit défendant sous les pires peines “aux Français d’épouser des Négresses”. (IS. 112) Des cinq mariages célébrés par le Père Jourdié, le premier curé de Bourbon, en 1667, naquirent vingt-trois filles et dix-sept garçons.
La réalité du métissage originel n’est pourtant pas contestable... Le Mémoire de Boucher était tenu sous le boisseau aux archives à l’époque de Chaudenson. Voici ce qu’en dit Chaudenson.
“Je me souviens du jour où aux Archives Départementales de la rue Roland Garros, l’Archiviste Départemental, mis en confiance par mon labeur et par ma fréquentation assidue de son établissement, me convoqua dans son bureau pour me confier, sous le sceau du secret le plus absolu une copie dactylographiée de ce sulfureux mémoire : d’autres l’avaient bien évidemment consulté, A. Lougnon et J. Barassin en particulier, mais le texte demeurait presque inaccessible et ses citations forts discrètes [...]” (id. p. 34). On mesure l’évolution quand on sait que ce “sulfureux mémoire’ est aujourd’hui en vente dans les supermarchés....
La réalité à prendre en compte à la Réunion, c’est évidemment le métissage originel et continu qui caractérise le peuplement de l’île. Mais ce métissage récurrent n’empêche nullement la permanence des stéréotype liés aux formes originelles qui n’ont pas toujours été en mesure de se conserver. Encore une fois, c’est le statut social qui fait et qui permet de préserver la différence. Au-delà de ces exceptions règne pourtant, de fait, une représentation des “types” originels qui s’exprime notamment dans les attributions religieuses, dans les stéréotypes et dans un certain nombre de rites proprement créoles qui sont des rites du métissage, et non simplement rites métissés, car spécifiques à la situation de métissage. C’est là l’originalité des sociétés créoles. Là encore, c’est le tribunal des apparences qui est déterminant.
 Thème de recherche n° 3 : Thème de recherche n° 3 :
Les paradoxes de l’identité réunionnaise : les rites de démaillage
Le tribunal des apparences et des appartenances est en effet tenu en échec par la confusion des apparences, par le métissage, par le maillage. Il existe dans les sociétés créoles des rites spécifiques dont l’objet est d’attribuer les appartenances malgré les effets de métissage. Le “maillage”, est évidemment à comprendre dans le sens de l’expression “avoir maille à partir” ; “partir” signifiant ici séparer, départager ; “avoir maille à partir” désigne un conflit d’intérêts mêlés,un nœud où il faut démêler le “tien” du “mien”. Tous les mots de cette famille, maille, “maillot”, “tramail”, “maquis” (de macula : les mailles formant une sorte de dessin tacheté) se rapportent à des histoires de nœuds, utiles quand ils expriment l’industrie de l’homme - pour fabriquer des filets ou des textiles - ou quand ils tissent les alliances nécessaires aux hommes pour se reproduire ; nuisibles quand ils brouillent les généalogies. Là encore, alors même que le métissage est le lot commun, et, pourrait-on croire, la chance d’un monde nouveau, affranchi des anciennes sujétions et des stéréotypes, ce sont encore les anciennes apparences qui parlent. Ce qui est déterminant, en l’espèce, c’est la croyance fondamentale que l’enfant est approprié par les ancêtres et n’appartient donc pas totalement au monde que les hommes d’aujourd’hui ont fait.
Dans la généralité des sociétés humaines, les morts sont par nature ambivalents. Avant de devenir des ancêtres tutélaires, les morts récents et les mauvais morts doivent être conjurés, rituellement invoqués pour être fixés. Au défi universel de la transformation des défunts en ancêtres protecteurs s’ajoute, dans les sociétés de traite, l’incertitude généalogique et l’arrachement de la déportation. Le rôle des ancêtres est d’autant plus ambigu qu’on ignore largement quels ils sont, le fil généalogique ayant été rompu, et que ceux qui sont connus sont morts en terre d’exil sans avoir pu faire retour à leur propre origine. Leur statut n’est donc pas sans rappeler celui des mauvais morts, ces âmes non fixées (âmes en peine, Hollandais volants, etc.). Faute de cette double quiétude : savoir qui sont et où reposent les ancêtres, savoir que les rites qu’on leur destine, les invocations qu’on leur adresse leur parviennent bien, ils restent des protecteurs capricieux dans l’esprit des descendants et, à certains égards, des mauvais morts. Les mauvais morts, c’est bien connu, font les mauvais vivants...
L’inquiétude créole (pour ne pas utiliser l’expression de “malaise créole” qui a cours à Maurice) se décline et se conjure spécifiquement dans des rites connus sous l’appellation de “cheveux maillés”. Rites qui ont souvent été décrits. Le “maillage”, c’est évidemment le métissage. Mailler, c’est mêler, c’est mélanger. En français du XVIIIe on dit indifféremment métis ou mestif, “métif ou mélangé” écrit Buffon, les deux mots signifiant mixte. Se mailler les pieds, c’est se mêler les pieds, ce sont des gamins qui jouent à se faire des croche-pieds (ex. dans le Miracle :“Ils s’apprêtaient à courir les uns après les autres en se “maillant” les pieds pour s’allonger dans la poussière” (40).Mailler, c’est tricher : Il y a eu maillage ! proteste un candidat battu par les urnes. Mailler, c’est aussi fourcher, c’est la langue qui fourche. A la “manif. anti-bidep”, le Président du Conseil Général a lancé ce slogan : “Tamaya t’as maillé !” Donc le maillage exprime l’emmêlement. Nous savons que tous les humains naissent d’emmêlements - qui certes font souvent des nœuds, mais c’est une autre histoire. Car la sexualité est nécessairement mixte, métisse. La mixité est nécessaire à la recombinaison génétique que précède la séparation des paires de chromosomes issus du parent mâle et du parent femelle. La reproduction sexuée n’est jamais re-production, contrairement à l’espérance du mot, reproduction du même, duplication. Pourtant, alors que la sexualité est par définition métisse, le terme “métis” ne désigne, restrictivement, que le produit visible du croisement de deux identités distinctes. Le métissage fait problème quand c’est la reproduction du même social qui est visée. Dans les sociétés créoles, où le métissage est évidemment plus ordinaire, cela ne va pas toutefois sans poser question. Et c’est cet emmêlement que visent les rites en cause.
Le moment de la première coupe de cheveux de l’enfant a une signification sociale et juridique importante... c’est un passage au sens fort, au sens ethnologique, du mot et c’est souvent le moment de l’attribution juridique de l’enfant au groupe de parenté. Il est évidemment indispensable ici de faire référence au système de filiation qui a cours dans les sociétés où se pratiquent ces rites. A Madagascar, par exemple, le premier ou les deux premiers enfants d’un couple appartiennent au clan de la mère et seuls les puînés appartiendront au groupe du père. Chez les Gonja, par exemple, en Afrique de l’Ouest, on peut épouser une femme avec un grosse dot ou une petite dot, ce qui déterminera si tout (grosse dot) ou partie (petite dot) des enfants du couple appartiendront au clan du père. A Madagascar, la circoncision (= couper le cordon) a cette fonction d’attribution juridique. La première coupe des cheveux anticipe en quelque sorte la circoncision, parfois désignée par l’expression manapaka tadim-poitra (couper - corde - ombilic), qui fera passer définitivement le garçon dans le groupe de son père (idem, pour le perçage des oreilles de la petite fille).
Au moment où l’on coupe les cheveux, il arrive donc que l’on constate que certaines mèches se sont mises en boule et, à la Réunion, où il reste quelque chose de cette pratique - la maîtrise des échanges matrimoniaux traditionnels en moins - ce “maillage” est interprété comme une indécision d’ancestralité. Quel esprit réclame l’enfant ? Qui est son “père” ? Ce qui renvoie évidemment à la question : Qui suis-je ? question lancinante de l’identité créole. Tout le monde ici a entendu cette chanson de Baster’ qui s’intitule Black out, qui retrace cette histoire où la douleur physique de l’esclave (“Caf’ na 7 peaux”) se redouble de la douleur morale de ses descendants et dont le refrain est “...et black à moi-même”. Le rite se développe alors selon des modalités spécifiques où, à l’instar de ce qu’on est tenu de faire en cas d’apparition d’un défunt (dans un rêve ou dans une vision)..., on invoque et on sacrifie à l’ancêtre qui se manifeste, avec cette difficulté supplémentaire que cet ancêtre est sinon inconnu, du moins imprécisément identifié du fait de la déportation et du métissage. Le “symptôme” du maillage, qui se manifeste avant la fin de la première année s’accompagne (ou se signale) généralement de troubles somatiques, diarrhées ou vomissements et constitue l’un des motifs les plus fréquent de la consultation du guérisseur. On considère parfois que le mode de maillage permet d’identifier l’ancêtre insatisfait, malbar ou malgache. Un rasage rituel, de la main d’un intercesseur, s’impose pour éviter que l’esprit de l’ancêtre ne s’empare de l’enfant au lieu de le protéger. L’idée de purification apparaît dans le choix de la période du carême pour exécuter le rituel et peut-être peut-on voir dans le choix d’un début de mois une interprétation créole du calendrier lunaire malgache (d’origine arabe) avec ses jours favorables. La coupe des cheveux commence par les mèches rebelles qui sont jetées à la mer dans le rituel malbar (avec les déchets et les vieux vêtements de l’enfant) et à la rivière, dans le rituel malgache, où l’enfant devrait être dirigé vers la porte de l’est (comme pour la circoncision) puisque le rite s’adresse aux ancêtres. Cette manifestation intempestive de l’ancêtre appelle une réponse adaptée aux “mauvais morts”, mais conforme au processus d’ancestralisation qui consiste à faire passer les défunts du statut de morts dangereux (qui est celui de tous les défunts récents) à celui d’ancêtres tutélaires, selon la logique des “doubles obsèques”. A cette circonstance s’ajoute la double rupture du lien généalogique. Double perte, et du savoir et de la fidélité généalogique : déportation et métissage. Une idée force de ces représentations, c’est la dépendance des vivants vis-à-vis des ancêtres. Seul un “moderne” (un créole moderne) peut répondre : “Et alors ? je ne sais qui sont mes ancêtres, mais ne suis-je pas ce que je fais ?” Cette conception de l’action et du temps - de la liberté - est spécifiquement moderne. Il s'agit d'euphémiser l'ancêtre et de le transformer en protecteur. Ce serait donner un sens profane à la créolisation en cause (auquel cas un rite de type archaïque serait mal venu) que d'interpréter cette purification comme un rejet. C’est : ou pas de rite ( on ne voit même pas que les cheveux maillent, c’est une grand-mère qui s’en aperçoit et on lui dit plus ou moins poliment : tu nous casses les pieds avec tes histoires...) ou rite d’euphémisation. On est dans un monde “assiégé”, “tourmenté”, bardé des “protections” qui éloignent les mauvais esprits et non dans un monde où l’on pourrait se débarrasser ainsi du poids des ancêtres. Il ne s’agit donc pas de dire :“les ancêtres sont morts (c’est Nietzsche à la Réunion : Dieu est mort !)” ce qui reviendrait à raviver la coupure (la double césure de la créolisation), mais de la cicatriser. Si le symptôme signifie que les ancêtres réprouvent le “forlignage” en quoi consiste le métissage, il s’agit d’obtenir leur accord en mettant l’enfant sous leur protection. C’est justement ce que permet l’identification ethnique de l’ancêtre qui se manifeste (notamment dans le mode de maillage).
Une autre réponse à cette indécision généalogique est celle de l’apparence physique. Où apparaît le secours de l’apparence. Les patronymes chinois dans les faits divers qui impliquent des hommes au phénotype cafre montrent le métissage. On a, on doit avoir, la culture de son phénotype. Une petite fille plus chinoise que les autres membres de sa famille sera élevée “à la chinoise”. Il existe à la Réunion des familles à double cuisine - où il y a donc sinon deux foyers, du moins deux batteries de cuisine distinctes - l’une qui respecte l’interdit du bœuf et l’autre qui respecte l’interdit de la chèvre. Vous pouvez hériter l’essentiel de vos gènes de Madagascar, si vous “sortez malbar”, vous devez rendre culte aux ancêtres de l’Inde et donc vous ne pouvez consommer de viande de bœuf. Même chose pour les Réunionnais qui cultivent une ascendance malgache et qui doivent respecter l’interdit du cabri.
Ou l’on voit que, malgré le discours républicain, la règle des apparences continue à jouer.
 Thème de recherche n° 4 : Thème de recherche n° 4 :
Le Miracle de la race, ou le destin de la couleur identifié au destin du rationalisme européen
Le Miracle de la race, qui est l’œuvre sur laquelle la recherche va d’abord se focaliser, est l’histoire d’un orphelin de Saint-Pierre abandonné à lui-même, l’épopée d’un enfant blanc déchu qui doit quitter les condisciples de sa classe sociale pour se mêler aux élèves noirs des Frères des écoles chrétiennes, et qui, noyé dans la “négraille”, refait surface, se distingue et recolonise l’île (en quelque sorte) pour prendre part ensuite à la conquête de Madagascar où les Leblond voient le salut économique de la Réunion.
Il faut souligner d’emblée le caractère autobiographique (on est donc en face d’une fiction qui n’est pas tout à fait fictive) de cette “déchéance” pour l’un des Leblond. Dans une biographie largement hagiographique (c’est aussi un recueil de jugements contemporains qui encensent les Leblond et de panégyriques...), Benjamin Cazemage rapporte que la plus grande partie de l’enfance d’Ary “nous est révélée par deux romans, “Anicette et Pierre Desrades” et surtout “Le Miracle de la Race”, écrit en 1913, au retour de vacances à Aix-les-Bains. Quand son père mourut, Merlo n’avait que trois ans. Il s’attacha beaucoup à sa mère qui travailla durement à la tête d’une laiterie avec le concours d’un Indien , pour élever trois fils dont elle fit des hommes de valeur” (1969 : 13). “Aimé fut élevé à la pension de Madame Imbert. Il profita beaucoup des leçons de cette maîtresse énergique qui avait appris le latin au moment où elle voulut l‘enseigner. L’exemplaire du “Miracle de la Race” qu’Ary annota pour moi, à son passage à Saint-Pierre en 1930, indique que tout ce chapitre IV a été vécu. Ce qui laisse croire que :les raisons pécuniaires ont contraint “Alexis ”à quitter l’institution de “Mme Cébert”. Il l’a regretté amèrement, car, en même temps que du professeur, il avait dû se séparer d’excellents camarades de la haute société saint-pierroise, pour trouver chez les Frères des Écoles Chrétiennes des condisciples, noirs pour la plupart, qui l’accueillirent avec des sarcasmes. Bien qu’il fût constamment malmené par ceux-ci, Ary garda pour les races de couleur le grand intérêt qui se manifesta dans ses œuvres. Il a tracé avec humour le tableau de cette année scolaire passée chez les “Chers Frères” [...] (id. 13-14).Voici un échantillon de cet humour, où il est précisément question des nouveaux camarades de classe d’Aimé-Alexis, chez les Frères.
“Frère Jérémie imposait silence, répétait les mots, leur restituait par son gosier méridional toute leur sonorité méridionale : les langues africaines, à l’envi, recommençaient les exercices d’assouplissement.(41)
Comme si la chaleur, après déjeuner, pesait plus fort sur les rejetons des nègres de Guinée, du Congo et de Mozambique, la classe s’absorbait dans un sommeil plus dur qu’eux. Alexis profitait de cette heure pour apprendre à distinguer ses “camarades”. De n’avoir jamais été enfermé seul avec tant de petits noirs, il restait aussi vivement surpris que s’il n’en avait jamais vu ! Serrés l’un contre l’autre, en cargaison, et en proie à la torpeur qui les écrasait, il ressemblaient tous étrangement à des animaux. Sous les chevelures crépues qui bosselaient leurs fronts fuyants, certains louchaient pour veiller de côté avec des sclérotiques [sclérotique : membrane fibreuse qui enveloppe le globe oculaire] irisées de bœufs. Quelques-uns, pour chasser les moustiques, frottaient plusieurs fois, d’un tic de macaques, leurs visage avec leurs longues mains de quadrumanes. Beaucoup, étirés par la sieste en marge du livre ouvert, reposaient sur une patte allongée des têtes grognonnes de petits cochons, dents dehors. D’autres, qui avaient des mines de lézards et de caméléons, langue pendante, d’un revers de main attrapaient les mouches au bord de l’encre... (44-45)
Le style “littéraire” de cette page de zoologie (macaques, petits cochons, lézards, caméléons...) serait probablement aujourd’hui une circonstance aggravante pour traduire ses auteurs devant les tribunaux, mais nous ne sommes pas ici pour cela, nous sommes ensemble pour nous demander ce qui s’est passé dans ce XXe siècle pour que nos jugements anthropologiques soient à l’inverse de ceux de nos grands-parents. Il n’est évidemment pas inutile de connaître cette donnée biographique - cette expérience cuisante que fut pour le jeune Aimé Merlo, si l’on en juge par l’absence totale d’identification avec ses nouveaux camarades de classe décrit comme les membres d’une faune hostile, d’une plongée dans un monde inconnu qui vit sa propre loi - pour comprendre certains des jugements développés par les Leblond. Ary décrit dans le Miracle encore la volée reçue de ses nouveaux camarades : “Aussitôt une tape s’abattit sur sa nuque, deux, trois sans qu’il put faire volte-face : ils voulaient lui enfoncer le casque jusqu’au cou jusqu’à l’aveugler? Son cœur claquait à rompre. Des coups de poing dans le dos, des ruades..., ils n’osèrent pas le gifler... Il n’eut que le temps de s’appliquer au mur : les galets à nouveau retentirent sur sa tête qu’il inclina pour n’en point recevoir sur le dents. Des mottes de terre s’y écrasèrent.
- Cacatois blanc, cacatois !
- Je porte mon nom ! - commanda-t-il de toute sa force, - je ne veux pas de surnom.
- Ah ! ti tires ton français ? A cause ti tires pas aussi ton soulier ? Ti vas voir comme nous allons faire manger à toi la boue !
- Des nègres sales... des nègres sales jetait sourdement Alexis.
Il bouillonnait, se raidissait pour se tenir droit sous les projectiles [...] Il percevait qu’il allait tomber en convulsion comme dans son enfance, quand il se sentit délivré par un monsieur. Il put soulever son casque : toute la racaille s’enfuyait. [...]
Elle lui lançait de loin : “Cacatois !...” Plus que tout, le sobriquet l’humiliait ! Il avait une peur atroce du surnom qui diminue et déconsidère pour la vie, du ridicule. L’enfant ne veut pas qu’on rie de lui : il a l’instinct qu’il doit essayer d’être admiré plutôt que bouffonné; Il entend qu’on le respecte, car il besoin de n’avoir que confiance en lui-même, pour s’élever ! Cette susceptibilité attentive, c’est déjà le point d’honneur de la race (71-72).
La superbe indifférence ou la morgue hiérarchique des théories raciales qui inspirent les systèmes de caste ou les féodalités n’est pas de mise pour ceux qui ont connu l’épreuve - fut-ce dans la cour de récréation - de l’“anéantissement” sous le nombre. Et cette épreuve est déterminante pour les fondements de leur anthropologie. Aussi ouverts soient-ils aux nouveautés de l’art contemporain (ils publient les premiers poèmes d’Apollinaire, leur ouvrage Peintre de races [où l’on voit d’ailleurs qu’ils utilisent le mot race au sens de “génie national”) contient entre autres une présentation de Van Gogh et de Gauguin tout à fait moderne) les Leblond ne peuvent pas voir du même œil que les Parisiens le frottement des civilisations et des cultures. Quand ils fustigent les “égarements du négrophilisme”, dans ce morceau de bravoure qui conclut Ulysse cafre, ce n’est pas en tant qu’acteurs de la bonne société s’enthousiasmant devant les productions de l’“art nègre”, ou en tant que critiques d’art, c’est-à-dire de juges de cette sensibilité désintéressée qu’est l’esthétique. C’est en tant que membres d’une “minorité assiégée”. Ce sentiment d’insécurité est récurrent dans le Miracle de la race. Insécurité multiple, démographique, culturelle (on trouvera dans Ulysse cafre un pharmacien adonné aux superstitions locales), physique : “Il se sentait dépaysé, avec la révélation que non seulement les enfants mais tous les blancs ne vivent pas en sûreté dans un pays où les Chinois, les Arabes, les Malabares, les Cafres peuvent manier le sabre. (M.123). C’est cette insécurité, ce péril qui justifie l’appel à la “Résistance” développé dans la “mise à jour” de l’édition de 1921.
Le destin littéraire des Leblond s’apparente largement à celui de leur cause, au destin du monde dont ils ont été les illustrateurs et les propagandistes. C’est en effet le caractère impensable, foncièrement démodé et moralement insupportable de leur propos qui retient aujourd’hui la critique, cette conscience d’un monde révolu, d’un moment historique qui a vu les nations européennes, par suite d’une cumulation technique, d’une croissance démographique et d’une conceptualisation inédite du rapport de l’homme au cosmos, peupler des contrées ou en décimer d’autres pour y déployer une exploitation de la nature qui trouve aujourd’hui ses limites extrêmes. Et spécifiquement l’articulation de cette théorie de l’altérité qui répond au besoin de transformation d’une nature réduite au statut de matière - du devisement du monde à l’arraisonnement du monde - : quand “il n’y a point d’événement aussi intéressant pour l’espèce humaine en général, et pour les peuples de l’Europe en particulier, que la découverte du Nouveau-Monde et le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance (...). [quand] les productions des climats placés sous l’équateur se consomment dans les climats voisins du pôle, [que] l’industrie du Nord est transportée au Sud [et que] les étoffes de l’Orient [sont] devenues le luxe de Occidentaux”. L’œuvre des Leblond illustre cette conscience sourde de l’esclavage chez les légataires d’un système où des hommes à l’humanité problématique se sont révélés suffisamment différents et suffisamment semblables pour devenir des outils (“main pour la main”, selon la définition d’Aristote), où l’“institution particulière”, selon l’euphémisme nord-américain, a fondé la richesse visible de la colonie. Loin de renoncer à l’héritage et à la succession, prenant à cœur le destin de “leur île”, les Leblond imaginent et appellent de leurs vœux de nouveaux rapports entre les groupes humains qui composent la société réunionnaise au début du XXe siècle, la réorganisation en société, dans un destin commun, de ces hommes dont la majorité a été déportée dans une intention dont les effets et les moyens sont épuisés et qui se trouvent sur leur île comme les rouages désunis d’un calcul brisé. La réponse à la question “Quel avenir pour la Réunion ?” passe par un nécessaire audit ou bilan de la colonisation de l’île. L’intérêt de la politique des Leblond est son caractère démodé et conforme à la logique d’assimilation et d’intégration qui caractérise la colonisation française où l’autre, mis sous la tutelle protectrice de la civilisation, en enfance d’humanité et en attente de progrès, ne peut être que progressivement admis à l’égalité juridique, après s’être acquitté d’un cens culturel qui ne lui est accessible que par dévotion à la loi blanche. “Les questions de géographie se résolvent harmonieusement sous le signe de la Croix.” (I.S. p. 146) “Nous croyons que la Réunion et les principes de notre colonisation offrent comme solution rationnelle et esthétique une élévation lente mais continue et harmonieuse (id. p.130).
Le “miracle de la race” - et sa présomption - c’est donc que la couleur fait (et conserve) la valeur : en situation de deshérence culturelle à l’école des Frères, parmi les petits Noirs, en butte à l’hostilité familiale et raciale, le héros va renouer avec la vocation normalisatrice de la culture. Le “miracle de la race” - et ses limites - c’est que ces bourgeois parisiens se sentent des devoirs de responsabilité liés à une identité première vis-à-vis des “petits blancs” descendant de “la première colonisation”, “pattes jaunes” vivant dans des “paillottes aussi misérables que celles des indigènes du Sud de Madagascar” et des devoirs de charité envers les Noirs. Hériter, c’est civiliser ces derniers par les premiers réinstallés en position d’héritiers. “Toutefois, il me faut noter, dira Ary Leblond à Cazemage, que beaucoup plus peut-être et autrement, plus en profondeur et aussi en élévation que n’avaient fait les romans naturalistes et réalistes de Zola et de Maupassant, agit sur nous - sur le cœur et sur l’âme - la littérature de Tolstoï. Étrangement apitoyé sur le sort des paysans russes, incultes, mais de nature si humaine, si purement bons, je me disais après cette lecture que les Moujiks que nous devions aimer, élever instruire autour de nous étaient ceux qu’on appelait négligemment devant nous, les “gens de couleur”. Je serais heureux si l’on sentait un peu de ce message tolstoïen, sinon dans le “Zézère”, du moins dans le “Miracle de la Race” (Ary) (21)
En 1913, alors que l’empire colonial français connaît sa plus grande expansion Marius et Ary Leblond montrent la race blanche assiégée (“Résistance”, “Maintenance”). On peut lire, en effet, dans les excès et les naïves professions de foi de ce roman antiphrase qui expose le “miracle de la race” et dont l’objet est le déclassement social de la population blanche de la Réunion avant la déflagration de la première guerre “mondiale” - qui allait marquer le commencement de la fin de la suprématie de nations européennes - le constat objectif et involontairement prophétique de l’épuisement et du reflux de l’expansion européenne. Et l’entrée d’autres cultures, d’autres peuples sur la scène, sur leur scène. En effet, les Leblond, c’est la fin d’un monde aujourd’hui retourné dans ses valeurs. Leur bilan de la colonisation de l’île - une impasse sinon un échec - se termine symboliquement par l’expédition de Madagascar. C’est dans cet accomplissement de la colonisation réunionnaise que nos auteurs voient, en 1913, le salut de cette “colonie colonisatrice”, de cette “métropole seconde” qu’est la Réunion. Comment se délivre cette leçon ? Par un roman de formation (par une initiation au sens ethnologique du mot) qui, de l’âge de douze à dix-neuf ans (de la première communion au service militaire, pourrait-on dire) conduit un jeune orphelin blanc “déclassé” de l’école des Frères (de l’école des petits Noirs) à la conquête de Madagascar.
 Thème de recherche n° 5 : Thème de recherche n° 5 :
Les limites de l’assimilation
Pour nous, modernes, évidemment, la pierre d’achoppement de ce programme - ce qui se dit étymologiquement scandale (skandalon) - et qui commande tout le reste, c’est la conception que les Leblond se font de la couleur. Et comme il n’est pas d’histoire sans perspective, c’est cette perspective qu’il faut commencer par exposer avant de présenter la conception que les Leblond se font et du passé et de l’avenir de la Réunion.
C’est d’abord un réel sentiment de commisération envers les descendants des esclaves. C’est l’apitoiement du bon chrétien : “Phénomène assez curieux, écrit Marius Leblond dans les Iles sœurs : dans de vieilles colonies comme nos Mascareignes où la cohabitation existe depuis plusieurs siècles, où elle est familière et souvent même affectueuse, s’est produite une ségrégation spontanée. A Saint-Denis, la capitale, l’étranger remarque tout de suite que vers l’heure des repas et du sommeil la foule, si entièrement mêlée jusque-là dans les rues, dans les magasins et dans les bureaux, se sépare en deux classes pour regagner “ses pénates” : à pas pressés, le plus souvent nu-pieds, les gens de couleur filent vers le Butor Saint-Jacques, la Petite Île et le Camp-Ozoux, quartiers où n’habite presque aucun Blanc...” “Pénates”: ce mot de solennité classique fait ressortir par un humour quasi sarcastique, à quel point “les Noirs” de nos Colonies sont cruellement privés de nos dieux du foyer, privés d’un réel foyer, même d’un âtre, car la cuisine se constitue d’une marmite et d’un trépied posés sur un petit feu de bois au grand air dans une cour grande comme un mouchoir. Le Camp Ozoux est un chaos de masures déguenillées où, pour qui a pris la peine de regarder de près avec des yeux chrétiens, la misère serre le cœur à l’étrangler de pitié, d’indignation et de remords collectifs. Beaucoup dorment sur de la terre battue. La misère noire.
“... Tout presse de chercher avec une énergie sagace et de trouver au plus tôt, ne fut-ce que par dignité française : de recourir avec rigueur à la science objective, de revenir à la loi et à l’injonction du Christ. (121-122) Car “Ce sont seulement les personnes d’instruction restreinte qui tiennent les Noirs pour des êtres inférieurs du fait des pigments de leur peau.” Nous croyons que la Réunion et les principes de notre colonisation offrent comme solution rationnelle et esthétique une élévation lente mais continue et harmonieuse.(130) Les questions de géographie se résolvent harmonieusement sous le signe de la Croix. (146)
Mais ce réel sentiment de commisération coexiste avec un non moins réel sens des réalités. Le système démocratique étant fondé sur la loi du nombre, “comme on en fait des électeurs... il n’y a que la quantité qui compte...” lit-on dans le Miracle (p. 232), le destin de la Réunion doit être régi, selon les Leblond, par une sorte de cens culturel (“L’instruction seule peut empêcher la Réunion de devenir un foyer de superstitions comme Haïti !...” (250)) que confirme la “ségrégation spontanée” (ou supposée telle : on n’est pas très loin de la polémique pastorienne contre la théorie de la “génération spontanée”) en cause. L’histoire politique de la Réunion, jusqu’aux années 80, avec son clientélisme, ses broquettes et le bourrage des urnes, puis ses feuilles de tôle et ses emplois communaux, sans oublier sa télévision pirate, est une autre expression de ce cens.
Voilà donc, même tempéré de charité chrétienne, ce que le sentiment identitaire commande aux Leblond.
 Thème de recherche n ° 6 : Thème de recherche n ° 6 :
Outre sa valeur de témoignage historique, retenir de l’œuvre des Leblond l’idée que l’audit économique et l’audit identitaire sont liés
La Réunion rêvée par les Leblond est à l’image la pension Cébert, promesse d’un ordre social indéfiniment répété par l’éducation de cette “maîtresse-femme” qui avait “contracté l’habitude et l’art du commandement” à “mater sa négraille” (13) “Dans les rangs de la pension Cébert dont les passants appréciaient la tenue, figuraient les fils du Maire, du Président du tribunal et des magistrats, des médecins et des directeurs des Sucreries et Caféeries. Deux siècles d’intimité dans le paradisiaque exil de la colonie prêtaient un air de consanguinité aux visages de ces enfants nés de parents émigrés jadis de Normandie, Provence, Bretagne, Aquitaine et Picardie. (17) Ou à l’image de l’église encore : “on donnait un nom à toutes les personnes qui paraissaient ; chacune venait occuper sa place à son rang comme dans la société” (50) où les “Blancs reçoivent les noirs” : “Il n’y avait pas moyen de ne pas sentir l’amour-propre de la classe noire, et la coquetterie que la dernière des malheureuses mettait à “faire honneur” aux chers frères [...] Au fond, c’est pour plaire aux blancs, au blanc qu’est le bon Dieu, aux blancs que sont les prêtres, les chers Frères, les maîtres, les maîtresses. [...] (49) Cet ordre social se perpétue par une ségrégation mentale qui permet de se maintenir sans mélange à l’opposé de ces autres qui d’ailleurs, même quand ils sont mélangés (“...quoique les Camps Malabares soient des enclaves bien circonscrites dans certaines vastes propriétés agricoles, il s’y sont très mêlés [...] Ils sont complètement incorporés dans “la Classe noire” dont ils sont l’élément le plus beau mais le moins costaud.” (IS. 127) se veulent distincts. Ainsi la préface des Sortilèges, recueil de “quatre petits romans” explique-t-elle qu’“il ne fallait pas mettre en contact, dans les entrelacements d’une intrigue unique ces humanités qui, sous l’apparence d’une existence collective, gardent de l’univers, dans le mystère de leur mutisme un sens différent. A chacun venait le roman spécial à sa destinée sous la langueur d’un même ciel indonésien”.
Quelle est la valeur de l’audit économique des Leblond ?
1°) Vertère physiocrate.
Son modèle, c’est le père Vingaud, le futur beau-père d’Alexis. “Il n’y avait pas besoin d’être finauds comme des Normands pour comprendre qu’il y a ici de l’or à gagner, bien plus même qu’en France : c’est alors que nous avons entrepris de faire de l’élevage en grand... lapin et poule, cochon et bœuf.” (252) “Du moment qu’on est parti pour les colonies, il ne faut pas craindre de travailler comme des forçats !...” (251) “L’avenir tient plus encore dans l’élevage que dans la culture, je dis toujours aux gens du pays que pour le bétail il n’y a à craindre ni cyclone ni baisse.” (254) “Chacune de ces vaches bretonnes, tout comme si elle n’avait pas traversé les mers me donne ses quinze litres de lait... Et vous connaissez mon système ? Chez nous, bêtes à deux pieds ou bête à quatre, on ne mange que ce que la propriété produit.” (255)
Mais les Leblond voient bien que cet idéal d’auto-suffisance, et même si la Réunion peut produire tout ce qu’elle consomme (ce qui n’était pas le cas : il faut savoir, par exemple, qu’au moment de l’abolition, le riz représentait 50 % des importations, plus morue et viande salée ; qu’on n’a probablement jamais cultivé plus de 600 hectares de riz à la Réunion et que, jusqu’en 1850, le maïs occupait environ 30 % des sols, part nécessaire à l’alimentation des esclaves sur les grandes propriétés (après l’abolition disparaît l’obligation de nourrir les anciens esclaves âgés ou sans contrat de travail, diminuera, recouverte par la canne), cela ne fait pas une révolution ne serait-ce qu’en raison de l’exiguïté du champ d’action. C’est donc, pour eux, Madagascar qui constitue le salut.
2°) Madagascar
Vingaud : “Vous parliez de l’élevage en grand dans ce pays... Qu’est-ce que vous diriez alors de ce qu’il rapporterait à Madagascar ? Là-bas, prétendent tous les capitaines au long cours qui montent ici me voir, les zébus, les porcs, les oies se donnent pour rien et viennent tout seuls !...Dire que la France n’a pas encore trouvé le moyen de poser la main... (255-256) “Quand [l’État] formera-il dans ces hauts des villages de colonisation où notre race s’ acclimatera aux zones tropicales pour se répandre ensuite à Madagascar et dans tout l’Océan Indien ? (254) “Patience ! les Anglais, en excitant les Hovas contre nous, nous prodiguent tant d’avanies que bientôt le Gouvernement ne pourra plus reculer... Savez-vous que depuis longtemps, monsieur Vingaud, une bande de vaillants colons créoles, sans demander la permission de personne, ont planté les droits de la France dans la Grande Terre ?... (256)
Le roman se termine par le bouquet du 14 juillet dans une idéale communion des races unies dans ce nouveau départ et retrouvant l’impulsion primitive de la route des Indes : “Puisse notre Réunion - bien nommée puisqu’elle est peuplée d’Européens, d’Asiatiques, d’Africains - renaître un jour comme centre d’échanges entre le Cap et l’Inde, l’Australie et Madagascar qui va nous appartenir !... Civilisés déjà et associés afin de nous demeurer fidèles, nos Indiens, nos Arabes, nos Chinois, nos Malgaches étendraient si aisément des relations avec leurs divers pays !... Par eux, et grâce à l’élite que créerait ici une instruction appropriée, nous aurions vite fait de répandre le renom de la France, comme le voulait Colbert, “sur le pourtour de la mer des Indes !” (282) “Le Gouvernement de la France a déclaré la guerre à Madagascar!” (261) “C’était la France de l’Histoire qui, par le canal de Suez, allait descendre sur la mer des Indes conquérir Madagascar comme jadis elle était venue, par le cap de Bonne-Espérance, prendre Bourbon, de là l’Inde, puis la Cochinchine, puis la Nouvelle-Calédonie...” (261)
Les Leblond nous donnent ici une page tout à fait intéressante sur l’“émotion identitaire” ou le “frisson sacré” patriotique : “La guerre ! au premier ébranlement, comme si la sensation de la mort, de tout ce qui allait être tué, en nous tuait l’homme, d’abord Alexis se sentit comme terrassé. Mais, soudain, de cette commotion tout son être se redressait tel qu’en un élan physique qui l’emportait, le précipitait au-dessus de lui-même, dans l’ivresse de ne plus dépendre de rien, pas même de soi !... Puis ainsi que quand il était enfant, il pensa à la France.” (261) “Les Hovas, malgré l’engagement pris envers nous de traiter humainement le peuple des Sakalaves, amis de la France, viennent encore de les massacrer.” (261) “Son imagination palpitait... Des jeunes gens de son âge, là-bas en Europe, allaient quitter leur chaumière !... Puis il voyait Célina conduisant son frère aîné, qui voulait servir, jusqu’à l’entrée des bois... Puis iI sentait brusquement que Madagascar, comme une Grande Terre malsaine, sauvage et rouge, n’était qu’à un jour de l’horizon, de l’autre côté de la mer.” “Étrange conjoncture : cette excursion dans les Hauts où il venait de donner son cœur à une jeune fille de Normandie et ce soir où il apprenait que de France la guerre allait éclater et s’étendre sur Madagascar ! Devant la nuit le saisissait cet effarement superstitieux [à laquelle les auteurs donnent quelque peu la main] qu’on ressent à vingt ans à croire soudain que tout ce qu’on doit voir de plus important dans son existence vient de se présenter d’un coup!...” (262) “Alors, mes vieux frères, exhorte le principal tribun de cette cause, délaisserons-nous les soldats venus de Marseille enfoncer seuls le drapeau sur le palais de Ranavalo ?. Allons donc !... sont-ce des Européens qui, depuis vingt ans, ont fouillé des kilomètres de plantations du côté de Tamatave, de Vatomandry, d’Andévorante, ou bien des garçons de Bourbon, des cousins à vous et à moi ?.. Ce sont des têtes coupées de Parisiens ou bien d’enfants de Bourbon que, pour nous narguer, les chiens de Malgaches ont empalées sur des poteaux comme des crânes de bœufs au bord de la mer, en 1885 ?.. Je dis que c’est nous qui devons les premiers manger le riz de Madagascar !...(266) “Je dis que ce sont nos grands-papas qui ont obtenu, après I8I5, qu’on notifiât expressément sur le traité que les Comores, Madagascar, Sainte-Marie n’étaient pas compris dans les dépendances de Maurice, comme prétendaient Messieurs les Anglais ! A partir de ce jour, Bourbon seul, toute petite île de France perdue dans la mer des Indes, a veillé, a travaillé sans tapage dans les intérêts de la France ; elle a envoyé des braves planter à Sainte-Marie, planter aux îles Comores, planter sur la Grande Côte ! Et, au bout du compte, à force de planter, elle s’est implantée à Madagascar... (267)
Tout cela est évidemment est supposé faire un avenir pour les blancs des Hauts, singulièrement investis d’une mission civilisatrice (avec une opposition que l’éradiction du paludisme - une grand-mère de Salazie raconte qu’elle ne voulait pas descendre à Saint-Denis pour ne pas attraper le palu - et la mode des plages introduite par les zoreils a complètement retournée) : “Ah ! mon cher - s’écria-t-il, - autant les gens du littoral vous attristent en pleurant fièvre et pauvreté comme des Malabares, autant cette souche de petits blancs des hauts vous fouette le cœur !... Il n’y a pas à s’y tromper : voilà le pur sang de notre race. Voilà notre réserve intacte pour l’avenir. Et quels braves frères ! Ça a des pattes jaunes, mais le coeur est plus propre qu’un galet de rivière ; ça bégaie du bout de la langue, mais le fond du sentiment est toujours clair comme l’eau de roche ! On mange patates et maïs de la misère, tout de même on noue mariage à vingt ans et la femme fait beaucoup d’enfants... (270) Les Leblond veulent croire qu’“il grandit dans le pays non seulement en ville mais à la campagne une élite de jeunes gens qui se savent doués et cependant condamnés à languir toujours dans la médiocrité ?.. Leur sort est le même que celui de la colonie, qui, jusqu’ici, a dépéri parce qu’elle est trop éloignée de la France... Mais ce plan de survie fait-il un avenir pour la Réunion ?
3°) La Réunion, “métropole seconde”, “colonie colonisatrice”
Le problème que voient les Leblond, c’est que “Bourbon flotte à la dérive !” (M. 189) Se rattacher à la métropole (“Pour tout créole, qui souffre de ne point aller en France, appartenir au Gouvernement, c’est se rattacher plus étroitement à la Métropole, dans le cadre de l’État !”) constitue sans doute un avenir, mais aussi une fausse sécurité. “Fils de plusieurs générations de cadets aventureux qui, par l’Afrique et l’Asie, ont risqué vie et fortune, il trouve là, dans un besoin de revanche, les situations de quiétude chères aux descendants de ceux chez qui l’initiative militante de l’homme a été lassée par les intempéries du ciel tropical” (183). Car “les hommes de [ce] pays [pourtant] bons, meilleurs à mesure qu’ils vieillissaient” sont trop souvent gagnés par “l’oisiveté intellectuelle”. “Ce qui le choquait vraiment, c’était la paresse d’esprit générale, le dédain de la lecture insolent comme une prétention à l’ignorance.” (184) En réalité “c’est l’Inde qui, dans l’esprit des Richelieu et des Colbert, devait former notre vrai continent d’attache !... A quelle terre sommes-nous donc reliés maintenant ?.. Maurice et Seychelles ont l’Inde et l’Afrique du Sud. Bourbon flotte à la dérive !... - Aujourd’hui c’est pour Paris que nos jeunes gens filent droit. Y gagnons-nous ? Et notre île, qui pourrait rendre le décuple, agonise de quelque chose de bien plus grave que tout : l’absentéisme des intelligences !... (188-189) La solution serait d’arrimer Madagascar à la Réunion...
La concurrence économique des autres races démontre qu’on est dans un espace économique ouvert, où la préférence coloniale est déjà en question...
“L’Histoire se voit obligée d’enregistrer que Chinois, Hindous et Arabes ont complètement dépossédé les Français (Métropolitains ou créoles) du Commerce de Détail et d’une forte part du Négoce de gros : ces étrangers, pour la plupart incultes, improbes et impropres, drainent un autre tiers du revenu qui s’évade plus ou moins frauduleusement vers leurs pays d’origine.” (215)
 Thème de recherche n° 7 : Thème de recherche n° 7 :
La crise de l’assimilation : Train fou, le dernier roman d’Axel Gauvin
(Analyse critique en cours)
 III - LA RÉUNION AUJOURD’HUI III - LA RÉUNION AUJOURD’HUI
 Thème de recherche n° 8 : Thème de recherche n° 8 :
(repris de Vingt ans après)
La Réunion d’aujourd’hui ; un paradoxe de la départementalisation : promotion matérielle et insatisfaction identitaire ; l’égalité sociale n’a pas comblé le besoin d’identité
L’évolution de la Réunion, imprévue des Leblond... : où la métropole est cette fois “descendue” pour de bon sur la Réunion, c’est la départementalisation (et même la bi-départementalisation, actuellement en débat et annoncée par le ministre Queyranne).
Le premier choc, quand on débarque à la Réunion et qu’on a un peu voyagé, passé l’éblouissement de la diversité humaine, c’est l’absence de choc : qu’à 10.000 kilomètres de la métropole, l’infrastructure routière soit semblable, les voitures de la poste jaunes, les poubelles de même facture, l’enseigne des supermarchés, la disposition des rayons, les denrées et les articles à l’identique : la Réunion est un département français. Le second choc c’est, bien entendu, lorsqu’on s’écarte de la frange de prospérité littorale, celui des signes évidents de sous-développement : la Réunion, profondément marquée dans sa constitution et dans son peuplement par la colonisation, est une “isle à sucre” et son entrée dans le monde moderne est commandée par cette histoire. Colonie de peuplement dès l’origine et département depuis un demi-siècle. Votée en 1946, alors que la guerre a laissé l’île dans un état de délabrement matériel, sanitaire et moral qui rend la réalité d’aujourd’hui proprement incroyable à ceux qui ont connu cette période, la départementalisation ne sera véritablement mise en œuvre, on le sait, que sous et par Michel Debré. Et ce, dans un contexte de guerre froide justifiant, mélange de calcul politique et de tradition jacobine (le mot d’ordre d’autonomie du P.C.R. faisant alors de ce parti l’acteur involontaire de cette départementalisation refusée), un investissement national considérable. Cette intégration dans la communauté nationale peut se résumer (en forçant le trait) dans le passage presque sans transition d’une économie servile à une économie sociale, ou d’une économie de plantation à une économie “keynésienne”. Cette coexistence de sous-développement et de prospérité, justement, la presse métropolitaine, relatant les “événements du Chaudron” de 1991, la caractérisait en rapportant (l’information est d’ailleurs inexacte) que la Réunion était le département français où l’on comptait en même temps le plus fort taux de bénéficiaires du RMI et le plus fort taux de foyers fiscaux imposés sur la grande fortune. Mais ce qui frappe en réalité à la Réunion, ce n’est pas tant la différence entre riches et pauvres, c’est le fossé entre le passé encore visible et vivant et le présent fraîchement importé, entre une techno-structure administrative, juridique et économique importée et la réalité socio-culturelle : la langue de l’administration, quoique généralement comprise, n’est pas la langue vernaculaire, les acteurs de la techno-structure sont exceptionnellement réunionnais alors, pourtant, que les Réunionnais occupent les métiers politiques et la consommation excède plus de dix fois la production de richesses. Troisième choc, en effet, sinon le premier, qui exprime ce fossé, c’est, si l’on me permet cette formule paradoxale que j’extrapole d’une remarque d’Aimé Césaire, la richesse des pauvres : qui se marque spectaculairement dans l’importance et le luxe du parc automobile.
Si tout cela fait système et si ce système “tourne”, c’est qu’une logique et un équilibre s’y expriment - et qu’il engendre du profit. La quotidienneté urbaine ne donne nullement l’impression d’une société en crise, malgré les éruptions du Chaudron. C’est plutôt la prospérité des supermarchés qui étonne : en dix ans, La Réunion a fait le chemin parcouru en trente années par la métropole. La “richesse des pauvres” fait évidement le bonheur des sociétés de crédit, d’ailleurs contrôlées par les principaux concessionnaires. La Réunion constitue un marché non négligeable (déstockage et marché du travail compris) pour les produits et les hommes qui arrivent “du froid” et les flux financiers font retour en métropole, pour l’essentiel, après avoir enrichi les commissionnaires locaux. Le cliché d’“économie assistée” par lequel on stigmatise la Réunion, mériterait à cet égard d’être corrigé par une donnée complémentaire, sinon symétrique : celui de la Réunion, marché de la métropole... En fait, ces trois observations, dans leur banalité, - une île à sucre, un département, un supermarché -, décrivent l’émergence et le jeu des strates socio-historiques qui structurent la société réunionnaise d’aujourd’hui. C’est cet “instantané” que la recherche aura à développer.
Si, ouvrant quelque livre d’histoire, on compare la Réunion d’hier à celle d’aujourd’hui, on ne peut manquer d’être frappé par un autre contraste. Avec toutes ses injustices, ses injustices d’un autre temps, la société de plantation, pour user d’une appellation proposée dans les années soixante par Beckford, allait quelque part. Un voyageur qui visite la Réunion en 1860 y décrit les habitants “exclusivement occupés de s’enrichir le plus tôt possible. Le sucre est leur veau d’or, écrit-il, et tout ce qui ne s’y rapporte pas n’a (aucun) prix pour eux”. La Réunion est alors une des gloires de la France du Second Empire. A la pointe de l’innovation et du progrès technique pour tout ce qui regarde le sucre, elle remporte - titre de fierté souvent cité -, plus de cinquante médailles à l’Exposition Universelle de 1856. Comment expliquer que cette île phare soit aujourd’hui le département français qui compte le plus de bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion ? Un descendant de ces familles d’entrepreneurs qui ont fait la Réunion et qui dit être réunionnais depuis 320 ans affirme que, dès le début du XXe siècle, ces pionniers avaient quitté l’île pour d’autres aventures, en métropole, en Indochine, en Nouvelle-Calédonie ou à Madagascar...
C’est donc une autre histoire qui paraît commencer avec la départementalisation. Sur les vestiges de la société de plantation abandonnée par ses promoteurs, une économie sociale fondée sur les notions de rattrapage et de réparation va se mettre en place. Elle vise à donner aux acteurs passifs de l’économie de plantation en crise et de l’économie paysanne de survie qui l’environne les moyens du développement. En réalité, la départementalisation va progressivement sortir le sucre (qui restera la principale production de l’île) de l’économie de marché, à la faveur d’un processus dont on peut résumer le scénario et l’inspiration comme suit. Profitant du mouvement de replantation d’après-guerre et d’une période de croissance qui s’achèvera en 1954, un certain nombre de propriétaires, hostiles à la départementalisation, vont vendre leurs plantations à l’État par l’intermédiaire des sociétés d’aménagement. Alors qu’une logique implacable de concentration des terres a marqué l’histoire de la canne tout au long du XIXe siècle, le morcellement des grandes propriétés et la redistribution, avec le relais du Crédit Agricole, en lots nécessairement découpés au-dessous du seuil de rentabilité (et ce malgré des gains de productivité obtenus grâce au soutien agronomique et technologique des organismes officiels), sont donnés comme alternative aux lois du marché. L’application du SMIC va, de surcroît, multiplier le nombre de colons. Durant les dix années d’après-guerre, l’État injectera dix milliards de francs dans la filière. Alors que les contraintes du marché obligent à produire plus pour abaisser les coûts, objectif qui se réalise généralement par l’extension des surfaces, la canne est aujourd’hui achetée au planteur à un prix inversement proportionnel à la surface qu’il cultive. Le traitement social de l’agriculture n’est évidemment pas une spécificité réunionnaise, ses concepteurs ayant appliqué des recettes leur ayant déjà servi à administrer la “fin des paysans” en métropole. A ceci près qu’il s’agissait ici de créer une nouvelle paysannerie.
Si la société de plantation était une machine à broyer qui produisait de la richesse - on pense évidemment avec cette image à la Critique de la Faculté de juger -, la départementalisation se révèle être une machine à produire de l’égalité dont on peut se demander pourquoi elle n’a pu engendrer que cette économie d’import-distribution si caractéristique de la quotidienneté d’aujourd’hui. Un élément de réponse tient dans le fait que l’argent du sucre, alors que s’offrait à lui le marché sans risque de la distribution induit par l’équipement de l’île, le traitement des fonctionnaires et l’aide sociale, n’avait pas de raison de s’investir dans la production de biens et dans la création d’emplois (comme cela a pu se passer à Maurice). En trente ans, le chiffre des importations a été multiplié par cent. Par une inversion du mouvement de peuplement des Hauts (peuplement provoqué par la concentration des exploitations sucrières, la paupérisation des Blancs, le marronnage, l’émancipation des esclaves), l’exode rural a fait refluer les habitants vers les agglomérations côtières de la ceinture sucrière. Cet exode, reflux du mouvement de civilisation des Hauts qui retournent en friche, ne correspond nullement à ce qui a pu se passer dans les campagnes européennes où la fin des paysans a nourri le développement industriel (il y a 8 000 emplois industriels à la Réunion pour 650 000 habitants). Les maires, autrefois sucriers ou représentants de l’économie du sucre, sont devenus les intermédiaires de l’économie sociale. Principaux entrepreneurs de l’île par le biais des emplois communaux et des C.E.S., ils reconduisent à leur profit, grâce à l’aide publique, un clientélisme dont les caisses étaient autrefois alimentées par la rente du sucre. C’est la fin d’un monde dur où “il n’y avait rien pour celui qui ne travaillait pas”, selon une expression souvent employée par ceux qui ont connu cette période, la mise en place du R.M.I. après l’accession de la gauche au pouvoir ayant d’ailleurs révélé une misère persistante. La population double en l’espace d’une génération. Près d’une personne sur deux en âge de travailler est aujourd’hui sans emploi...
 Thème de recherche n° 9 : Thème de recherche n° 9 :
(repris de Vingt ans après)
Le sucre (voir fiche de lecture de l'ouvrage de Sidney Mintz : Sucre blanc, misère noire)
Quand on cherche à décrire le réel selon l’ordre des raisons, toutes les causes ne sont pas équivalentes. C’est le “premier moteur” qui doit être identifié. Et c’est évidemment du sucre et de l’esclavage qu’il faut partir pour comprendre la situation d’aujourd’hui. Pour prendre encore une fois encore un chemin de traverse, on rappellera trois données dont la rencontre a changé la face du monde et qui ont contribué à faire de la Réunion ce qu’elle est aujourd’hui. La première, c’est que le jus de la canne ne se conserve pas et que, à la différence d’autres denrées tropicales, il doit être transformé sur place : la plantation doit aussi être une usine. La deuxième, c’est que le sucre, qui était une épice et un médicament (comme l’atteste son nom latin), a pu devenir un produit de consommation courante : premier article de luxe bon marché (si l’on peut dire), le sucre a suscité une aventure agro-industrielle et commerciale sans précédent. La troisième, c’est que la réunion de ces deux facteurs a provoqué la migration, forcée ou volontaire, d’environ cent millions de personnes dans le monde : l’éblouissement de la diversité humaine qu’on éprouve en arrivant à la Réunion tient là son origine.
C’est le sucre, avec son économie particulière, qui a façonné la société réunionnaise. On a pu dire que la culture de la canne à sucre avait opéré la synthèse du champ et de l’usine, appelant un contrôle de la terre et des moulins, de la main-d’œuvre et du capital et qu’elle avait anticipé la révolution industrielle. La production du sucre requiert en effet une planification rigoureuse de la terre et des hommes. La canne doit être coupée dès qu’elle est arrivée à maturité et broyée aussitôt coupée. Culture et coupe, broyage, ébullition et cristallisation, travail de la terre et travail de l’usine doivent être étroitement synchronisés. “Il y a des pays, disait Montesquieu, où l’on peut presque tout faire avec des hommes libres”. Cela n’est évidemment pas le cas des pays et des “isles à sucre”, aux populations décimées, hostiles, indifférentes au salaire, ou encore inhabitées, comme la Réunion. Il apparaît une relation de nécessité entre l’esclavage et le sucre. Au milieu du IXe siècle une révolte d’esclaves de la canne eut lieu au Moyen-Orient dans le delta du Tigre et de l’Euphrate. C’est l’implantation de la culture de la canne à Saint-Domingue, les Indiens Taino exterminés, qui est à l’origine des premiers convois de traite, dès le début du XVIe siècle. La production du sucre requiert une concentration de main-d’œuvre qui, dans les conditions géographiques et historiques données n’a pu être mise en œuvre que par la coercition, avec les formes d’asservissement plus ou moins extrêmes que l’on sait. Concentration de moyens humains et matériels et synthèse technologique, c’était déjà les caractères déployés par les Arabes lorsqu’ils portèrent la canne jusqu’à Valence et Agadir, aux limites septentrionales et méridionales de la Méditerranée, exportant des techniques de culture et d’irrigation empruntées au Moyen-Orient. Il apparaît aussi une relation nécessaire entre l’expansion politique, avec ce qu’elle suppose de mobilisation humaine, technique et idéologique et l’exploitation de terres ouvertes par la conquête. Les cultures commerciales, dont la canne est le prototype, telles que les pays d’Occident les ont pratiquées constituant une manière d’achèvement de cette entreprise. On change alors, en effet, d’échelle géographique et économique. La crise économique que connaît l’Europe au XVIe siècle se résout dans un basculement des échanges de la Méditerranée et de la Baltique vers les pays ouverts par la circumnavigation et principalement vers l’Amérique sous la forme du commerce “circuiteux” ou du commerce “en droiture”. Conquête, production, commerce sont les trois agents de la révolution mercantile qui se nourrit de propre développement. “Notre commerce avec nos Plantations ou Colonies des Indes Occidentales, pouvait écrire J. Pollexfen en 1697, nous débarrasse d’une grande quantité de nos Produits et Marchandises Manufacturés, Comestibles et Articles Artisanaux, et nous fournit en Marchandises requérant une Manufacture plus poussée et autres (produits) en abondance que nous pouvons Exporter aux Nations Étrangères”. Des terres conquises, exploitées par des plantations fournies de main-d’œuvre et d’outils, donc une marine de guerre et une marine de commerce, des entrepreneurs et des esclaves. Un marché de consommateurs européens en expansion propre à absorber les productions tropicales et à les transformer, donc des hommes libres. Le capitalisme originel conjugue l’esprit d’entreprise et la coercition.
À la Réunion, où l’implantation de la canne, consécutive à la perte de Saint-Domingue, est tardive, l’extension se fait aux dépens des cultures vivrières et à la faveur d’un défrichement vers les Hauts. La surface des terres cultivées double au cours du XIXe siècle. Les planteurs sont des entrepreneurs et la main-d’œuvre, fixée autour de l’usine, est maintenue dans un état de dépendance qui n’est pas moindre en liberté qu’en servitude. “Durant mon séjour à Barrio Jauca, écrit Sidney Mintz parlant de Porto-Rico mais en des termes qui auraient pu décrire la ceinture sucrière de la Réunion, je me sentais comme dans une île, flottant sur une mer de canne à sucre... Tout évoquait une époque ancienne. Seul manquait le claquement du fouet.(...) Ces gens n’étaient pas des fermiers pour qui la production de biens agricoles était une entreprise commerciale ; ce n’étaient pas non plus des paysans, travaillant une terre qui leur appartenait ou qu’ils pouvaient considérer comme étant la leur, et donc faisant partie d’un mode de vie caractéristique. C’étaient des ouvriers agricoles qui ne possédaient ni terre ni moyens de production et qui devaient vendre leur travail pour survivre. C’étaient des salariés qui vivaient comme des ouvriers d’usine, qui travaillaient dans des usines installées à la campagne et qui achetaient dans les magasins la plus grande partie de ce dont ils avaient besoin. La plupart de ces produits venaient d’ailleurs : tissus et vêtements, chaussures, blocs de papier à lettre, riz, huile d’olive, matériaux de construction, médicaments. A quelques exceptions près, ils consommaient ce que quelqu’un d’autre avait produit.”
La fin de la plantation, frappée d’obsolescence morale et sociale, doit donc être comprise avec toutes les conséquences que comporte la liquidation d’une industrie quand les hommes qui ont été déportés et rapprochés à cet effet sont eux-mêmes abandonnés sur le site, comme les rouages désunis d’un calcul dans lequel ils n’étaient que des acteurs passifs. Ce drame humain n’est pourtant pas comparable au sinistre industriel de la mine ou de l’usine. Livrant à eux-mêmes des hommes déshumanisés par l’esclavage, entretenus dans une situation de minorité fonctionnelle après avoir été arrachés à leur milieu, cet abandon redouble en l’inversant le préjudice de la servitude. J’illustrerai les effets rémanents de cette déculturation par un courrier des lecteurs paru après une émission de R.F.O. sur l’esclavage. Ce point de vue proposait d’expliquer les stigmates de l’esclavage par un reportage d’une chaîne américaine sur les gangs d’enfants noirs à Chicago. “On y voit une grand-mère dont le petit-fils, âgé de quinze ans, sort de prison : il a tué deux membres d’un gang rival. Non ! Elle ne croit pas du tout que son garçon soit un criminel. C’est un bon petit ! Et puis elle change tout à coup de discours et se met à expliquer avec une véhémence contenue : ‘Il y a des usines pour recycler le plastique ; il y a des usines pour recycler le verre ; il y a des usines pour recycler le papier ; il y a des usines pour recycler le métal. Mais vous êtes Noir, homme, femme, enfant, vous n’avez pas de travail et pas d’argent, vous êtes fini !... Le Noir est jetable ; il est perdu !’ Le crime de l’esclavage, c’est aussi d’avoir brisé le ressort qui permet aux hommes, sous toutes les latitudes, de s’adapter au monde et de prendre en main leur destin.” Après l’abolition de 1848, la moitié des esclaves libérés se dérobèrent au contrat d’engagement qu’ils étaient incités à signer. Acteur de cette époque, de Châteauvieux écrit : “Ils désertèrent les grands ateliers et se répandirent sur les grandes propriétés où un sol médiocre avait été laissé sans culture. Ils prenaient des fermages a moitié de revenus... Mais ce qu’ils ambitionnaient avant tout c’était d’avoir un lieu pour y établir une demeure, y élever des animaux domestiques et y vivre en famille, sans se préoccuper de l’avenir ni souvent même d’assurer leur subsistance par des cultures bien entretenues.” Indice de cette déshérence sociale qui fait continuité avec aujourd’hui : en 1847, la consommation d’alcool était de 5 litres par habitant, elle sera de 10 litres en 1862. Le nombre de débits de boisson est multiplié par quinze entre 1850 et 1862. Aujourd’hui, selon l’association “Vie libre”, le département compte 100 000 malades alcooliques, 70 % des RMistes étant atteints, l’alcool étant directement ou indirectement responsable d’une hospitalisation sur quatre et de 60 % des hospitalisations psychiatriques.
 Thème de recherche n° 10 : Thème de recherche n° 10 :
(repris de Vingt ans après)
La “réparation”
La vie politique et sociale de la Réunion d’aujourd’hui est d’évidence marquée par cette histoire du sucre : paysage agricole et paysage humain, ceinture sucrière et paysans des Hauts, concentration des terres et paupérisation des “Petits Blancs”, esclavage et engagisme. Aucune activité économique n’ayant à ce jour remplacé la plantation, qui aurait réuni les parts contraires de cet héritage, cette machine à broyer continue à vivre dans les consciences. La départementalisation, dont c’était pourtant un objet, n’a nullement effacé cette histoire. Rattrapage et réparation, au lieu d’égaliser les chances en réalisant l’égalité sociale, ont légitimé et légalisé ce couple du ressentiment et de la mauvaise conscience que la Réunion d’aujourd’hui forme avec la métropole. Cette idéologie de la réparation a pour propre d’engendrer une insatisfaction par définition jamais comblée puisqu’elle se nourrit des preuves mêmes de cette réparation. Ce n’est pas seulement dire que le dommage ne sera jamais réparé - puisqu’il est accompli et par là même irrémissible -, c’est aussi constater que la réparation enchaîne les partenaires, engendre la dépendance, et perpétue le crime. Aujourd’hui que les prestations sociales sont identiques à la Réunion et en métropole et que l’“égalité” est atteinte, vient de naître, juste de retour des “assises de l’égalité” tenues à Paris, un mouvement dénommé : “Égalité plus”.
Cette valeur de réparation détermine l’action de ceux qui parlent au nom des exclus et qui, dans le mouvement général de décolonisation qui caractérisait l’époque, militaient pour l’autonomie. La section locale du P.C.F. est devenue Parti Communiste Réunionnais pour préparer l’indépendance. Calcul et culpabilité engagent alors le pouvoir dans une politique d’équipement des DOM qui vise à combler le retard avec la métropole et à “faire entrer la Réunion dans le XXe siècle”. La revendication identitaire, qui voulait nationaliser le sucre, réclamant l’autonomie avec une aide annuelle de l’État de huit milliards de francs, indexée sur l’inflation, “en compensation de trois siècles d’esclavage”, se convertit alors à la départementalisation et se pourvoit sur ce dédommagement. En réalité, le tournant politique est pris, alors que l’esprit du temps paraît pourtant imposer l’indépendance, quand il devient patent que la “socialisation” du sucre engendrera régression sociale et régression économique. Le sucre n’étant concurrentiel que dans les conditions de concentration des terres et d’exploitation des hommes éprouvées, les indépendantistes eussent dû, comme Toussaint-Louverture en son temps (qui instituait dans sa Constitution de 1801 - “triste instrument législatif” écrira un Victor Schoelcher désabusé de son héros -, un servage encadré de mesures policières, préfiguration, peut-être, des modernes kolkhozes), restaurer la plantation. L’année 1975 voit d’ailleurs à la fois l’élection de Giscard d’Estaing, réputé partisan de l’autonomie des DOM, à la présidence de la République et une nouvelle crise de l’économie sucrière.
 Thème de recherche n° 11 : Thème de recherche n° 11 :
(repris de Vingt ans après)
L’économie de la départementalisation et l’économie de l’identité
En réalité, la départementalisation, à partir des années Debré, avec l’équipement routier, urbain, sanitaire, administratif et scolaire de l’île a été la seule activité économique - pour parler bref -, à prendre le relais de la société de plantation, égalisant les représentations et les valeurs mais perpétuant les rôles, pour l’essentiel. Le choc culturel a été à la mesure de l’abîme existant entre la colonie et sa métropole et de la ruine où se trouvait la Réunion en 1945 où, pour prendre un exemple qui dispense d’autres chiffres, le taux de mortalité infantile était de 145 pour mille. Il faut avoir vu une veste telle que pouvait en porter un membre de la classe moyenne à la fin de la guerre pour comprendre l’isolement et la détresse de l’île à cette époque, et savoir qu’aujourd’hui le chiffre d’affaires engendré par l’habillement est de un milliard sept cents millions de francs pour mesurer l’écart.
L’équation de la départementalisation était contenue dans cette déclaration de Léon de Lepervanche qui en réclamait le légitime bénéfice devant l’Assemblée nationale : “Depuis 1935, la formule ‘La Réunion département français’ inscrite sur les banderoles lors des manifestations ouvrières clamait la confiance de nos compatriotes en cette démocratie française à l’écart de laquelle ils étaient tenus. (...) Nous tenons à dire que nous ne connaissons pas les profondes différences qui existeraient entre nos populations et celles de la métropole. Il n’y a en effet chez nous aucun problème d’ordre linguistique, culturel et national.” Ce qui fonde la départementalisation, c’est évidemment l’appartenance sans différence à la communauté nationale. Cela signifie que la langue créole n’est pas une langue à part, mais un héritage original du français, que la culture créole est marquée de façon indélébile par le Code civil et que l’identité réunionnaise est impensable hors cette appartenance. Le statut départemental se justifie, en ce sens, par l’histoire propre des “quatre vieilles”, colonies de peuplement façonnées par la société de plantation. Françaises jusque dans les dernières conséquences de cette économie aujourd’hui disparue. La spécificité réunionnaise n’aurait donc en propre, selon cette logique - avec ses “droits spéciaux” que le Code lui reconnaît -, que les traits particuliers de cette organisation des hommes et non cette particularité de langue, de culture et d’identité qui fait les nations.
La société réunionnaise, à la profondeur historique faible et à la pluri-ethnicité marquée est une réunion d’immigrés, forcés ou volontaires, assemblés et organisés pour les besoins de la plantation. Le devenir de ces éléments, une fois le pouvoir d’organisation et de coercition de cette économie épuisé et une fois rendus à leur identité, est bien entendu fonction de leur place dans le procès de production et, vraisemblablement aussi, de la capacité d’adaptation qu’ils ont pu sauver de cette entreprise qui a brisé ou marginalisé les plus faibles. En 1840, la population blanche était composée pour deux tiers d’indigents. Ceux-là, qui sont retournés aux franges de la civilisation peupler les Hauts, des Cadet, des Dieudonné et autres fils de famille désargentés grattant la terre avec leur particule (et qu’on voit quelquefois réapparaître aujourd’hui à la rubrique des faits divers pour un coup de sabre à canne donné sous l’empire de l’alcool à un voisin de misère), partagent avec les descendants des esclaves l’image la plus dévalorisée. Bien que le métissage soit ancien et, pour ainsi dire à la fois originel et consubstantiel à la Réunion, bien que la plupart des Réunionnais soient “mélangés”, on constate dans la vie quotidienne une utilisation, et donc une fonctionnalité, de jugements distinctifs référés au phénotype et à une “ethnicité” plus qu’incertaine puisque déjà brouillée aussi bien dans les traits que dans les généalogies. Paradoxalement, ces vestiges physiques d’appartenance font l’objet d’un investissement sémantique et psychologique qui est supposé révéler les identités profondes. Cette carte psycho-cognitive de l’altérité et de la différenciation sociale - l’ensemble des préjugements, des a priori, des stéréotypes -, vise bien entendu, quand cela est possible, la substantialisation, la reproduction ou la sauvegarde de réseaux d’affinité à finalité économique (à tout le moins, une identification sentimentale à telle ou telle “communauté”). Sous la loi de l’indifférence raciale qu’est la loi républicaine, la seule ségrégation pertinente est de nature économique, on le sait. Tous les hommes sont supposés égaux, sinon devant la richesse - il s’en faut - du moins devant les moyens de l’acquérir. Mais nul n’ignore que dans l’espace social ouvert par cette indifférence formelle jouent des cultures, implicites ou parallèles mais déterminantes, qui portent non seulement sur la transmission des biens mais sur les techniques d’acquisition et de conservation de ces biens. La culture de l’identité, précisément, la religion, le système matrimonial (“le mariage est la moitié de la religion”, dit un livre sacré, la fabrication communautaire de l’identité étant l’autre moitié, on peut le supposer), l’éducation des valeurs y travaillent. Dans une société créole, la condition nécessaire et suffisante pour être reconnu comme “Chinois”, par exemple, n’est pas d’avoir quatre quartiers en Chine, mais de se reconnaître et d’être reconnu comme tel. Ce qui suppose l’activité de critères minimaux (et non optimaux), l’important pour un “Chinois créole” étant aujourd’hui, me semble-t-il, si l’aspiration de ces catégorisations où le religieux et le social priment l’ethnique est bien de naturaliser des situations existantes ou d’anticiper une différenciation à qui il ne manque qu’un statut, d’être “quelque chose” de Chinois avant d’être créole - ce qui le prédispose d’ailleurs à “faire chinois” vis-à-vis de tous les autres créoles. Cette revendication n’a qu’un sens privé dans des conditions de simple survie et ne devient véritablement opératoire que lorsqu’il est question de partage ou de transmission. Dans la nuit de la servitude, tous les hommes sont gris. Ce que vérifie une thèse en cours portant sur trois siècles de mariage à Saint-Leu, thèse qui fait apparaître la non pertinence des clivages ethniques dans les mariages sans contrat de mariage. C’est contre ceux-là qui n’ont pu tirer du jeu social les éléments positifs de leur différence (qui n’ont pu “positiver leur différence”, pour causer jargon) - que leur différence paraît assigner, à l’inverse, aux rôles dévalués -, que les stéréotypes sont le plus stigmatisant et qu’opère la différenciation en vertu de ce principe universel qui veut que ceux qui sont différents soient déjà suspects sinon toujours mauvais et que ce qui s’oppose à moi est nécessairement différent (ce qui apparaît immédiatement dans la satisfaction intellectuelle et morale qu’il y a à constater que le désaccord que je peux avoir avec mon voisin était déjà visible et lisible dans son appartenance : “Espèce de....”). La pluri-ethnicité paraît à cet égard offrir un secours supplémentaire aux voies de la pseudo-spéciation et de la compétition sociale.
Le destin des différentes communautés réunionnaises - quand elles se revendiquent comme telles -, est, en effet, contrasté et leur situation relative d’aujourd’hui dépend de la manière dont elles ont pu s’insérer dans le processus économique de la départementalisation. C’est dire que l’identité créole - selon le sens que cette expression prend aujourd’hui - pourrait bien être cette cotte qui va à tous, puisqu’elle consacre la part d’histoire commune, mais qui ne sied véritablement qu’à ceux qui n’ont pas les moyens économiques d’une autre identité. C’est de part et d’autre du comptoir de cette économie de comptoir que se définit la réalité sociale de l’île et que réside la véritable fracture. Il ne s’agit plus d’une minorité qui vivait de l’extraction du travail de la majorité dont elle organisait l’emploi, mais davantage - et bien que la blessure de cette dernière image soit encore vive -, d’une minorité qui vit indirectement du revenu du reste de la population : des salaires de la fonction publique (près d’un emploi sur deux), de l’investissement national dans le département et des transferts sociaux. Il n’y a pas, au sens strict, de communautés à la Réunion, mais tous les Réunionnais ont l’air de savoir qui fait quoi. De toute éternité. Ces sociétés anonymes, “ethniquement” identifiées, nées du sucre, du textile ou de la boutique sont supposées entretenir un paternalisme de clientèle et une endogamie économique qui leur permet de vivre à part de la société globale. Bien que l’économie sociale autorise une participation relative de la plupart à cet équivoque banquet de la consommation (pour ne pas citer Malthus) dont ils sont les principaux auxiliaires, ces groupes sont explicitement visés comme tels - pendant les émeutes du Chaudron par exemple - et stigmatisés de manière récurrente dans les stéréotypes et les jugements, avec une violence verbale qui défie parfois la citation.
 Thème de recherche n° 12 : Thème de recherche n° 12 :
(repris de Vingt ans après)
La Réunion “pied de riz”
Un informateur, Réunionnais qui n’était pas rentré au pays depuis une dizaine d’années, s’étonnait en ces termes de la formidable transformation de l’île : “Il doit y avoir une mine d’or quelque part à la Réunion !” Un filon de cette mine, c’est vraisemblablement le salaire indexé des fonctionnaires, aligné à ce titre sur celui des expatriés (il s’agissait à l’origine d’une “prime coloniale”) qui explique qu’à la Réunion, un emploi dans la fonction publique coûte à l’État 50 % plus cher qu’en métropole et qu’une cantinière réunionnaise (figure emblématique de la vie politique locale) gagne davantage qu’une institutrice parisienne. C’est le “standing de 40 000 privilégiés” dont parlait le préfet Perreau-Pradier en 1960. S’il n’y a pas de “communalisme” à la Réunion (expression par laquelle on désigne, à Maurice notamment, l’exclusivisme ethnico-religieux) s’il n’y pas, non plus, de “malaise créole” (expression par laquelle on désigne à Maurice l’exclusion économique des descendants d’esclaves), bien que les milieux défavorisés soient majoritairement de cette origine, c’est que le matérialisme républicain fournit à la fois le mode d’emploi consumériste, le consommateur et les biens de consommation - et engendre une apparence de sécurité parfaitement exprimée par cette “une” du Journal de l’Ile : “Grève d’Air France : la Réunion va manquer de produits frais”. Le calendrier liturgique réunionnais est rythmé par tous les anniversaires des ouvertures de supermarchés et autres distributeurs qui investissent chaque année 60 millions de francs dans la seule publicité qui est distribuée dans les boîtes aux lettres. Pour en rester au plus voyant, le parc automobile qui frappe par son importance, son luxe et sa nouveauté : en 1995, la proportion de véhicules de moins de cinq ans était de 51,3 %, pour 210 000 véhicules, alors qu’il n’est que de 40 % en métropole. Le chiffre d’affaires engendré par l’automobile, qui absorbe avec l’équipement 40 % du PIB, a été de 5 milliards et demi en 1994 et le réseau routier est saturé : près d’une voiture tous les dix mètres. Le taux d’accroissement des cinq dernières années a été quatre fois celui de la métropole.... Alors que le marché de l’automobile est en crise, les 30 000 immatriculations seront probablement atteintes en 1996.
Un slogan de la départementalisation était : “En abattant les grands arbres, on pourra laisser pousser les petits”. Mais, comme on a pu le dire : “Le cordonnier n’est pas devenu fabricant de chaussures, le tailleur n’est pas devenu fabricant de vêtements. Ils ont même disparu.” En réalité, la départementalisation et la décentralisation ont permis l’émergence d’une élite économique et politique de concessionnaires, créant pratiquement de toutes pièces une “classe moyenne” qui n’existe nulle part ailleurs que dans les départements d’Outre-mer français (une caractéristique de la société de plantation étant précisément l’absence de classe moyenne). Ceux qui n’étaient pas nés dans le commerce se sont spécialisés dans l’esthétique de la réparation et font carrière dans la politique. Ce sont ces politiques qui gèrent le difficile équilibre de l’identité créole et de l’investissement national, associant dans une sorte de double bind la revendication anti-coloniale et la protection paternelle, la citoyenneté et la justice. Cette économie sociale, cette économie blanche - sans production de biens -, laisse en déshérence, sans projet et sans travail, une part majeure de la population réunionnaise.
 Thème de recherche n° 13 : Thème de recherche n° 13 :
(repris de Vingt ans après)
“La Réunion qui gagne”
“La Réunion qui gagne”, pour reprendre la une d’un quotidien, n’a rien à voir avec les succès de Maurice (où 32 % des voitures ont plus de quinze ans) dont l’ambition est de devenir, à l’instar des pays asiatiques, le dragon du sud-ouest de l’Océan indien. La Réunion qui gagne, c’est la Réunion qui joue. C’est un joueur de loto du Port qui encaisse le gros lot... En 1992, les Réunionnais ont dépensé 930 millions de francs dans les jeux. C’est l’équivalent du RMI. 501 millions pour le PMU en 1993, sans hippodrome et sans chevaux. La Française des Jeux y réalise à la Réunion 2,8% de ses recettes (pour un centième de la population). Il existe 158 points de vente informatisés en temps réel. L’administrateur régional de la “Française des Jeux” a dû démentir une information de Free Dom expliquant sur les ondes que les billets de loterie vendus à la Réunion comportaient moins de gagnants. Non, non ! Le loto est démocratique et ne pratique aucune ségrégation : “Nous avons déjà envoyé tourner la roue du Millionnaire” à 119 Réunionnais sur un total de 3 000 (gagnants). “Ce qui fait près de quatre fois la moyenne nationale par habitant et correspond très exactement au pourcentage de billets vendus” (le Quotidien du 3.mai1994). A l’inverse, et au vu de cette fréquence sans doute, certains métropolitains pensent qu’il y a davantage de billets gagnants à la Réunion... C’est pourquoi des touristes en font provision.
En juin 1993, la Police de l’Air et des frontières, à la suite de plusieurs plaintes ayant donné lieu à des arrestations, enregistrait une trentaine de départs de “marabouts” africains. “Les marabouts sont de retour” titrait pourtant récemment un quotidien. Le marketing, les périples commerciaux et la périodicité migratoire de ces “marabouts” montrent qu’il existe un marché de l’occultisme spécifique à la Réunion et dans les DOM. L’ordonnance du 2 novembre 1985 sur le droit de séjour des étrangers n’autorisant qu’une présence ne pouvant pas dépasser trois mois, ceux d’entre eux qui ne possèdent pas la nationalité française quittent alors le territoire pour obtenir un nouveau visa. La plupart de ces guérisseurs sont originaires de l’Afrique de l’Ouest. S’ils s’intéressent particulièrement aux Antilles et à la Réunion, organisant parfois une rotation dans les mêmes lieux de consultation, ce n’est pas en raison de l’origine africaine de la population, c’est en raison de son pouvoir d’achat. Retour d’affection, désenvoûtement, exorcisme, impuissance,... succès au permis de conduire ou au jeu sont les principaux motifs de consultation. A la Réunion, les pauvres ont de l’argent.
La masse financière déplacée par la départementalisation a fait, en une trentaine d’années, d’un pays du Tiers Monde un pays dont le niveau de vie est voisin de celui de l’Espagne. Sans doute, ont disparu des bidonvilles du Port ou de la commune Primat les cochons noirs en liberté et les métiers de récupération sur les décharges, ces scènes d’un ailleurs révolu dont ne subsistent que les bandes de chiens errants. Mais la vie politique réunionnaise a-t-elle fondamentalement changé ? Le succès de Free Dom, mouvement politique né avec une télévision pirate (et mort avec elle) qui a supplanté en quelques mois un demi-siècle de revendication sociale avec la figure libératrice d’un métropolitain ayant échappé à la conscription (et venu faire carrière dans ce corps des V.A.T.), prophète de la libération des opprimés qui a introduit le film pornographique et la violence la plus crue dans les foyers, montre à l’évidence le caractère labile des clientèles et l’illusion de ceux qui se donnent pour les porte-parole des exclus. La départementalisation a-t-elle réparé l’esclavage ? Dans la mesure où leur procès a révélé que les deux marrons les plus célèbres de l’île étaient soumis à l’impôt sur la grande fortune, on pourrait le penser...
La départementalisation n’a pas effacé l’histoire, parce qu’elle n’a pas été en mesure de rendre leur autonomie à ceux que la plantation avait exclus ou broyés. Elle n’a pas jeté les bases de la société égalitaire annoncée ni constitué le ferment d’une identité qui aurait rassemblé en un même destin les éléments divers de la société, ses composantes les plus dynamiques, économiquement parlant, revendiquant ostentatoirement une tradition à part et une identité à part, et ayant d’autant moins besoin du sceau de l’“homme réunionnais” pour prospérer que c’est du cadre républicain et non de cette identité qu’ils tirent à la fois les moyens économiques et le dispositif réglementaire de leur prospérité. “La Réunion qui gagne” est de l’autre côté du comptoir. C’est celle qui vend les billets. Les “affaires” réunionnaises ayant révélé, est-il besoin de le rappeler ? que la classe politique en cause était, elle aussi, derrière le comptoir.
 Thème de recherche n° 14 : Thème de recherche n° 14 :
(repris de Vingt ans après)
Une approche réunionnaise de l’ethnicité
Malgré trois siècles de métissage, en effet, malgré un demi-siècle de départementalisation, malgré le cadre républicain et malgré les discours officiels, la revendication des identités particulières peut étonner. Elle était pourtant contenue, me semble-t-il, dans les prémisses de la départementalisation. On peut s’appuyer ici sur une thèse d’anthropologie qui porte sur l’ethnicité à la Réunion. Un intérêt de cette thèse est d’avoir abordé de front, à l’aide d’un questionnaire passé 768 fois et comportant 338 688 réponses, le problème des catégorisations, des stéréotypes et des jugements de valeurs “interethniques” dans l’ingénierie de la société réunionnaise. Plutôt que de dire que les catégories ethniques n’existent pas puisqu’elles sont dépourvues d’objectivité, l’auteur, prenant en considération non pas les hommes “tels qu’ils devraient être” ou tels que les idéaux républicains se les représentent, mais les hommes “tels qu’ils sont” photographie, en quelque sorte, l’ensemble des représentations que les Réunionnais se font de leurs “concitoyens”. J’ai envie d’ajouter qu’il faut être réunionnais pour se lancer dans une telle entreprise, tant, à l’inverse, un regard extérieur voit des “mélanges”, jamais des “types” et se lasse rapidement d’attribuer des appartenances, et que ce questionnement théorique m’apparaît lui-même comme un produit de la société réunionnaise. Il y a là un naturel et une gymnastique classificatoire à laquelle l’“étranger” n’est pas formé. Pour le dire d’une anecdote : croisant à l’université - avec cette attention (très) flottante qu’il sied à un enseignant d’accorder à des étudiantes avec qui il n’est pas en relation pédagogique -, un groupe d’étudiantes, vraisemblablement apparentées, d’origine indienne, vêtues à l’occidentale, j’ai eu soudain l’impression de me trouver, comme dans un rêve éveillé, au milieu d’une cérémonie “tamoule”, tant à la Réunion, c’est la diversité qui est la règle - et l’université, probablement une des moins sélectives qui soit, en est l’illustration -, et l’uniformité l’exception. “Je me sentais noire dans ce monde blanc” dit une réunionnaise des Hauts, de retour d’une année d’études dans une ville du nord de l’Angleterre. La diversité est ici essentielle au paysage humain.
Le bénéfice de l’approche systématique est d’abord celui de la règle formulée en 1911 par Ferdinand de Saussure, savoir que les termes pris isolément n’apprennent rien, mais que c’est dans la considération des relations entre les termes, seules significatives, que peut se déployer la sémiologie. C’est donc le processus de différenciation sociale et la conscience que les acteurs peuvent en avoir qu’il est possible d’observer par l’analyse de cette “ethnoscience” qu’est l’opinion. Le second bénéfice de l’approche systématique est évidemment de fonder statistiquement des attributions présumées que tout le monde connaît et à qui la censure républicaine dénie l’existence. En réalité, l’auteur est un jeune chercheur réunionnais préoccupé de l’identité réunionnaise et de son devenir qui, faisant fi de la langue de bois des politiques - qui font comme si le problème n’existait pas, mais qui n’en pensent et n’en agissent pas moins -, avec une sûre connaissance du “terrain”, estime que le facteur ethnique constitue une donnée fondamentale de la société réunionnaise et que la description de cet “état des lieux” est la démarche préalable à toute évaluation de l’avenir de la Réunion. Son engagement se marque plus précisément dans son souci et dans son espoir, parfois explicitement formulés, que les stratégies de reproduction des groupes dominants soient tempérées par des processus qu’il identifie comme étant caractéristiques de la formation d’un melting-pot. Sous ce titre, l’auteur fonde visiblement son raisonnement sur la distance, voire l’opposition, qui peut exister entre les opinions des deux tranches d’âge retenues (20-25 ans - 55-60 ans). La véritable question étant, au delà de ces évaluations, celle des évolutions autorisées par les contraintes matérielles et sociales.
D’une manière générale, ses résultats confirment ce fait que la pluri-ethnicité, loin d’appeler un langage commun, a pour premier effet de renforcer l’ethnicité. Comme si le mammifère classificateur qu’est homo sapiens sapiens se saisissait de la différence, a fortiori phénotypique, non pas pour se mettre en question, comme on pourrait le croire ou l’espérer, mais pour alimenter ses certitudes (sans doute parce que la simple perception de la différence est déjà porteuse d’incertitude) et pour conforter son être par une différence qui lui est préalable. Ce qui se vérifie ici dans l’affirmation identitaire des groupes leaders - qui se posent parfois en fédérateurs. Le seul résultat véritablement inattendu de cette enquête, à mes yeux - ce n’est nullement amoindrir les autres, car il y a un monde entre croire que les choses sont ainsi et savoir que les choses sont ainsi -, réside dans l’extraordinaire image, certes marquée d’ambivalence, dont bénéficie le “zoreil” dans la presque totalité des catégories répertoriées. Il y a là une indication, sur le désarroi moral et culturel de l’île, qui exprime le fossé entre la techno-structure et la réalité sociale, et sur laquelle la recherche devra s’arrêter.
Car la départementalisation n’a pas seulement fait passer les fonctionnaires locaux sur une autre planète (un commissaire de police à la retraite raconte que son salaire a été d’un seul coup multiplié par sept et qu’il était bien embarrassé avec tout cet argent dont il ne savait que faire - il y eut aussi des rappels que j’ai entendu qualifier de “considérables”), les installant sur un pied de réalité sans commune mesure avec le réel, elle a provoqué une nouvelle vague d’immigration dans l’île, celle des métropolitains, qui étaient 818 en 1946 et qui sont aujourd’hui plus de 40 000. Le Mémorial de la Réunion, édité en 1979, diagnostique : “L’augmentation du nombre des fonctionnaires métropolitains, et le système départemental qui les fait “tourner” au bout de quelques années aura des conséquences psychologiques assez malheureuses : les Réunionnais n’accepteront pas toujours très bien ces “z’oreils” dont la qualité professionnelle n’est pas toujours des meilleures, et qui se trouvent promus à des fonctions dépassant parfois leurs compétences (...) Comme en outre leurs salaires et conditions matérielles en général sont meilleures que ceux de leurs homologues du pays, cette situation portera en germe des conflits sociaux futurs”. Car, malgré l’environnement républicain, supposé administrer l’égalité des chances, Noirs et Blancs, Réunionnais et Zoreils continuent une confrontation, sourde ou publique, nourrie par un sentiment élémentaire de souveraineté déniée et un racisme diffus. “Il y a de l’indécence, peut-on lire dans Témoignages du 2 août 1960 (c’est l’époque où l’on organise le départ de travailleurs réunionnais vers la métropole), au moment où les métropolitains envahissent notre pays, en touchant des sommes scandaleuses, pour y occuper tous les postes, y compris ceux d’exécution, à préconiser l’exportation des Réunionnais devenus en somme indésirables dans leur pays...”. La pyramide des salaires des personnels d’origine métropolitaine ressemble à la pyramide inversée du Conseil Régional, cet éléphant blanc de la loi de Décentralisation, évidemment plus large dans la catégorie supérieure qu’à la base.
 Thème de recherche n° 15 : Thème de recherche n° 15 :
(repris de Vingt ans après)
L’“homme réunionnais”
C’est contre ce modèle exogène et survalorisé, dont l’université offre un échantillon emblématique, installé au cœur de l’identité, dans cette reproduction des valeurs, de la langue et de la culture qu’est le système éducatif, que doit se construire une identité réunionnaise - c’est un autre résultat, pour moi assez inattendu, de l’enquête en cause, mais il est complémentaire de la survalorisation du modèle métropolitain -, elle-même dévalorisée. Cette opposition redouble une opposition historique sans pourtant s’y réduire puisque le métropolitain représente une espèce différente du “Gros Blanc”. Au fond, la position “nationaliste” développée par l’auteur de la thèse que j’ai citée - qui se définit lui-même comme appartenant au groupe “Cafre” -, place dans la compétition “Réunionnais versus Zoreil” le levain de l’identité réunionnaise. Mais la réalité psycho-cognitive lui révèle que chaque groupe paraît vivre son identité “à côté”, cultivant parfois une revendication identitaire de manière si dissuasive qu’elle peut être ressentie comme un défi aux autres identités et à l’identité commune que l’auteur voudrait voir s’édifier. C’est vraisemblablement cette blessure qui le justifie à employer l’expression d’“activisme ethnique” à ce propos. Bien que les promoteurs de ces manifestations, en effet, insistent, comme pour s’en défendre, sur la valeur de “partage” de leurs fastes, on peut se demander quel type d’intégration le culte d’une identité peut offrir. L’identité, qui par nature définit, nécessairement exclut. On sait, par exemple, que les batteurs de tambour des marches sur le feu sont préférentiellement métis et “cafres” et que le mot tambour contient l’étymologie du mot “paria”. La revendication du renouveau tamoul - j’aurais pu prendre mon illustration ailleurs, mais celle-ci va me permettre de citer une autre thèse qui vient d’être soutenue -, exprime vraisemblablement un besoin de différenciation de la bourgeoisie d’origine indienne à la fois du milieu “créole” ou “cafre” et des expressions populaires (originellement “villageoises” et caractéristiques d’une économie de plantation qui a aujourd’hui disparu) du culte d’origine indienne. Il y a là une stratégie implicite qu’on ne peut ignorer quand on observe la dynamique sociale. Si la religion concourt à la définition de l’identité, elle sert aussi à produire ou à éterniser de la différence. “Actuellement, c’est terminé pour les Indiens, dit un informateur, on trouve des cafres qui deviennent prêtres indiens..., une équipe de cafres marche sur le feu ; ce sont des cafres vraiment cafres”... L’hindouisme, est-il besoin de le rappeler ? quand bien même la folklorisation réunionnaise de ces rites importés clés en main en tempère l’ostracisme, y excelle, comme l’exprime cette recommandation : “Il ne faut pas chasser du temple les gens de ‘mauvaise catégorie’. Il faut des boug comme ça dans la société. S’il y a un chien crevé devant la chapelle, ce sont eux qui vont l’enlever”. A cette racialisation des statuts et des fonctions paraît répondre ce non moins fier slogan de la chapelle la Misère, version métisse d’un hindouisme authentiquement réunionnais (si l’on peut dire) : “Nous sommes tous des parias !”
Le sentiment d’identité est une valeur intime, émotionnelle, faisant partie de ces données immédiates de la conscience qui révèlent les dispositifs fondamentaux de la cohésion sociale. Le frisson des réquisitions communautaires, l’enthousiasme des passions collectives, l’amour sacré de la patrie, tous ces phénomènes physiques d’appartenance qui soudent les individus supposent un sentiment d’identité primaire préalable et coextensif à l’individuation. Comme l’oiseau de Minerve qui s’envole à la tombée du jour, propriété seconde et récursive de la culture - “Si le bœuf savait peindre, disait Xénophane, il peindrait un bœuf” -, l’identité se dit quand elle est déjà. Dire et célébrer, c’est le rôle que la tradition africaine assigne au griot. Celui qui n’a pas pris part à l’action. La question de l’identité apparaît souvent comme une question réactive, née d’une situation de vassalité ou de subordination - ou, à l’inverse, dans la justification d’une supériorité intéressée. Pour qu’il y ait une identité, il faut évidemment qu’une communauté lui préexiste. Là aussi, l’existence précède l’essence. Un paradoxe de l’identité réunionnaise (un paradoxe de l’“homme réunionnais”), c’est que, n’ayant pas les moyens d’être, de réaliser sa différence - la distance entre la réalité économique et l’autonomie politique étant maximale -, et la départementalisation n’ayant pas opéré cette solidarité fondatrice qui aurait subverti les cloisonnements et les oppositions hérités de la société de plantation, elle est condamnée à se chercher des preuves. Faute de pouvoir être projective et prospective, conscience commune d’une transformation du réel, sa revendication est réactive et rétrospective. Que les titres d’identité soient souvent controuvés ou surévalués n’est d’aucune conséquence dès lors que le sentiment d’identité est assis sur une réalité sociale. Le plaisant folklore de la panse de brebis farcie ne fonde pas l’identité écossaise, il la redouble. L’origine troyenne de Rome dans la fable de l’Énéide (s’il m’est permis de rapprocher ces deux exemples) n’ajoute rien à la gloire du siècle d’Auguste, elle lui donne un titre surrérogatoire... La revendication identitaire réunionnaise, qui se coule largement dans l’idiome de la décolonisation (subjectivement dirigée contre le colonisateur flétri de tous les vices et objectivement contre la tradition parée de toutes les vertus), est condamnée, faute de tradition sur laquelle s’appuyer, à chercher sous les stigmates de l’oppression des vestiges à opposer à la culture dominante. A ressusciter l’esclavage non pas pour en comprendre les conséquences actuelles, mais pour y trouver des titres. Articulée et vécue sur le mode du ressentiment, elle doit faire l’histoire en dépit de l’histoire. Cette culture officielle qui exploite les apports extérieurs les plus récents à la culture créole démontre, en fait, l’efficacité redoutable de cette machine à broyer les cultures qu’était aussi la plantation. Un festival musical organisé sur le site d’une usine désaffectée fait ainsi apparaître, par exemple, que les travailleurs de la propriété, logés dans les calbanons, avaient bien l’occasion d’assister aux fêtes “malbar”, mais dansaient ce qui s’appelait la valse et non pas le séga, mais surtout... le quadrille. Quant au maloya, rouleur et kayamb, “ça n’existait pas à l’usine”. Une vieille femme se souvient, elle, d’avoir entendu du maloya, mais de loin, chez ses parents, à la Rivière Saint-Louis. Peut-être est-ce le sentiment de cette impuissance historique et sociale, aujourd’hui comme hier, qui explique que l’identité réunionnaise reste, malgré le budget de la culture, largement dévalorisée.
 Thème de recherche n° 16 : Thème de recherche n° 16 :
(repris de Vingt ans après)
La réparation orthographique : le statut de la langue maternelle
L’importance que les politiques accordent à la culture exprime vraisemblablement cette difficulté à peser sur le réel. Pour soutenir le président du Conseil Général, un militant explique dans un quotidien : “C’est grâce à notre combat pour l’identité que nous résoudrons nos problèmes. Quand nous aurons réglé cette question de l’identité, nous aurons gagné.” C’est ainsi que la revendication de l’identité passe spectaculairement - et de manière quelque peu surnaturelle - par la phonétique. Par la réparation orthographique. Que la langue créole soit une langue régionale, cela n’est, bien sûr, pas contestable. On peut se demander, en revanche, si la phonétique “officielle” du créole n’exprime pas et n’accentue pas le désarroi identitaire au lieu de favoriser l’expression d’une nouvelle identité. Le gain visible et immédiat de cette orthographe normalisée est bien entendu de défranciser le créole et de donner au locuteur une identité originale. Ainsi l’hindi et l’ourdou, ces deux langues cousines, avec leurs deux écritures ennemies, l’arabe et la devanagari, deviennent deux langues aussi étrangères l’une à l’autre que l’eau et le feu. Mais il est évident que cet avantage n’est accessible qu’aux acculturés diglosses, maîtrisant la langue française et la phonétique. Rien n’exprime mieux, peut-être, l’éclatement identitaire, si cette orthographe persuade les créoles qu’ils s’expriment dans une langue qui ne doit rien à la culture qui a fait de la Réunion ce qu’elle est aujourd’hui, alors qu’ils continuent à vivre dans ses institutions et dans ses codes. Ce qui frappe dans cette défense et illustration de la langue créole, c’est qu’elle est finalement assez peu illustrée par ses défenseurs, alors qu’elle continue d’être l’unique moyen d’expression de ceux que la modernisation rapide de l’île laisse les plus démunis. Faute d’avoir été le signe d’un nouveau départ, comme aux Seychelles, ce gauchissement du créole risque bien d’accentuer la perte de repères de ceux-là. Le créole fait davantage office ici, me semble-t-il, de protestation d’identité que d’expression identitaire.
S’il est avéré, en effet, que la langue créole, telle qu’on la pratique aujourd’hui, était déjà constituée, pour l’essentiel, avant l’arrivée massive des Malgaches et des Africains, comme tendent à le montrer les témoignages les plus anciens (cet apport qui a fondamentalement marqué l’identité de la Réunion n’ayant fait qu’enrichir le lexique), la réparation orthographique, qui emprunte ses instruments à la linguistique moderne, avalise à sa manière ce “télescopage” du passé et du présent qui caractérise la Réunion d’aujourd’hui en faisant entrer dans le XXe siècle une langue forgée au XVIIe par les immigrants de la pauvreté, aventuriers et autres prédateurs des Tropiques, puis accommodée et fixée dans l’organisation d’un travail servile dont les principaux bénéficiaires émargeaient, pour l’essentiel, au français de la colonisation.
A partir de cette constatation banale (qui ne l’a pas toujours été) que le créole est dérivé d’un français fondamental et que, contre toute attente, ses emprunts aux langues étrangères, au malgache et aux langues africaines, par exemple, sont relativement peu nombreux, il suffit d’un minimum d’information historique et d’un peu de bon sens pour restituer les grands traits de sa genèse de manière vraisemblable, en répondant à la question : “Qui étaient ces pionniers qui ont peuplé la Réunion et quel français (sachant que plusieurs nations européennes étaient représentées) parlaient-ils ?” Qui ? Sans qu’il soit besoin de sacrifier au cliché qui veut qu’on ait peuplé les colonies en ouvrant les prisons, ni même faire référence à ce que l’on peut savoir des engagés des Antilles qui y précédèrent les esclaves dans les plantations et dont un contemporain dit qu’ils étaient ramassés sur les quais des ports (“espèce d’hommes qui se vendaient en Europe pour servir comme esclaves, pendant trois ans dans les colonies”, écrit l’abbé Raynal), tout indique qu’ils étaient d’une extraction sociale extrêmement modeste, aventuriers forcés que la misère avait probablement chassé de leur village, parfois marins ou soldats, fixés par l’environnement que les premiers voyageurs décrivent paradisiaque. Quel français ? Le français de Vaugelas aurait-il été diffusé, nos pères fondateurs ne l’auraient vraisemblablement jamais entendu. Ces premiers aventuriers (dont les patronymes sont connus) doivent pratiquer un démotique qui agence vraisemblablement ce que les dialectes de la façade atlantique peuvent partager, la langue commune ayant toutes chances d’être un adstrat fortement marqué par les usages nautiques. Au terme d’une demi-année de navigation, ceux qui n’étaient pas frottés à cet idiome en avaient acquis l’essentiel. Dans son mémoire, Boucher les décrit, ce qui n’est pas pour étonner, comme étant “sans éducation et sans connoissance des mistères ; à peine savent-ils qu’il y a un Dieu, une Eglise et des Loix”. Le Gouverneur lui-même, poursuit-il, Antoine Parat, “sçait à peine écrire son nom”. La distance entre le “français” (qui n’existait pas encore) et le créole qu’on se plaît à souligner aujourd’hui, cette distance linguistique est déjà une distance sociale. Quoi de commun entre le destin d’un administrateur de la Compagnie des Indes et celui d’un miséreux venu tenter sa chance à Bourbon, peut-être originaire du même lieu et arrivé sur le même bateau ? Il est frappant de constater que, de même que, pendant la période où l’engagisme a coexisté avec l’esclavage aux Antilles, un “compatriote” avait moins de valeur qu’un esclave, la Compagnie édicte des règlements qui s’appliquent pratiquement sans distinction à la fois aux Blancs et aux Noirs : ainsi “Chaque homme travaillant, tant blanc que noir, devra(-t-il) cultiver 100 plants de café sauvage”. La ségrégation n’est pas phénotypique, elle est économique. Elle sanctionne la différence, culturelle et sociale, entre ceux qui sont retournés à un état de robinsonnade qui fait l’économie des institutions et ceux qui, lorsque la Compagnie des Indes va reprendre possession de l’île, développeront la colonisation sous une juridiction de type féodal. La langue créole est, à cet égard, un conservatoire du français et la revendication orthographique d’aujourd’hui consiste, à maints égards - si l’on excepte sa valeur de revendication identitaire parfaitement légitime -, à moderniser des reliques que l’on ne trouve plus aujourd’hui que dans ces musées que sont les thésaurus. Il est évident aussi, par ailleurs, que le créole, ça n’est pas du français dialectal pur et simple, comme le montre le fait que, pourtant approximativement de même origine géographique et sociale, les parlers français en usage en Amérique du nord ne sont évidemment pas des créoles. La spécificité du créole doit bien entendu être recherchée dans ce qui fait la spécificité de ces zones linguistiques : dans l’importation massive d’allophones dans la structure productive et dans les contraintes de l’organisation servile. L’illustration identitaire de l’“homme réunionnais” paraît donc difficilement pouvoir être alimentée par cette superstructure - pardon Staline ! - qu’est la langue de la colonisation. (C’est plus vraisemblablement dans ce que Roger Bastide a nommé la “mémoire du corps”, dans la différenciation religieuse et, principalement, dans les attendus de la territorialité qu’est le point fixe qui permettrait de soulever la sphère incertaine de l’identité réunionnaise).
 Thème de recherche n° 17 : Thème de recherche n° 17 :
(repris de Vingt ans après)
Les prémisses de la départementalisation
Pratiquement dès l’origine, lorsque, en 1717 avec la Compagnie des Indes, la Réunion se lance dans la culture du café, inaugurant par là cette relation d’exclusivité avec la métropole, fournisseur et client qui décide du sort de l’île en fonction de ses intérêts et du marché, ce qui étonne dans l’histoire de la Réunion, c’est cette dépendance alors que la distance et l’insularité paraissent imposer un destin et des intérêts propres. La Compagnie des Indes a vécu, la situation de monopole a perduré. Qu’il s’agisse des épices, des cultures vivrières pour l’Ile de France, du sucre dont le cours est tributaire de circonstances aussi lointaines qu’imparables, de la vanille ou des plantes à parfum, la Réunion apparaît comme une serre tropicale à l’exploitation extrocentrée. Bien entendu, on expliquera la situation d’aujourd’hui par la colonisation et par la nature de la colonisation. Jacobine avant la lettre, assimilatrice. C’est même un lieu commun de l’anthropologie. Voici ce qu’en écrivait, en 1772, l’abbé Raynal dans son Histoire philosophique et politique du commerce et des Établissements des Européens dans les deux Indes : “Chaque nation européenne a une manière de traiter ses esclaves qui lui est propre. L’Espagnol en fait le compagnon de son indolence, le Portugais les instruments de ses débauches, le Hollandais les victimes de son avarice. Aux yeux de l’Anglais ce sont des êtres purement physiques, qu’il ne faut pas user ou détruire sans nécessité, mais jamais il ne se familiarise avec eux, jamais il ne leur sourit, jamais il ne leur parle. On dirait qu’il craint de leur laisser soupçonner que la nature ait pu mettre entre eux et lui quelque trait de ressemblance. Aussi en est-il haï. Le Français, moins fier, moins dédaigneux, accorde aux Africains une sorte de moralité, et ces malheureux, touchés de l’honneur de se voir traiter comme des créatures presque intelligentes, paraissent oublier qu’un maître impatient de faire fortune outre presque toujours la mesure de leurs travaux et les laisse manquer souvent de subsistance.”
Si l’inévitable comparaison avec le développement de Maurice - “l’île sœur” dit la météo - est devenue une question tabou, selon l’expression d’un sénateur - et quelles que soient les différences patentes (la majorité indienne, le plurilinguisme, les réseaux originels, le “nationalisme” des grandes familles, l’investissement calculé de la rente européenne du sucre, une population business minded..., pour en citer quelques-unes) -, c’est qu’il y a en effet du paradoxe à parler de développement à la Réunion quand on sait qu’il n’existe aucun exemple de décollage économique qui n’ait pris appui sur l’industrie de main-d’œuvre et spécialement sur le textile (Japon compris) et que toutes les conditions paraissent avoir été réunies pour y étouffer l’initiative. Deux citations suffisent pour présenter Maurice en contraste. “Le facteur qui pourrait freiner la poursuite de notre industrialisation est plutôt le suremploi, avec un taux de chômage de 2,5 %. Pour que notre économie puisse être fluide et moins bloquée, il faudrait avoir un taux de chômage structurel de 6 %” (5-Plus du 28 avril 1991). “La priorité des priorités de notre diplomatie, a été, reste et restera la défense et la promotion de nos intérêts économiques et commerciaux” (Paul Bérenger dans Week-end du 31 janvier 1993). Le premier projet de zone franche (qui, à Maurice, avec ses 550 entreprises, emploie 90 000 personnes dont 60 000 femmes et où le taux de chômage, qui était de 25 % dans les années soixante-dix, est tombé à 1,8 % 1994) s’est heurté à la défense de privilèges politiques fondés sur le prélèvement de taxes. En juillet 1989, la municipalité du Port s’est opposée au projet de port franc, réclamant aux collectivités locales une compensation pour l’exonération des taxes prélevées lors des opérations d’importation et d’exportation de marchandises. L’installation du groupe français Bolloré à Maurice, de préférence au port de la Pointe des Galets (qui venait pourtant de s’équiper de gigantesques portiques à conteneurs installés aux frais de l’Europe), avec un investissement à la clé de 300 millions francs et 100 000 mètres carrés d’entrepôts et de chambres froides, exprime on ne peut plus clairement la compétitivité économique de la Réunion. Ce n’est pas seulement en raison du coût, trois fois inférieur, de la main-d’œuvre mauricienne, que Bolloré s’installe à Port-Louis, mais parce que le métier d’un transporteur est de transporter et que les bateaux qui quittent la pointe des Galets repartent le plus souvent à vide. Ce qui peut aisément s’observer du Barachois, quand un bateau quittant le Port et se dirigeant vers Maurice croise à proximité, à la ligne de flottaison. C’est l’activité économique qui fait un port et non des portiques. A la fin des années soixante, il était question de créer une base thonière à la Pointe des Galets. Mais c’est aux Seychelles, aujourd’hui concurrencées par Madagascar, l’Afrique de l’Est et bientôt par Maurice, que transitent et sont traités chaque année 190 000 tonnes de thon. Les marins des thoniers taïwanais ont bien donné matière à quelques expressions proverbiales aux habitants du Port, mais ils ne fréquentent plus les quais depuis longtemps et les chambres froides sont vides. Les plus récents projets d’ouverture de zones franches révèlent, de surcroît, tantôt l’hostilité des entrepreneurs (certains parlant de “concurrence déloyale”), tantôt l’indifférence d’acteurs économiques accoutumés à satisfaire le marché intérieur de cette économie téléportée et qu’un élu a qualifiés de “patrons mendiants”(d’exonérations et de primes). Pour qu’il y ait création de zone franche, il faut qu’existe une demande sociale et une réelle volonté de créer de l’emploi. Une économie adventice fondée sur la perception de taxes prélevées sur des mouvements économiques eux-mêmes financés par des transferts publics n’est évidemment pas en mesure d’affronter la concurrence. De fait, malgré les discours officiels, il est plus facile, selon un jeune entrepreneur qui s’est essayé aux deux, d’obtenir un crédit bancaire pour acheter une Mercedes que pour créer une entreprise. L’intégration à la zone indo-océanienne où certains politiques disent voir la solution à l’emploi des jeunes passe nécessairement par l’adoption d’un SMIC régional et flexible. “Nos îles sœurs et cousines ont-elles besoin, demande un responsable de la CFDT, d’une main-d’œuvre qui n’est pas beaucoup plus spécialisée ni mieux formée que la leur, avec des prétentions de salaire qu’aucune d’elles ne pourra payer ?” (le Quotidien du 6 novembre1994). La comparaison avec ces partenaires potentiels fait d’ailleurs apparaître que, malgré son suréquipement technologique et malgré les investissements considérables qui ont bénéficié à son université, entre autres, la Réunion, qui croit souvent pouvoir faire état d’une valeur ajoutée supérieure pour justifier ses salaires, est objectivement en retard sur plusieurs de ses voisins pour la formation et l’utilisation en entreprise des technologies de pointe. Quand on l’invite aux commissions régionales - ou quand on ne l’invite pas -, ce n’est pas pour sa matière grise ou sa ressource humaine, c’est pour son appartenance à l’espace européen.
Pour conclure cette recension des apparences, il semble que l’on pourrait caractériser le tableau ici brossé, conscient d’avoir simplifié le trait, comme le paradoxe ou le trompe-l’œil d’une majorité politique et d’une minorité sociale. La majorité politique est une propriété de la départementalisation ; la minorité sociale est entretenue par une armée de spécialistes, éducateurs, travailleurs sociaux, médecins, techniciens de l’aide et techniciens du crédit qui font briller ce modèle métropolitain si proche et si lointain. Il s’agit moins pour eux, me semble-t-il, de répondre à des besoins que d’en créer, de faire évoluer la société en fonction de son histoire propre que de la faire entrer - en bout de chaîne -, dans le moule de la société métropolitaine et dans les circuits de distribution. Les acteurs du premier cercle, politiques et notables, paraissent gérer le réel, mais leur rôle se réduit souvent à créer une illusion de perspective, à faire comme si la modernité réunionnaise, exogène et téléportée, résultait du demi-siècle d’histoire écoulé. Techniciens du froid et élus du cru administrent la preuve que l’économie sociale qui les justifie, planifiée sans considération de la sociologie et de l’histoire, nourrit une économie factice au lieu de cultiver l’initiative, entretient la déréliction sociale et déréalise la recherche identitaire au lieu de réunir les conditions d’un réel développement et d’une réelle autonomie. Loin d’avoir opéré comme un plan Marshall qui aurait reconverti l’économie sinistrée de la plantation, la départementalisation, superposant les travers du jacobinisme à ceux de la coopération africaine, en a détourné les actifs vers l’économie stérile de l’import-distribution, elle a créé une classe surnuméraire de fonctionnaires surrémunérés qui entraîne, de fait, l’économie de l’île dans une fuite en avant parfaitement indifférente au réel et entretenu, parallèlement, une sorte de résignation économique (c’est-à-dire, aussi, un potentiel d’explosion sociale au frottement de ces deux mondes soumis au même modèle de consommation). Michel Debré a certes “sauvé” la Réunion d’un Fidel Castro local, mais c’est bien le Parti Communiste Réunionnais qui a précipité la réalisation de la départementalisation en militant pour l’autonomie. Dans cette partie où chacun joue le rôle de l’autre, où, plus exactement, dans un contexte où l’URSS vient de lancer, par la voix de Khrouchtchev, son défi économique aux pays occidentaux et remporte, avec la décolonisation et les luttes de libération, une succession de victoires politiques qui paraît donner du crédit à ce défi, la droite française entend priver les autonomistes des D.O.M. de leurs motifs de revendication en donnant enfin un sens à l’égalité votée depuis 1946. Que cette guerre froide par Réunion interposée ait pu entraîner l’application de modèles aveugles à la réalité réunionnaise doit d’autant moins étonner que les autonomistes se sont progressivement coulés dans le moule républicain et que, tirant la société libérale à l’envers où les conquêtes sociales sont d’abord des conquêtes économiques, ils ont pris l’égalité au mot en se faisant les plus ardents défenseurs à la fois de l’identité créole et de l’égalité républicaine. Nourri par la dialectique du ressentiment et de la mauvaise conscience à laquelle il a été fait allusion, ce jeu politique multiple, où les enjeux idéologiques masquent les problèmes réels permet de comprendre, nous semble-t-il, une certaine réalité de la Réunion d’aujourd’hui.
 IV- L’EUROPE ET LA RÉUNION IV- L’EUROPE ET LA RÉUNION
L’appartenance de la Réunion à l’espace européen peut-elle constituer un “dépassement dialectique” de cette opposition historique, culturelle et économique et favoriser l’émergence de l’initiative réunionnaise ?
Cette partie de la recherche mettra en œuvre des enquêtes tant quantitatives que qualitatives avec les outils classiques de la sociométrie.
Une première enquête, conduite selon la méthode des quotas, aura pour objet d’identifier les représentations que les Réunionnais se font de l’Europe et de la Communnauté européenne.
Une seconde enquête sur la culture, qualitative, aura pour objet de mettre en évidence la nature des attachement communautaires, religieux, culturels, matrimoniaux... et d’identifier ce par quoi les Réunionnais spécifient leur culture et leur identité propre.
Les grands projets européens à la Réunion, dont le plus spectaculaire est celui du basculement des eaux (ce qui implique le percement, d’est en ouest, de cette montagne volcanique qu’est la Réunion), se situent bien entendu dans la continuité des projets d’équipement que la métropole a réalisés ou mis en chantier depuis les années soixante. L’aide à la formation, de même. Or ce “développement ambigu”, pour reprendre un titre de l’anthropologue Jean Benoist, spécialiste de la sociologie réunionnaise, où prospèrent “désarroi culturel” et “malaise identitaire”, dénonce l’application de solutions inadaptées à la situation locale.
Comment trouver l’équilibre entre la réparation et l’aide à l’initiative ? Réparer, cela ne signifie pas seulement donner - et de manière non désintéressée - les moyens de consommer. Cela signifie retendre le ressort brisé par la servitude, réinventer l’esprit de la liberté et de l’initiative. Comment mieux dire l’échec de l’économie sociale que par ce constat involontaire de la ministre Marylise Lebranchu, secrétaire d’État au commerce et à l’artisanat au terme d’une visite officielle, en novembre 1999 à la Réunion, qui “n’a rien trouvé à rapporter” ?... Il n’y a en effet pas de “petits métiers” à la Réunion et les produits de l’artisanat qu’on rapporte chez soi quand on visite l’île viennent en effet, pour l’essentiel, de... Madagascar.
Bien que cette recherche se consacrera au bilan des actions de l’Europe à la Réunion, il ne s’agira pas de trouver des voies économiques (qui sont d’ailleurs connues), mais d’identifier sur quelle représentation identitaire pourra se défaire le “pli de l’assistance”. On posera donc que, dans le cadre européen peut se dire une identité jusqu’à ce jour plus moins déniée et qu’au travers de cette revendication se découvrira non plus seulement une existence fondée sur une protestation d’identité, mais l’horizon et le programme d’une responsabilité partagée. De même que la création des identités nationales européennes a procédé d’une action volontaire où la “fabrique culturelle” a largement fonctionné (Thiesse, 1999) (répondant à un élargissement bien réel de la sphère des échanges et des communications), de même, l’affirmation des identités locales peut se révéler un relais de la participation des régions européennes périphériques à un élargissement économique et politique inéluctable.
L’anthropologie cognitive vient ici au secours de l’anthropologie juridique quand elle démontre, neuropsychologie expérimentale à l’appui, que l’appartenance et la communication sont gérés par des outils cérébraux distincts et qu’appartenir ne s’oppose pas à communiquer. La langue, la culture, la religion, ces propriétés de l’habiter, définissent certes des isolats. Mais tout homme possède aussi un bagage analytique qui fait, par exemple, le théorème de Pythagore accessible à tous, quelle que soit la culture. Quand la langue maternelle, véhicule privilégié de l’affect enracine dans un lieu historiquement et culturellement assigné, la langue analytique, abstraite, est un outil universel de communication. C’est bien entendu la langue de la technique et de la transmission de la technique. A l’opposé, précisément, de cette logique territoriale qui définit l’appartenance au groupe. Gérer l’identité, gérer la langue maternelle, c’est donc assumer, dans un monde saisi par l’universel, cette ontogenèse émotionnelle qui assigne chacun à un “local” déterminé. La possibilité de communiquer ne modifie pas la revendication identitaire. Où, à l’inverse du caractère aujourd’hui planétaire de la communication technique, c’est le singulier et c’est l’infime qui paraissent faire sens : “Petit pays, je l’aime beaucoup” chante Césaria Evora de son île natale, dans une célèbre et nostalgique morna, blues cap-verdien.
En ces temps dits de post-modernité, de reflux des utopies globales, où la revendication du local trouve une oreille constitutionnelle attentive même auprès de l’État jacobin (la France devrait ratifier la charte européennes des langues régionales), la notion de pays (250 pays viennent ainsi d’être recensés par la DATAR - Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) redonne peut-être une dignité juridique officielle à la revendication identitaire tout en constituant une réponse à la mondialisation et à la normalisation des échanges. “Il y a un regard nouveau du public, dit un responsable de région cité dans le Monde du 16 octobre, qui craint une uniformisation de la société. Les langues régionales sont des territoires de liberté pour se ressourcer.” S’il n’y a plus d’antagonisme entre la pluralité des cultures régionales et l’unité nationale, et s’il n’en n’existe pas dans l’espace multipolaire de l’Europe, c’est probablement parce qu’on réalise que même si cette histoire est une histoire conflictuelle, il y a un donné anthropologique dans le fait - quand bien même sommes-nous capables de nous transporter dans l’instant aux antipodes grâce à la communication moderne - de naître à l’identité dans le cocon d’un réseau de familiarité qui nous fait tributaires d’un territoire, d’une langue, d’un groupe humain donné. Où l’on voit que l’appartenance à l’espace européen peut jouer comme un accélérateur de ce processus. Un président en visite chez les Inuits a pu dire récemment : “Les peuples veulent échanger leurs biens, mais ils veulent garder leur âme”. On peut former le souhait que ce constat soit aussi le programme du devenir de la Réunion. Cette recherche voudrait y contribuer.
[ Laboratoires, équipes partenaires :
À Madagascar :
- Faculté des Lettres et des Sciences humaines d’Antananarivo
- Université de Fianarantsoa
À Maurice :
- Université de Maurice
Aux Comores :
- CNDRS de Moroni
En métropole :
- Université de Perpignan
- E.H.S.S. (Centre d’Études Africaines) ]
|
|
|