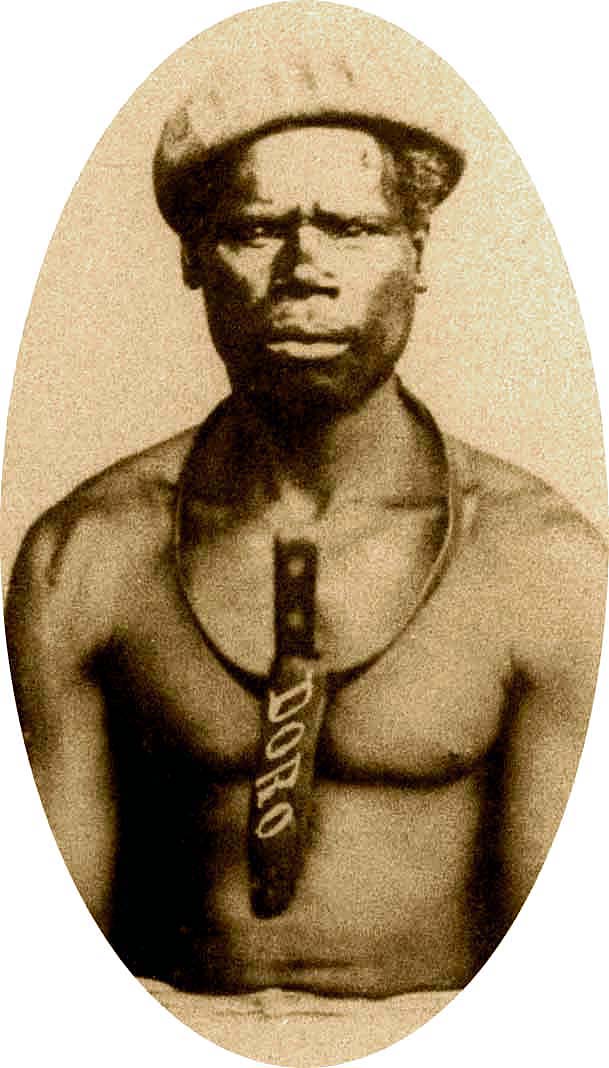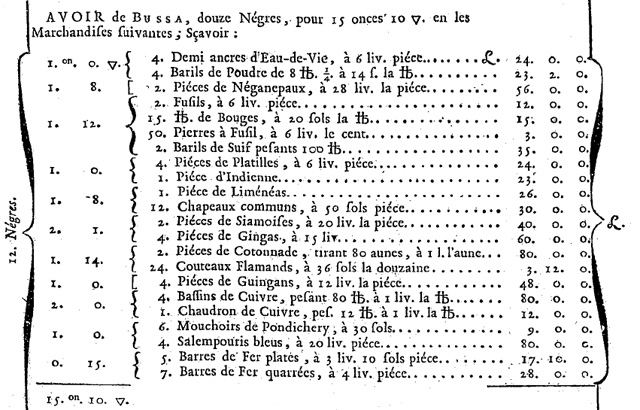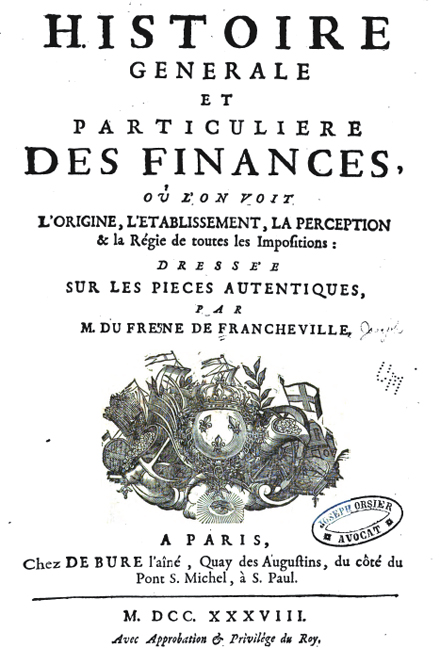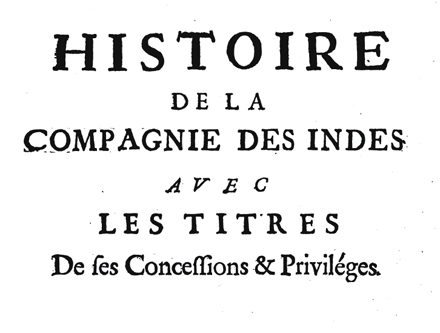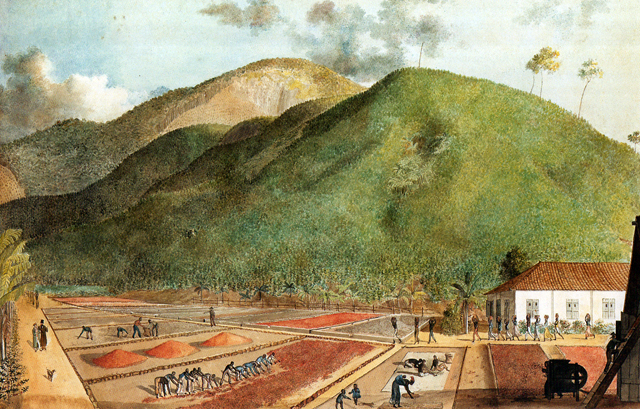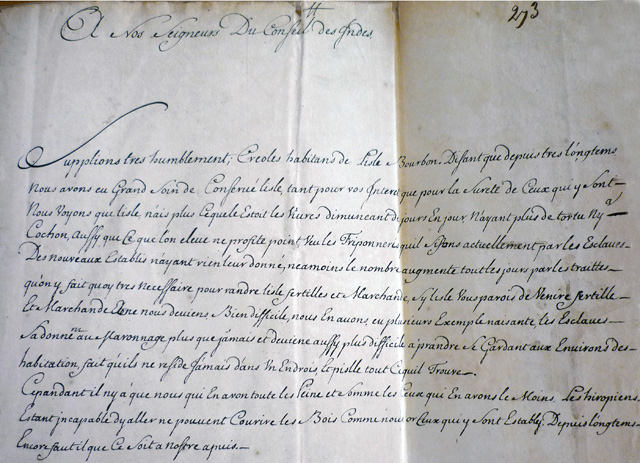|
Les Compagnies des Indes et l'île de La Réunion
(Bases, page en cours...)
[voir :
Les Compagnies de commerce et la première colonisation de Madagascar
La Compagnie Française des Indes Orientales de 1664
Madagascar : l'“Originaire”, l'“Engagé” et l'“Habitant”
La fonction missionnaire : sur la mission lazariste à Fort-Dauphin (1648-1674)]
Dans son ouvrage sur le peuplement de l'île Bourbon, Naissance d'une chrétienté, Bourbon, des origines jusqu'en 1714, le Père Barassin écrit : "On nous reprochera peut-être de nous être attardé sur une période d'où l'île de Bourbon est presque totalement absente et de nous être appesanti longuement sur Madagascar. Ce n'est pas sans un dessein très précis. C'est en effet qu'à cette époque "Madagascar et les Isles adjacentes" font un seul tout ; c'est ensuite que le développement de Bourbon, d'abord comme annexe de la Grande Ile, puis comme base française en vue d'établissements futurs, a été pendant tout le XVIIe siècle fonction de Madagascar ; c'est surtout que les idées colonisatrices émises à cette époque, spécialement par Flacourt, et notamment sur l'influence de l'élément religieux, auront leur répercussion à Bourbon..." (1953, p. 43) (nous soulignons).
La première tentative d'implantation française dans le sud malgache s'est soldée par un échec. Cette tentative a néanmoins constitué le premier essai de juridiction en vue de l'exploitation des colonies sur la route des Indes. Dans le programme que Flacourt se fait fort de mettre en œuvre, dans le plan de colonisation dressé par la Compagnie de 1664, dans les instructions de Mondevergue, dans l'ordonnance de Jacob de la Haye se trouvent exprimés la philosophie économique et les outils juridiques qui vont commander l'histoire de l'île de La Réunion. Société duale, produit de la féodalité, engagée par ses commanditaires dans la production de denrées coloniales pour le marché européen et faisant sa loi de l'exploitation du travail à moindre coût alors que le monde est à portée de main, l'histoire de l'île offre un concentré des formes d'asservissement que l'homme peut imposer à son semblable et donne un point de vue sur les processus de différenciation sociale fondés sur l'intérêt, au sens que prend ce mot avec les compagnies de commerce et qui s'exprimera trivialement dans la pratique des sociétés anonymes. Faisant référence à l'ouvrage de Benjamin Nelson sur le prêt à intérêt : From tribal brotherhood to universal otherhood ("in modern capitalism, all are 'brothers' in being equally 'others'" - Chicago, University of Chicago Press, 1969, p. XXV) et au tournant qu'a constitué dans l'histoire de l'Occident la pensée économique de Calvin, force est de constater que l'universal otherhood, l'anonyme fraternité de la société d'intérêt, se révèle en fait une universelle indifférence propre à déréaliser toutes les formes de déni d'humanité. Les colonies sont ainsi des mondes où l'on voit l'intérêt – le "quatrième ordre" – optimalement à l'œuvre dans les pays "neufs", neufs au sens où les "interessez" apportent et administrent tout : les hommes, les biens, les moyens de culture, l'achat des récoltes et la vente des produits de consommation – et le droit qui organise l'ensemble. L'histoire de La Réunion est l'accomplissement d'un tel calcul et la diversité de la population réunionnaise d'aujourd'hui est l'image vivante de cette histoire coloniale : les premiers "habitants" venus d'Europe, les esclaves déportés de Madagascar et d'Afrique, les engagés recrutés principalement en Inde, dès avant l'abolition de l'esclavage mais à une tout autre échelle après l'abolition.
"On n'y vient que pour s'enrichir", constate Girod de Chantrans à Saint-Domingue (Voyage d'un Suisse dans différentes colonies d'Amérique pendant la dernière guerre, Neuchatel, 1785, p. 236). Faire fortune aux isles et rentrer en Europe, ou faire fortune aux isles à partir de l'Europe. A La Réunion, observe Louis Simonin en 1860, "les hommes sont exclusivement occupés de s'enrichir le plus possible. Le sucre est leur veau d'or, et tout ce qui ne s'y rapporte pas n'a pas de prix pour eux". "Toujours en quête d'une culture spéculative, qui leur permettrait de réaliser rapidement une fortune suffisante pour rentrer en France, commente un auteur, les grands colons réunionnais se lancèrent dans les plantations de canne à sucre." (Hisnard) Cette coexistence de deux mondes séparés où l'utilité se subordonne l'humanité est constitutive de la société réunionnaise. Dès l'origine, les "Seigneurs de la Compagnie", leurs représentants ou leurs successeurs occupent une position de monopole et de dominance. Au temps du café, "en 1731, écrit Mas, les quatre plus forts producteurs [...] sont Justamont et Dioré, anciens gouverneurs, Dumas, gouverneur et Feydau-Dumegnil, membre du Conseil Supérieur" (op. cit. p. 36) Pierre Benoist-Dumas, Directeur Général du commerce de la Compagnie des Indes se taille en un an un patrimoine évalué à 885 hectares. (voir : Les biens de P.B. Dumas à l'île Bourbon" dans Recueil... VII, p. 111). La production de sucre provoque à son tour une concentration des richesses telle que deux propriétaires "Kerveguen et le Crédit foncier colonial possèdent à eux deux près de la moitié des terres de l'île" (Mas, p. 9). En 1914, le gouverneur Cor déclare : "...trois propriétaires à eux seuls, fixés en Europe, y emportent la moitié des bénéfices réalisés sur les denrées d'exportation dérivées de la principale culture, la canne" ("Le paupérisme à La Réunion", Journal et Bulletin Officiel de l'île de La Réunion, 18 décembre 1914, p. 475). – Aujourd'hui, la quasi totalité des transferts publics qui alimentent l'économie réunionnaise est expatriée sous forme de transferts privés, comme le montrent les rapports annuels de l'IEDOM (Institut d'Émission des Départements d'Outre-Mer).
L'"habitant"; le statut juridique de la colonie.
Jusqu'en 1767, date à laquelle les Mascareignes sont directement rattachées à la couronne, l'île, concédée "à perpétuité en toute propriété, justice et seigneurerie" par déclaration du roi du 1er septembre 1664, est sous le régime du pacte colonial ou système de l'exclusif. La concession sur "l'Ile de Madagascar, dite Saint Laurent avec les îles circonvoisines... pour en jouir ladite Compagnie à perpétuité en toute propriété, seigneurie et justice..." qualifie un fief. Les syndics de la Compagnie sont donc seigneurs des îles concernées, exerçant une puissance souveraine sur la terre et sur les individus en relevant. Les terres concédées par la Compagnie le sont "pour en jouir en propriété roturière" moyennant l'acquittement des droits seigneuriaux : droit de lods et de vente, imposition en nature et corvées (corvées qui, à Bourbon, seront essentiellement assurées par les esclaves des concessionnaires).
Auguste Billiard, Voyage aux colonies orientales... (1822)
"En obtenant le privilège du commerce des Indes, la compagnie reçut l'investiture de tous les droits attachés au titre de seigneur et de maître des terres comprises dans sa concession ; il n'était point de gentilhomme plus jaloux de ses prérogatives : les colons ne possédaient guère que par emphytéose, obligés, à chaque mutation d'héritage, à des redevances seigneuriales connues sous le nom barbare de lods et ventes. La compagnie, qui déterminait les cultures, recevait, au prix qu'il lui convenait de fixer, les produits du sol et vendait chèrement aux colons les marchandises qu'elle avait seule le droit de leur apporter en échange. Il est difficile dans un pareil système, de concilier l'intérêt des colonies avec l'insatiable avidité de la compagnie." (Auguste Billiard, Voyage aux colonies orientales, ou lettres écrites des Isles de France et de Bourbon pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820..., Paris, 1822, p. 263-264)
Pierre Poivre, chargé de mettre en place les premières structures de l'administration royale après la liquidation de la Compagnie des Indes, libèrera les concessions de ces usages "sortis anciennement du chaos de nos lois féodales", selon ses propres termes, et "affranchi[ra] de toute espèce de servitude les terres de ces colonies, qui désormais seront libres comme les braves colons qui les possèdent" (id. p. 273).
La Compagnie est un seigneur féodal qui applique le régime foncier de la censive, la mise en valeur des terres étant la cause juridique de l'inféodation. L'obligation de culture est régulièrement répétée dans sa correspondance. Une ordonnance royale donnée à Marly le 27 février 1713 rappelle : "ordonne sa Majesté que ceux en faveur desquels les contrats seront expédiés soient tenus de mettre lesdites terres en bonne culture dans un temps convenable sinon à faute de ce faire et le temps passé sa Majesté veut qu'ils soient déchus de la propriété desdites terres, et icelles remise au domaine de la Compagnie des Indes pour être distribuées à d'autres habitants aux mêmes conditions..." La Compagnie est aussi un "intéressé", une personne morale constituée par l'association des actionnaires (les "interessez"), et son monopole, du type de celui accordé aux jurandes ou corporations, répond au concept neuf de colonie : extension de la couronne, ayant pour propre un mixte de juridiction territoriale et de juridiction commerciale. Ce monopole justifie un "double péage" sur les échanges de la colonie, les extrants comme les intrants : les productions de la colonie doivent être vendues aux magasins de l'île à un prix fixé par la Compagnie et les colons doivent s'approvisionner à ces magasins pour s'y fournir en marchandises. A l'obligation de produire et à la rente féodale s'ajoute donc le monopole du "magasin du roy". Le type d'entreprise commerciale suscité par les Découvertes étant sans équivalent (étranger aux domaines réservés des corporations) et concernant des territoires relevant du principe de la terra nullius, ne peut relever, dans le droit de l'Ancien Régime, que du privilège (leges privatae), à rapprocher de celui qui a permis le développement des manufactures royales. L'octroi du privilège commercial et de la suzeraineté territoriale fait des directeurs des compagnies de commerce des seigneurs sur le modèle féodal, les "Seigneurs de la Compagnie" étant en réalité des notables appartenant aux grands corps de l'État monarchique. La colonie est ainsi un composite de féodalité foncière et de féodalité commerciale. (La Compagnie française de l'Orient de 1642, fondée par Rigault, comptait ainsi parmi ses actionnaires cinq "Conseillers du Roy" : Fouquet, Aligre, Loynes, Levasseur et de Beausse.)
Les colonies sont donc des domaines dont la finalité est d'exploitation économique. "L'objet de ces colonies, écrit Montesquieu, est de faire le commerce à de meilleures conditions qu'on ne le fait avec des peuples voisins, avec lesquels tous les avantages sont réciproques. On a établi que la métropole seule pourrait négocier dans la colonie, et cela avec une grande raison, parce que le but de l'établissement a été l'extension du commerce, et non la fondation d'une ville ou d'un nouvel empire" (De l'Esprit des lois, XXI, 21). À l'article "Colonies", le rédacteur de l'Encyclopédie, qui signe MVDF (Véron de Forbonnais), développe que celles-ci "n'étant établies que pour l'utilité de la métropole, il s'ensuit : 1° Qu'elles doivent être sous sa dépendance immédiate et par conséquent sous sa protection ; 2° Que le commerce doit être exclusif aux fondateurs." "Les colonies ne seraient plus utiles si elles pouvaient se passer de la métropole : aussi c'est une loi prise dans la nature des choses que l'on doit restreindre les arts et la culture dans une colonie à tels et tels objets suivant les convenances du pays de la domination."
"Le principe de la législation commerciale des colonies françaises à culture, écrit Delabarre de Nanteuil à l'article "Douanes" de sa Législation de l'Île de La Réunion (2°éd. tome 2, p. 300) a toujours été l'exclusif, c'est-à-dire qu'elles ne doivent recevoir et consommer que des produits français apportés sous pavillon français ; en outre, elles doivent encore réserver tous leurs produits d'exploitation pour être envoyés en France, par navires français. Tel est le pacte colonial." Agent et bénéficiaire du pacte colonial, la Compagnie est un entrepreneur. Il lui revient de pourvoir l'île en colons et de fournir ceux-ci en moyens de production. Un crédit de vivres pendant un an, de semences, d'outils et d'esclaves leur est accordé (lettre de la Cie au Conseil Supérieur de Bourbon du 23 décembre 1730, citée par Jean Mas, Droit de propriété et paysage rural de l'ile de Bourbon-La Réunion, S.C.D. université de La Réunion, 1971, p. 38). Il revient à la Compagnie d'exploiter l'île en fonction de ses ressources et de sa configuration. "Il est certain que cette isle ne peut être avantageuse que par deux voies : par ce que la culture de ses terres ou de sa surface peut donner, et par le commerce qu'elle peut ouvrir agrandir ou conserver." (Mémoire sur l'Ile Bourbon adressé par la Cie des Indes au Gouverneur le 11 février 1711 - Recueil trimestriel, T V, p. 164.) La Compagnie définit donc le destin des îles Mascareignes, échelle sur la route des Indes, en fonction de leurs atouts naturels, la part de Bourbon étant de fournir aux vaisseaux des "rafraîchissements". Les tortues, dont la prise est contrôlée, notamment par l'interdiction de prendre les petits ou "poulets" (qui sortent d'une coquille) ainsi que les bœufs, porcs et cabris (qui se multuplient en liberté) constituent des ressources utiles. Il n'y a, note Flacourt (1661, p. 127), qu'un seul cocotier à Bourbon, "qui a pris racine depuis quatre ou cinq ans, à ce que les Français qui y ont demeuré m'ont rapporté", mais la terre s'y révèle fertile... (Flacourt note, à propos de Madagascar "que cet arbre [Voaniou] n'estoit point connu icy : mais que par cas fortuit la mer [a jeté] sur le sable un de ces fruicts").
De la philosophie des "alliances réciproques" à l'ordonnance de Jacob de la Haye
Madagascar, on l'a vu, n'est pas simplement pour la Compagnie un point de relâche et d'avitaillement sur la route des Indes. Ayant mis "en deliberation s'il estoit plus à propos de faire cultiver l'Isle de Madagascar par des Passagers à gages, ou, d'y transporter des Colonies, et de distribuer aux nouveaux Habitans qu'on y envoyeroit, des Terres qui leur appartiendroient en propre, sous de certaines redevances" écrit Charpentier (Charpentier, François, 1666, Relation de l'établissement de la Compagnie Françoise pour le commerce des Indes Orientales, Amsterdam, Simon Moinet, p. 109-110) la Compagnie décide qu'il est de meilleure politique de "transpor[ter] des familles entières, et leur donnant des Terres qui leur appartiendroient en propre" car, "comme il faloit avoir en veüe de rendre cette Isle toute Françoise, et de mœurs et de langage, et de ne faire à la fin qu'un Peuple de deux Nations […] il ne faloit pas espérer ce grand succès, par d'autres moyens que par des Colonies, et par des alliances reciproques." (id. p. 111) C'est bien d'un programme systématique de colonisation qu'il s'agit, les moyens ayant fait l'objet de débats. La mise en œuvre de ces "alliances reciproques" fait l'objet des treize articles des "Statuts , Ordonnances et Règlements que la Compagnie établie pour le commerce des Indes Orientales, veut et entend estre gardez et observez dans l'Isle de Madagascar et adjacentes, et dans tous les autres lieux à elle concédez par Sa Majesté" ("Fait et arresté au Bureau général de la Compagnie des Indes Orientales, à Paris, le 26 octobre 1664"), élaborés pour organiser la vie de la future colonie (in extenso dans Charpentier, p. 88 et s. et dans Pauliat, L., 1886, Louis XIV et la Compagnie des Indes orientales de 1664. Paris, Calmann Lévy.p. 138 et s.).
Ces articles énoncent les modalités d'une colonisation de peuplement dont les maître-mots sont pacification et métissage pour "ne faire à la fin qu'un Peuple de deux Nations". La colonisation envisagée s'épanouira pacifiquement ("non par la Force ouverte, ni par la Crainte") emportant l'adhésion des "Originaires" ("par le bon Ordre et par l'Affection des Originaires qu'elle prétend gagner en les traitant avec Humanité et avec Tendresse", p. 87) et selon une justice s'appliquant identiquement aux Français et aux Malgaches : "Et la Justice sera rendue aux Habitans Naturels du pais, ainsi qu'aux Français mesmes, sans aucune distinction." (François Charpentier, 1666, Relation de l'établissement de la Compagnie Françoise pour le commerce des Indes Orientales, Amsterdam, Simon Moinet, p. 86). Ces ordonnances devant être affichées "aux portes de l'Eglise […] en langue et caractère du pais, pour faire connaître aux Naturels avec combien d'Equité et de Justice, on les veut gouverner". (id. p. 87) Cette colonisation envisage le mariage des colons français avec des femmes malgaches comme une conséquence naturelle de l'entreprise, sous réserve que l'"Originaire" soit baptisée et que la loi chrétienne s'applique à cette union. "Un François estant marié à une Fille ou Femme Originaire de l'Isle, ne pourra quitter ou délaisser sa Femme sous quelque pretexte que ce soit, sinon aux cas de Separation qui se pratiquent dans le Royaume de France, et la Separation ayant este jugée, le Mari pourra laisser sa Femme, sans que pendant sa vie il puisse convoler à de secondes Noces" (id. p. 89). Ce programme révèle au moins deux choses, la première, l'ignorance des syndics de la situation politique des "Habitans Naturels du pais", qui sont déjà "féodalisés" (voir : Les compagnies de commerce et la première colonisation de Madagascar et sq.), la seconde, au-delà l'"humanitarisme" des syndics de cette compagnie de commerce ("ces treizes articles, écrit Pauliat, sont conformes à nos principes modernes d'humanitarisme et de justice, 1886, p. 139), que la philosophie politique des "seigneurs de la Compagnie", féodaux par industrie, voit tous les colons, "François" ou "Originaires" dans une même indistinction. Quoi qu'il en soit, il y a une contradiction (relevée par Barassin (1957, p. ), Filliot (1974, p. ), Mas (1989, p. 114) entre la philosophie de ces articles (qui resteront lettre morte) et la philosophie de la puissance souveraine énoncée dans la Déclaration du roi datée d'août 1664 : "Appartiendra à ladite Compagnie a perpétuité [...] même le droit d'esclavage et autres droits utiles qui pourraient nous appartenir à cause de la souveraineté desdits pays" – qui s'appliquera à Bourbon.
Madagascar, ce paradis habité par des diables, selon le mot de Robert Challe (dans son journal, à la date du 12 juin 1690, 1983, tome 1, p. 227), sera le tombeau de la première émigration française aux Mascareignes. Avant le massacre qui devait mettre fin à l'occupation, il restait à Fort-Dauphin, selon Isidore Guet, "127 français, débris des 4 000 émigrants envoyés par les diverses compagnies qui avaient tenté de coloniser Madagascar, de 1638 à 1674" (Guët, I., 1888, Les Origines de l'île Bourbon et de la colonisation française à Madagascar, Paris : C. Bayle, p. 111). Si c'est bien une même politique, sous deux options opposées, qui se développe dans la colonisation de Fort-Dauphin et de l'île Bourbon, Bourbon devenant le de point de relâche des navires de la Compagnie (comme une instruction de Colbert l'avait vraisemblablement anticipé – citée par Guet), il y a une solution de continuité, pour ce qui concerne la population européenne, entre la colonisation de Fort-Dauphin et le peuplement de Bourbon puisque les quelques rescapés de Fort-Dauphin qui se fixeront à Bourbon (vingt-et-un), embarqués en septembre 1674, n'y parviendront qu'en mai 1676. Le Blanc-Pignon, qui recueille les soixante-trois rescapés, chargé d'une mission à Surate, va mettre la voile, non sur l'île Bourbon mais vers Mozambique qu'il n'atteindra que sept mois plus tard. Les colons qui rejoindront l'île partiront de Surate sur le Saint-Robert en avril 1676 et arriveront à destination en mai (Guet, p. 127). Les ont précédés, en février 1667, les engagés arrivés avec la flottte de Montdevergue et ceux qui ont suivi de la Haye à Bourbon, en 1671, et s'y sont installé (Barassin, "Étude sur les origines extérieures de la population de Bourbon", dans : Recueil de documents et travaux inédits pour servir à l'histoire de La Réunion, 1960, p. 9 à 75).
"Toux ceux qui ont donné des détails historiques sur Bourbon ont écrit que cette colonie avait été fondée avec les débris de celle de Madagascar ; il eût été plus exact de dire que Bourbon, déjà établi, augmenta sa population d'un tiers ou d'une moitié par le secours des orphelines envoyées de la métropole, et par celui des colons échappés au massacre de Fort-Dauphin" (Billiard, op. cit. p. 260).
Bourbon a déjà connu plusieurs phases d'occupation :
- d'octobre 1646 à septembre 1649, par les 12 "ligueurs" exilés par Pronis ;
- de septembre1654 à juin 1658, quand Flacourt y envoie une "forte tête", Antoine Couillard, dit Marovoule ("le velu"), pour y cultiver le tabac avec sept français et six malgaches ; abusés par un navire flibustier de passage qui les persuade que Fort-Dauphin est abandonné, ces pionniers s'embarquent pour Madraspatam ;
- en 1662, Louis Payen passe à Mascareigne avec un compatriote et dix malgaches dont trois fillettes, probablement sœurs. Il quitte l'île en 1665, son compagnon, resté anonyme, fait de même. "Cette Isle, rapporte à ce propos Souchu de Rennefort ("secrétaire de l'Etat de la France Orientale" selon la mention figurant sur la page de garde de sa Relation du premier Voyage de la Compagnie des Indes orientales en l'Isle de Madagascar ou Dauphine), dont des "gagistes de la compagnie" ont fait le tour (1668, p. 165), étoit habitée de deux François et de dix Negres sept hommes et trois femmes passés de l'Isle de Madagascar, rebellés contre les François et retirés dans les montagnes où ils étaient imprenables et rarement visibles ; ils les accusoient d'avoir tué leurs peres, et aprés une conspiration éventée d'exterminer ces deux François : ils s'ôterent de leur veuë et de la portée de leurs fusils." (id., p. 161) "Aprés quoy le premier resolut de repasser en France ; et l'autre s'engagea au service de la Compagnie." (id. p. 163-4).
Ces malgaches et leurs descendants sont les premiers occupants permanents de l'île. Etienne Regnault arrive en 1665 avec une vingtaine d'hommes, tandis que Louis Payen s'embarque sur la Vierge du Bon Port. Regnault obtient le retour des Malgaches et le premier baptême qui intéresse l'origine du peuplement de Bourbon, enregistré à Saint-Paul le 4 août 1668, sera celui d'Anne Mousso, fille d'un des couples fugitifs, Jean Mousso et Marie Caze. (Le baptême d'Estienne Pau, dont la mère enceinte arrive sur la flotte de Montdevergue, est antérieur, mais cet enfant suivra sa mère à Madagascar où celle-ci se remariera, après le décès de Pierre Pau.)
Les compagnons de Regnault, qui quittera l'île en mai 1671, "de Lahaye, ayant besoin d'un officier d'administration pour un de ses vaisseaux, trouva dans Regnault l'homme instruit et intelligent qu'il lui fallait", rapporte Güet (op. cit. p. 101), sont les premiers colons officiels de Bourbon. Jean Barassin en dresse la liste comme suit : René Hoareau natif de Boulogne-sur-mer, Jacques Fontaine natif de Paris, François Vallée natif de Normandie, Pierre Hibon natif de Calais, François Mussard natif d'Argenteuil. Athanase Touchard natif d'Issy, Pierre Mollet natif de Paris, Picard natif de Paris, François Ricquebourg natif d'Amiens, Pierre Colin natif de Nîmes, Jean Bellon natif de Lyon, Gilles Launay natif d'Urville (Manche), Hervé Dennemont (ou Danemont). (Barassin 1953, p. )
La flotte de Montdevergue, partie le 14 mars 1666, avait embarqué 36 orphelines. Le Saint-Jean, sur lequel le marquis avait son pavillon, parvient à Saint-Paul le 22 février 1667. Sur les deux cents malades débarqués à Bourbon, cinq jeunes filles, confiées mourantes à Regnault, furent sauvées et demeurèrent à Mascareigne : Antoinette Renaud, Marie Baudry, Marguerite Compiègne, Jeanne Lacroix, ainsi qu'une cinquième femme, dont le nom n'a pas été conservé, qui devait épouser Hervé Danemont et donner naissance à un enfant en 1668. De la Haye, malade, passe à Bourbon et débarque à Saint-Denis le 27 avril 1671 avec quelques nouveaux colons que le recensement de 1711 désigne comme "venus dans l'isle du temps de Mr de la Haye". En mai 1676, donc, arrive à Bourbon le "débris de Madagascar", les rescapés de Fort-Dauphin "… misérables reliques de ce fameux établissement", selon l'expression de Souchu de Rennefort (Histoire des Indes orientales, p. 402). "Les mots 'du débris de Madagascar', remarque Guet, ne doivent pas être pris à la lettre. Ils auraient dû s'appliquer seulement aux habitants transportés à Bourbon après la catastrophe de Fort-Dauphin en 1674. Par extension, les anciens colons ayant fait partie des expéditions de la Compagnie des Indes orientales aux iles indo-africaines, furent, pour l'auteur de la liste [citée], "du débris de Madagascar". On rencontre souvent cette expression dans le second mémoire d'Antoine Boucher, ce qui prouve que ses sources d'information n'étaient pas d'une sûreté parfaite" (p 239). Ces rescapés sont : "Pierre Nativel, sa femme et une fille ; Antoine Payet et sa femme ; François Rivière ; Lezin Rouillard ; Jacques Maillot ; François Grondin, sa femme et son fils ; Noël Tessier ; Georges Damour ; Samson Lebeau ; Jean Julien et sa femme ; François Duhamel ; Jean Perrot ; Pierre Martin et sa femme et dame Françoise Châtelain veuve de Jacques Lièvre. Cette dernière ne tarda pas à épouser M. Michel Esparon, dont elle eut un premier enfant en 1678" (p. 120). Sur les quinze Parisiennes en escale à Fort-Dauphin, deux s'établissent à Bourbon : Nicolle Coulon et Françoise Châtelain.
Un recensement de 1671 fait état de soixante-et-onze habitants à Bourbon. La population augmente avec les flibustiers et une quarantaine d'immigrants malgaches amenés par les forbans (Barassin, "L'esclavage…, p. 16-17). "Le dénombrement de 1711 mentionne la présence de vingt-neuf de ces aventuriers, "les ‘nouveaux habitants’, euphémisme dont on se servira désormais pour désigner les anciens forbans, sur un total de cent neuf chefs de famille" (Lougnon, p. 163 et 169). Les premiers voyageurs décrivent Bourbon comme un Eden. Flacourt, d'après le récit des Français y ayant été "relégués trois ans" par Pronis, conclut sa description : "Ce seroit avec juste raison que l'on pourroit appeler cette Isle un Paradis terrestre" (1661, p. 269). Chasse, cueillette, horticulture, définissent cette économie de subsistance – que l'on a parfois qualifié de "robinsonnade" – où la population non européenne est désignée par le nom de l'habitant (Barassin, p. 17), le terme "habitation" qualifiant ici l'unité domestique, l'exploitation, avec l'habitation proprement dite (il est ainsi question, dans une lettre de Fleurimond de 1678, de "la bittation du roy, à Sainte-Suzanne" - infra). L'expédition de la Haye fait retour à Bourbon le 19 novembre 1674. "Il [la Haye] leur distribua (aux habitants) des étoffes des Indes pour se couvrir car ils étaient tout nus. Ces misérables demandaient des femmes, la plupart ayant été contraints d'épouser des négresses, leurs esclaves, et disaient qu'ils étaient obligés de relâcher les bestiaux dans les montagnes par la grande quantité qu'ils en avaient et le peu de débit qu'ils en faisaient" (Barassin p. 105).
L'ordonnance de Jacob de la Haye (1er décembre 1674)
C'est sur cette population indépendante et disparate qu'est supposée s'exercer l'ordonnance dont Jacob de la Haye, amiral de la désastreuse "escadre de Perse" et "vice-roi des Indes", est porteur (ce document est publié par Guët, 1888, p. 124-125). C'est une tentative pour détourner les habitants de l'économie de cueillette et pour les mettre "au travail" : pour les convertir aux principes d'une économie "néolithique". Ceux-ci, en effet, "détruisent le pays au lieu de l'établir". Cette ordonnance entend réglementer la production de Bourbon : interdiction de la chasse et de la cueillette, obligation de culture et d'élevage, assignation à l'habitation, réglementation du commerce, interdiction des mariages mixtes…
L'interdiction de la chasse, privilège seigneurial, rappelle les habitants à leur fonction de colons : la "liberté de chasse rend les habitants paresseux et fainéans, ne se souciant de cultiver les terres, ni d'avoir des bestiaux pour leur nourriture".
Art. 12. - Que personne n'ira à la chasse des oiseaux, bêtes à quatre pieds ni autre gibier tel qu'il soit, sur peine de vingt écus d'amende, moitié pour le roy, un quart au dénonciateur, et un quart pour l'hôpital ; ou à faute de payement, six mois de service sans gage ni salaire pour la première fois, et en cas de récidive à peine de la vie - et cet ordre exécuté ponctuellement, attendu que nous avons observé que la liberté de la chasse rend les habitans paresseux et fainéans, ne se soucians de cultiver les terres, ni d'avoir des bestiaux pour leur nourriture, et détruisent le pays au lieu de l'établir.
Art. 14. - Que nul ne tiendra chiens ni chiennes, sans ordres exprès du gouverneur, et par écrit, sous peine de 10 écus d'amende pour la première fois et de punition corporelle en cas de récidive.
Art. 25. - Qu'il sera commis des chasseurs, lesquels seront obligés de fournir dans les magasins, aux commis établis pour cet effet, les viandes et gibiers qui seront nécessaires pour la nourriture des habitans et étrangers, suivant les ordres qui leur seront donnés.
Deffense à eux de trafiquer, commercer, vendre ni porter de gibier ailleurs qu'aux magasins, entre les mains des commis, qui seront distribués suivant lesdits ordres, sur peine, pour la première fois, de 100 livres d'amende, la moitié applicable au dénonciateur et l'autre à l'hôpital; et de rester dans l'isle deux ans à leurs dépens, sans aucuns gages ni sallaires, et, en cas de récidive, d'être pendus et étranglés.
Interdiction aussi de la "cueillette" :
Art. 15. - Ne détruiront les mouches à miel, ni n'en prendront sans permission sous peine de 12 livres d'amende. Ou bien leur sera permis d'en prendre pour les nourrir et élever dans des ruches et à la mode de France, dont il se serviront à leur usage.
Art. 16 - Que personne ne tuera ni ne prendra tortue de terre, soit pour sa nourriture ou de ses porcs, ou pour quelqu'autre raison que ce soit, sans permission par écrit du gouverneur, de la quantité qu'il permettra, et les prendront en présence de monde.
Les articles qui frappent les déserteurs ("il sera donné récompense à ceux qui les pourront prendre vifs ou mort") rappellent l'obligation de cultiver du colon. Le crime de "désertion" rappelle à la population de Bourbon qu'elle est attachée à la terre en vertu d'un rapport féodal.
Art. 17. - Que chacun fera des efforts de bonne volonté pour prendre et châtier les déserteurs de la montagne, étant l'intérêt public, et même qu'il sera donné récompense à ceux qui les pourront prendre vifs ou morts.
Art. 18. - Que personne n'aura commerce et pourparler avec lesdits déserteurs, sur peine de punition, à moins d'en donner avis à toute diligence au gouverneur, eu égard à la distance des lieux.
Art. 21. - Que tous ceux qui ont déserté et fait les quivis dans la montagne, seront exclus et privés de toutes récompenses, sallaires et payemens, et leurs biens confisqués au roy.
Art. 22. - Et par une grâce toute particulière que nous espérons faire agréer à Sa Majesté, que nous accorderons à ceux qui resteront présentement dans l'isle, ils seront remis dans des terres et possessions, dont ils jouiront comme devant en leur propre, comme les autres bons habitans, sans qu'ils puissent être aucunement recherchés, cy-après, pour ladite désertion passée, attendu qu'ils sont revenus de leur bon grez et qu'il leur a été pardonné.
L'obligation de produire est constitutive de la présence à Bourbon : les "bons habitants" cultivent les terres de la Compagnie.
Art. 13. - Que chaque habitant nourrira et dressera deux bœufs, ou un au moins, pour le labour ou pour porter, eu égard aux lieux où ils seront, le tout pour son service particulier, à peine de 10 livres d'amende, six mois après la publication des présentes, applicable comme dessus, attendu que c'est leur avantage particulier et public, puisque c'est le meilleur moyen pour avoir facilement des grains et légumes, et les porter aux navires promptement, et ainsi attirer un bon et avantageux commerce dans l'isle.
Art. 19. - Ordre à chaque habitant d'avoir, au moins par tête, deux cents volailles, douze porcs et six milliers de riz, trois milliers de légumes et grains et des bleds, ce qu'ils pourront au plus, eu égard, par le gouverneur, aux habitations, tous les ans.
La Compagnie rappelle son monopole sur les échanges :
Art. 8. - Que nul ne sortira rien de terre pour porter à la mer sans permission du gouverneur ou commandant, ni ne fera aucun commerce, à peine de vingt écus d'amende applicable, moitié pour le roy, un quart au dénonciateur, et un quart pour l'hôpital, et à faute de payement dans la huitaine restera six mois dans l'isle, à servir sans aucun gage ni salaire ; mais apporteront toutes leurs denrées et marchandises au commis es magasin du roy, établi, pour ce faire, où elles leur seront payées suivant les taxes qui en auront été faites.
Art. 9. - Que le sel et toutes autres marchandises seront portées aux magasins établis par le gouverneur, et qu'il ne sera permis à aucun d'en trafiquer sous quelques autres prétextes que ce soit, sous les peines ci-dessus, et donneront déclaration de ce qu'ils ont de hardes et marchandises du dehors, sous peine de confiscation et amende.
Art. 10. - Ouï bien pourront lesdits habitans trafiquer, vendre et débiter entr'eux, et commercer de toutes denrées et marchandises de leur crû, sans pouvoir en aucune manière en livrer, débiter ni commercer avec les gens des navires françois, ni étrangers quels qu'ils soient; mais les livreront aux magasins, d'où ils en retireront le payement au prorata de ce qu'ils auront fourni.
Art. 11. - Que des magasins du roy il en sera fourni moitié, et l'autre des habitans chacun au prorata delà quantité qu'ils en auront, afin qu'ils profitent plus à mesure qu'ils travaillent davantage.
Enfin l'article 20, souvent cité, réglemente le mariage de la population blanche :
Art. 20. - Deffense aux François d'épouser des négresses, cela dégoûterait les noirs du service, et deffense aux noirs d'épouser des blanches ; c'est une confusion à éviter.
C'est la seule mention de la population noire dans l'Ordonnance. Ce qui indique qu'aucun andevo (dont la Grande île "est assez fournie" notait Flacourt), au sens où le missionnaire Mounier peut écrire : "Pour un écu on achète un esclave qui vous sert fidèlement, lui et sa postérité." (Mémoires, p. 189) n'a été transporté à Bourbon. L'article 12 des statuts de la Compagnie de 1664 interdisait "de vendre aucuns habitans originaires du païs, comme esclaves, ou d'en faire le traffic, sous peine de vie". Tous les articles visent l'activité économique de la population blanche, et c'est le "service", c'est-à-dire l'évidence de la hiérarchie sociale et de l'exploitation du sol, qui sont en cause dans cette île où les hommes et les biens y sont rangés selon l'ordre féodal.
En réalité, dans les premiers temps, ces instructions restent lettre morte, faute d'autorité. De 1680 à 1689, il n'y a pas de gouverneur. L'île est pratiquement abandonnée : de 1676 à 1703 huit navires de la Compagnie font escale à Bourbon. Les habitants doivent produire ce qu'ils étaient supposés pouvoir acheter au magasin de la compagnie. et leur principal souci, ce sont les "Madagascarins" qui, "au lieu de cultiver [les] terres", s'abattent sur le "pauvre peuple de Mascareigne". Vauboulon appliquera le régime des concessions à partir de 1690, avec l'obligation de mise en valeur, le paiement des redevances féodales et le retour des concessions non exploitées.
Pétition des habitants de Bourbon à Colbert, le 16 novembre 1678
(Transcrite par Guët, op. cit. p. 132)
Pierre Hibon, François Mussard, Jacques Fontaine, Pierre Collin, Claude du Chauffour, François Ricquebourg, Gille Launay, René Houarault, Nicolas Prou, Hervé Danemont, Guillaume Girard, Jean Bellon, Pierre Nativelle, Jacques George, François Penaouet, George Piolant, Jean Preslen, François Vallée, Robert Vigoureux,
"Tous habitants de l'isle Bourbon, supplions très humblement Monseigneur de Colbert, protecteur spécial de ladicte isle de Bourbon, d'avoir esgard à la nécessité où elle se trouve présentement, estant dégarnie de toutte commodité nécessaire, tant pour l'entretien des familles que pour le cultivement de la terre; et surtout, ce qui nous descourage entièrement du service, est le mauvais traictement des commandants qui se saisissent de la plus grande part, du meilleur et du plus beau des petits secours qu'on y envoie, soit pour eux, soit pour leurs valets ; comme aussi de considérer qu'ils nous empeschent entièrement le commerce que nous pourrions faire avec les navires qui passent dans ces quartiers (ce qui n'arrive que très rarement). Néanmoings, nous aurions quelque consolation, si l'on nous permettoit d'eschanger les fruicts que nous cultivons en petite commodité qui nous sonts de la dernière nécessité. Monseigneur, espérant que vous aurez quelque charité pour le pauvre peuple de Mascareigne, nous vous pouvons assurer que, de nostre costé, nous contribuerons aussi de nostre meilleur à donner toute la satisfaction que peut souhaiter nostre bon Roy, que Dieu conserve et Vostre Excellence.
"Les matériaux qui nous seroient plus de besoin, ce sonts : fer, acier, meulle, avec un bon taillandier ; quelque toille bien forte pour le travail, avec des marmittes et poisles.
"Monseigneur, en passant, nous prendront la liberté de vous dire qu'il y a icy quantité de ieunesse que les navires ont laissé comme malades, et qui sonts plustost tous soldats, que dans le dessin de s'arrester dans ces quartiers, qui maudissent tous les iours le moment qu'ils ont mis pieds à terre. Ce seroit une grande charité que de les en retirer, comme aussi de nous donner la liberté de nous deffaire des Madagascarins qui sonts icy, qui sont gens traictes et turbulant ; car, pendant qu'il y en aura, au lieu de cultiver nos terres, il faut que nous leurs allions faire la guerre pour les esloigner de nos habitations.
"C'est derechef la supplique que vous font vostres humbles et obéissants serviteurs.
"De Saint-Paul, en lisle de Bourbon, ce 16e iour de nouembre mil six cent septante huict. »
(Suivent les signatures.)
Lettre de Fleurimond,
(dans Guët, op. cit. p. 133-134)
St-Paul de lisle Bourbon, 20 novembre 1678.
"Monseigneur, je prend la liberté de vous donner advis de lestat de lisle de Bourbon, [savoir] que le gouverneur que M. de la Hay y avoit establis, et depuis confiermé d'une commission de Sa Majesté àluy rendue par M. de Beauregard, est décédez le 17" juin dernier, et, ce voyant fort mal, a voulu pouruoir aux afaires du roy, consernant lisle ; pour set effet, il a fait asembler les habitants et autres et leurs a ordonné de me reconnoitre et obéir en calité de commandant, comme ayant estay lessé pour son lieutenant par mon dit sieur de la Hay. Sest pourquoy, Monseigneur, je vous suplie très humblement de me confirmer lelection qu'il a faite de moy.
"Pour alesgard de lisle, Vostre Grandeur saura que les gens sonts dans une grande dizette de toutes commodités, comme de toille forte pour faire des habits ; de linge, de poterie de fer ou de cuivre pareillement, des fermants (ferrements) et houtils de toute facçons pour trauailler aux bois et a la terre. A legard des gens nécessaire icy cesseroit des gens de trauaill et ceroit mieus a rendre seruisse à Sa Majesté. Monseigneur, vous saurez pareillement que de pui 3 ansqu'il sest gette une sy grandes cantité de rats dans la terre que l'on ne puis rien faire que ses misérable animaux ne gastte et perd tout, même jusque dans les lieux le plus inabitte. Mais, par une grâce toute particulière de Dieu, ils ne fonts pas tant de degast presantement quils onts faits par le passé.
"Monseigneur, je vous diras semblablement que dant cet isle il y a quelques noirs de la terre de Madagascar, qui ayant apris le dézastre arivey aux François du fort Dauphin, lesquelles onts voulus immiter leurs compatriottes et nauoients pas résolus moing que de ce rendre maître de la terre et de tuer tous les François, ce que Dieu na permis, par la bonne recherche que nous auons faitte des principaux auteurs, qui onts estay châtiez de mort et d'autres qui se sonts sauvez dans les montagnes et fonts tous les jours quelque brigandage ; même, ces jours dernier, sonts venus à limpourveu a la bittation du roy, à Sainte-Suzanne, onts surpris le commis, lonts mis a mort et un autre François qui estoit malade et ont tout enleué ce qu'il ont rencontre ; ce qui moblige de me metre a leurs poursuitte imcessammant afin dempecher ce desordre.
"Monseigneur, nous implorons tous vostre secour. Quil vous plaize'nous enuoyer quelque escleziastique pour nous consoler et nous départir les sacrements. Il y a bien un père capucin. Mais sest un homme fort incommodé qui ne puis pas vaquier partout ; et puis il ne veut point demeurer et natant queocazion pour se restirer.
"Monseigneur, je vous escrirois bien plus au long. Mais le respec et la crainte de vous estre importun impose le cilence, en espérant tout de vostre Bonté, et suis obligé de prier Dieu eternelement pour la continuation de vostre santé et bonne prospérité, comme estant en tout et à jamais vostre très humble et très obéissant et très fidelle serviteur.
Fleurimond
Noirs et Blancs dans l'ordonnance de Jacob de la Haye
"Il y a environ cinq ans que lon nous avoit fait entendre
que lon nous lesserés les noirs pieces deinde à deux cens frans"...
Mémoire des habitants de Bourbon du 9 décembre 1726
à "Nos Seigneurs du Conseil des Indes" (AOMN, F3 208)
Les Noirs ne sont pas considérés comme des "habitants", mais, de fait, comme faisant partie de l'"habitation" et attachés à l'habitant. La politique des "alliances réciproques", exposée dans les 13 décrets et prônée par Charpentier (et Flacourt), trouve son alternative dans l'article 20 de l'ordonnance. La politique d'alliance pouvait paraître la solution la plus économique à Madagascar pour des colons en infériorité numérique, dans l'impossibilité d'asservir et dans la conviction que le modèle européen ne pouvait que s'imposer aux yeux d'autochtones pressés de l'imiter : "Les habitants voyant de bonnes habitations fondées, écrit Flacourt, et de la façon que l'on vit dans Europe, dans la politique et dans l'ordre qu'il y a dans les villes, en la diversité des artisans et en l'utilité du commerce et du trafic, prendraient aussitôt goût à ce genre de vivre" (p. 423). François Martin, on l'a vu, est beaucoup circonspect quand il évoque, à propos des cultures qui pourraient être faites à Madagascar, la question de la main-d'œuvre : "La difficulté n'est pas seulement de connaître les lieux où l'on pourrait avoir le débit de ces marchandises, le plus important est de les cultiver dans l'île. L'on sait le nombre d'esclaves que les Français, les Anglais, les Hollandais et les Portugais emploient, ceux-là dans les îles des Indes d'Occident ; ceux-ci au Brésil ; or, Madagascar pourrait fournir quantité de noirs, mais l'on accoutumera difficilement ces peuples au travail [...] Il y faudrait un nouveau peuple, ou, par une espèce de miracle, changer les mœurs des habitants afin d'y pouvoir prendre confiance" (Mémoires de François Martin, fondateur de Pondichéry (1665-1696) publiés par Alfred Martineau, 1931, Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, Paris, tome 1, p. 170)
"Pour faire le service et cultiver la terre"
Le duc de La Meilleraye avait formé le projet d'exploiter Bourbon en y transportant des Malgaches : "Il faudra peut-être passer quelques nègres [à l'Île de Mascareigne] pour faire le service et cultiver la terre, lesquels seront pris à Madagascar" (H. Froidevaux, "Les derniers projets du duc de La Meilleraye sur Madagascar", Revue de l'Histoire des Colonies françaises, 1915, p. 401-430). L'utopie développée dans les treize articles des "Statuts, ordonnances et réglements" de la Compagnie ayant révélé son impraticabilité à Fort-Dauphin avec le massacre des Français, selon un scénario que les Malgaches de Bourbon auraient tenté de reproduire pour se rendre maîtres de l'île (relation du R. P. Bernardin, infra), les rapports de service entre habitants et Malgaches obéissent à une tout autre logique, d'inégalité et de violence. Alors qu' il était "enjoint à tous les François qui les louëront [les Originaires] ou retiendront à leur service, de les traitter humainement, sans les molester ni les outrager, à peine de punitions corporelle s'il eschet" (Charpentier, p. 91), le marronnage des Malgaches de Bourbon, venus de leur gré pour les premiers, en rupture du contrat de louage originel, fait désormais de tous ceux qui sont destinés au "service" des esclaves par destination. Les européens disposent de moyens de coercition et d'armes meurtrières.Mais cette violence physique est la forme comminatoire d'un programme qui arme, en réalité, l'asservissement productif de l'esclave : l'exploitation de la force de travail au bénéfice d'une société qui pratique la culture intensive et la marchandisation. Dans cette confrontation, la simple couleur du Blanc lui confère une position qui place l'autre homme, et spécialement l'homme de l'économie lignagère (où la propriété est collective, la parenté classificatoire et l'héritage horizontal) en position de servitude virtuelle. La mise en valeur de l'île requiert donc, "naturellement" et "nécessairement", le recours au travail servile. En octobre 1669, Du Bois anticipe, distinguant "travail" et "mise en valeur" : "Si l'on souhaite établir cette Isle il est necessaire d'y passer du monde de France pour faire valoir les terres ausquelles personnes il faudroit des Noirs pour cultiver ces terres, et faire les travaux necessaires. Ces Noirs se peuvent tirer de l'Isle de Madagascar, et particulierement dans les Provinces d'Antongil et Galemboulle et des environs, où l'on trouve des Esclaves noirs, dont on traite avec leurs Maistres qui les donnent à bon marché pour quelque marchandise qu'on leur fournit" (p. 202-203). La première mention officielle d'"esclaves" à Bourbon se trouve dans les instructions royales données le 20 mars 1689 au gouverneur Vauboulon, lui demandant "un recensement exact de tous les habitants [...] ensemble leurs bestiaux, esclaves et armes..." (Barassin, "L'esclavage..." p. 20)
"Comme ils avoient appris par un navire qui y avoit passé que leurs compatriotes avoient mis main basse sur les François du Fort Dauphin se persuadant avoir assez de ruses et de forces pour avoir leurs mêmes avantages sur ceux de l'Isle Bourbon et s'en rendre les Maîtres, [ils] ont pris occasion par trois ou quatre fois différentes d'attenter leur destruction totalle. N'estoit que Dieu, de sa sainte grâce, nous a toujours donné les lumières nécessaires pour parer et découvrir leurs ruses et mauvais desseins, il n'y auroit plus de François dans l'Isle." (R. P. Bernardin, Recueil trimestriel, t. IV, 1939, p. 60-62)
Le "service" en cause est, de fait, assuré par des "esclaves" selon un témoin de 1705 qui ne fait pas de différence parmi la population "de couleur". "Les habitants de cette isle sont servis par des nègres ou des noirs esclaves à eux vendus par les vaisseaux flibustiers qui y vont relacher; et quelquefois aussi par des vaisseaux français ou autres, lesquels, ayant fait des prises aux Indes, vendant à leur retour dans cette isle [...] les esclaves qui s'y trouvent et pour lors leur appartiennent." (Sous le signe p. 137). Jean de la Roque note en 1709 : "Tout le travail de la campagne se fait par les esclaves, les habitants travaillent fort rarement" (dans Lougnon, Voyages anciens... , p. 166). Ce sont les conditions économiques et politiques qui modifient les rapports de production et qui expliquent l'évolution de la familiarité en asservissement, quand le voisin de pioche ou le serviteur volontaire ("les nègres servent volontairement les Français", dit Flacourt) devient un outil. Les conditions de police, aussi : on voit, à la lecture des deux lettres citées plus haut, que ce que souhaitent les habitants, c'est se "deffaire des Madagascarins qui sonts icy, qui sont gens traictes et turbulant ". L'abbé Raynal écrit dans son Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes que l'île de Saint-Barthélemy est "la seule des colonies Européennes établies dans le Nouveau-Monde où les hommes libres daignent partager avec leurs esclaves les travaux de l'agriculture", ce qui paraît faire exception à cette fatalité d'asservissement. Mais "le nombre des uns ne passe pas quatre cens vingt-sept, ni celui des autres trois cens quarante-cinq", précise-t-il, et la "misère de ses habitants est si généralement connue" que même les corsaires ennemis qui font relâche dans l'île "ont fidèlement payé le peu de rafrîchissements qui leur on été fournis"(Guillaume-Thomas Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, Genève, tome VII : Amsterdam, 1780, p. 142-143).
La vente d'esclaves par les navires de passage change le regard sur le "Noir d'habitation", note Barassin, dès lors que sa force de travail peut être investie dans une production de rente. Le Code Noir de 1685 (sa promulgation pour les îles de France et de Bourbon date de 1723) est la structure juridique qui, définissant l'esclave comme bien meuble, établit une différence ontologique entre les hommes et vide juridiquement de son humanité l'éventuel compagnonnage entre colons, français et malgaches en l'occurrence. Universellement, le fait précède le droit et celui-ci, formalisant une nécessité économique, l'exploitation du sol, asservit ceux dont c'est la raison d'être. Le mot esclave "n'apparaît dans les actes que vers 1690, probablement à la suite de la venue de quelque négrier interlope" écrit Lougnon (op. cit. p. 83). Les discussions de l'époque sur la qualité de l'esclave, bien meuble ou immeuble, font apparaître la nature spécifique de la concession sous la régie de la Compagnie. La terre n'est rien sans son faire-valoir, l'esclave. Pas d'habitation sans esclave ; on ne concède pas de terre à qui ne possède pas d'esclave. La distinction opérée par le Code Noir entre les esclaves assujettis à l'exploitation des terres de ceux qui n'y sont pas attachés éclaire cette réalité. Les esclaves sont ainsi "partie des habitations" et doivent, comme le stipule la Coutume de Paris, qui répute immeubles les "pigeons des colombiers" et les "poissons des étangs", être déclarés immeubles ("Lettres patentes pour l'établissement de la Compagnie royale de Saint-Domingue", 1698, article 23). Attaché à la culture des terres, l'esclave est ici immeuble par destination (on ne peut ni le vendre sans la terre ni vendre la terre sans eux). En cas d'hypothèque ou de saisie, le prix des esclaves ne peut être dissocié du fonds (arrêt du Conseil supérieur du 22 juillet 1747, cité par Mas, 1971, p. 207). "L'affectation de l'esclave à la terre est rappelée d'une manière systématique dans tous les cas où l'édit de 1723 veut marquer l'exception au principe assimilant l'esclave à un meuble" (209). Cette liaison entre le fonds et l'esclave, caractéristique de l'habitation, est consubstantielle comme l'exprime a contrario cette disposition du règlement du 30 janvier 1737 : "Aucune personne de quelque qualité qu'elle soit ne peut être reçue à enchérir pour des noirs si elle n'a une habitation ou terrain lui appartenant" (Règlement du 30 janvier 1737, cité par Mas, id. p. 209).
Un objet des colonies est de contrôler (ou de concurrencer) la production des épices et des productions manufacturières de l'Orient. L'ordonnance de La Haye (qui reprend vraisemblablement des instructions royales qui n'ont pas été conservées) met en place un système de production de vivres et de cultures de rente fondé sur une manière de servage des habitants blancs et, de fait, sur la servitude de la population de couleur. Dans la mise en œuvre de ces cultures de rente (le café, puis le sucre), l'esclave deviendra l'outil indispensable de la production. Théorisée par le mercantilisme, c'est la naissance, dans un environnement juridique féodal, de économie coloniale. Les colonies permettent aux compagnies de commerce de développer une forme originale de servage, superposant à la dépendance des moyens de production celle de la commercialisation des produits de la terre et de la fourniture en biens. La Compagnie détient, en vertu de son privilège, le monopole de la vente d'esclaves, comme de tout autre bien et, en tant qu'entrepreneur, elle se doit d'être en mesure d'avancer aux nouveaux colons ces moyens de production nécessaires à la culture. Ces moyens lui sont d'ailleurs aussi nécessaires pour la construction et l'entretien des routes et des magasins, ainsi que pour "la marine des deux îles".
La correspondance de la Compagnie à ce titre concerne essentiellement les lieux de traite et les qualités respectives attribuées aux esclaves. Ainsi peut-on lire dans une lettre de 1710 que "les esclaves de Madagascar sont forts, mais mutins, séditieux et capables de tout entreprendre. Les exemples en sont récents, puisque le 14 janvier 1710 on a été forcé d'en faire pendre deux pour révolte". Que "les esclaves de Pondichéry sont faibles, de constitution molle, fainéants et ont peu de santé, en sorte qu'ils sont peu vaillants et on sait que les habitants ne les prennent que parce qu'ils n'en ont pas d'autres… Tandis que les esclaves de la côte Mozambique qui communément sont bien faits, forts et laborieux, obéissants et sans envie de déserter, au lieu que ceux de Madagascar n'ont que leur fuite en tête soit dans les montagnes de l'île, soit en hasardant de traverser la mer dans de simples canots pour aborder l'île de Madagascar." (Archives Nationales, Col. C3-3, 1706-1715). La préférence des habitants de Bourbon va aux Noirs de Guinée : la Compagnie objecte à cette demande la "mortalité qui en rend le prix excessif " (cité par J. Verguin, "La politique de la Compagnie des Indes dans la traite des Noirs à l'Ile Bourbon (1662-1762)", Revue historique, 1956, pp. 45-58, p. 53). Mais la colonie persiste : "Si la Compagnie n'apporte pas ses soins pour faire passer en cette île des noirs de Guinée, qu'elle n'envoie des vaisseaux de force pour jeter ici et à l'Ile de France une bonne quantité de noirs, soit de Madagascar ou de Mozambique, elle ne verra pas sitôt l'Ile de France en culture et elle perdra considérablement dans celle-ci par le café que l'habitant ne pourra ramasser et qu'il sera obligé de laisser sur les arbres, faute d'avoir des esclaves pour le ramasser, chacun ayant planté sur l'espérance que la Compagnie avait donnée, qu'elle ne laisserait point manquer de noirs." (A. N., Col. C3-5, 1727-1731). "Nous manquons d'équipage", écrira plus tard le Conseil de Bourbon en 1751, pour "la marine des deux îles", "pour nos bateaux, pirogues et chaloupes. Ces voitures nous sont absolument nécessaires pour charroyer les cafés et les grains d'un quartier à l'autre". Les esclaves tirés de Madagascar qui "cherchent continuellement à enlever les chaloupes et pirogues pour se sauver" étant impropres à cette activité (A. N., Col. C3-10, 1751-1754), il demande de nouveau des noirs de Guinée…
On voit bien que dans cette discussion, la nécessité se subordonne toute autre considération. La déshumanisation de l'esclave est ramassée, au-delà de l'euphémisation, dans l'objet de traite qui en exprime la valeur et par lequel on le désigne : une "pièce d'Inde", soit une cotonnade imprimée produite d'environ quatre mètres. L'appellation résume à la fois la "mondialisation", puisque le produit, manufacturé dans l'Indoustan, sert à l'achat d'esclaves pour les plantations d'Amérique, et la philosophie qu'elle met en œuvre : un "Nègre pièce d'Inde" est une unité de compte qualifiant un sujet jeune et sans défaut physique, ressource idéale pour la plantation. "On appelle dans la traite ou commerce des Negres, Negre Piéce-d'Inde, un homme ou une femme depuis quinze ans jusqu'à vingt-cinq ou trente ans au plus, qui est sain, bien fait, point boiteux et avec toutes ses dents […]" (Savary, Dictionnaire universel de commerce, tome second, 1723, col. 1082). L'appellation des toiles dites "guinées de l'Inde" (Commerce et traite des noirs aux côtes occidentales d'Afrique, par Louis-Edouard Bouët-Willaumez, 1848, p. 40), qui étaient expédiées dans les ports européens en balles pressées de 700 kg (Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes, Horace Doursther, Bruxelles, 1840, p. 552), corrobore cette mise en relation des trois continents à l'actif naturel des compagnies de Indes, comme l'exprime la déclaration du roi quand il révoque, au profit de la Compagnie des Indes (infra, dans Fresne de Francheville, septembre 1720, p. 516-517) les lettres patentes de janvier 1716 pour le "Commerce de la côte de Guinée". "S'il plaît à Sa Majesté de rétablir en faveur de ladite Compagnie des Indes le Privilege Exclusif pour le Commerce de ladite Côte de Guinée, lequel sera d'autant plus facile à ladite Compagnie et d'autant plus avantageux à l'Etat, que ladite Compagnie se trouvant en situation de porter, tant des Indes que du Royaume, toutes les Marchandises nécessaires pour le Commerce de ces Côtes". Dans le Guide du commerce de Gaignat de l'Aulnais (1771), l'achat d'un captif, daté du 17 avril 1761, dont le prix a été fixé à 7 onces et 9 écus est réalisé en échange des toiles suivantes : 1 Pièce de Néganepaux, 1 pièce de Batujapaux, 1 Salempouris blanc (avec : de l'eau de vie, des fusils (2), des barils de poudre (2), des pierres à fusil (30), des couteaux (12), des chapeaux (2)). Celui de douze Négres, daté du 5 juillet 1761, contre les marchandises suivantes, dont des pièces de Néganepaux, d'Indienne, de Liménéas, de Siamoises, de Gingas... :
Guide du commerce de Gaignat de l'Aulnais (1771)
Dans un projet d'armement décrit dans son Second voyage à la Louisiane, faisant suite au premier de l'auteur de 1794 à 1798 (Paris, 1803, p. 154-155), Baudry des Lozières – par ailleurs auteur des Égarements du nigrophilisme – rassemble, en vue de "traiter six cents nègres à la côte d'Angole", les articles de toile suivants :
2.400 Pièces de guinée bleue de 14 aunes,
550 Indiennes de différents dessins, de 14 aunes,
450 Liménéas de différents dessins,
700 Chasselas, Idem,
700 Bajutapeux, Idem,
300 Néganepaux, Idem,
et autres Batavias, Niconnois, Tapselles, Photes, Cochelis, Cholets, Romales, Coros doubles, Platilles, Mouchoirs de l'Inde…
Dans l'ouvrage de Fresne de Francheville, publié en 1738, Histoire générale et particulière des Finances, où figurent les Actes touchant les diverses compagnies de commerce ("Histoire de la Compagnie des Indes avec les Titres de ses Concessions et Privilèges"), le terme "esclavage" n'apparaît qu'à trois reprises et dans l'expression "Droit d'esclavage" (p. 31, 171, 183). À la rubrique "Noms de Marchandises", la "Table alphabétique contenant les Matières de Finances et de Commerce" porte le terme "Négres" qui renvoie à la lettre "N", la traite humaine étant comprise dans le "Commerce de Guinée"…
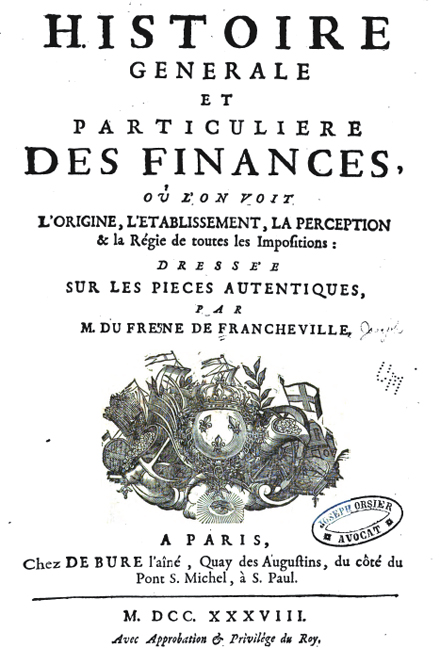
Les extraits qui suivent de l'ouvrage cité mettent en évidence la fonction des compagnies de commerce dans la traite à destination des "Colonies" :
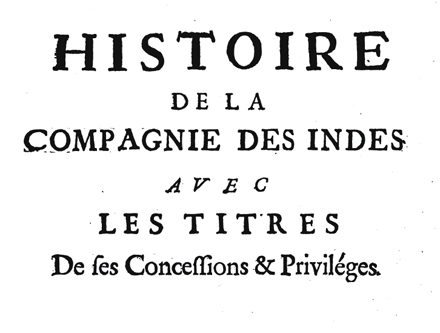
- Révocation du privilège accordé aux "Intéressez en la Compagnie du Sénégal" (septembre 1684), p. 454 :
"Sa Majesté étant informée que non-seulement lesdits Intéressez en la Compagnie du Sénégal, n'ont point exécuté ledit Contrat, ni porté aux Isles lesdits deux mille Nègres ; mais même qu'ils y en ont transporté si peu, que la plupart des Habitants des Isles qui en manquent, et n'ont point d'autre moyen de cultiver leurs Terres et Habitations, projettent d'abandonner les Isles, et de se retirer à la Coste de Saint-Domingue, et autres lieux ; ce qui ruineroit infailliblement ce Commerce, et les Colonies."
- "Déclaration du Roi pour l'Etablissement d'une Compagnie de Guinée, qui fera seule, le Commerce des Négres, de la Poudre d'Or, et de toutes autres Marchandises qu'elle pourra traiter aux Côtes d'Afrique." (Janvier 1685, p. 489)
- "Arrêt du Conseil d'Etat, qui exempte de tous Droits de sortie toutes les Marchandises qui seront chargées dans les Vaisseaux de la Compagnie des Indes Occidentales, pour être portées aux Côtes de Guinée" (septembre 1671, p. 488)
- "Arrest du Conseil d'Etat, qui accorde et réunit à perpétuité à la Compagnie des Indes le Privilège Exclusif pour le Commerce de la Côte de Guinée" soit "la Traite de Négres, de la Poudre d'Or et autres marchandises qui se tirent des Côtes d'Afrique, depuis la Riviere de Serralionne inclusivement, jusqu'au Cap de Bonne Espérance, à la charge par ladite Compagnie de faire transporter suivant ses offres par chacun an la quantité de Trois mille Négres, au moins aux Isles Françoises de l'Amérique."
- Causes de la révocation de la liberté accordée par les Lettres patentes de janvier 1716 pour le "Commerce de la côte de Guinée" :
"Sa Majesté étant informée qu'au lieu des avantages qu'on attendoit de cette liberté générale, il en résulte de très grands inconvéniens. Le Concours des différens Particuliers qui vont commercer sur cette côte, et leur empressement à accélérer leurs Cargaisons pour éviter les frais du séjour, étant cause que les Naturels du Païs dont sis excessivement baisser le prix des Marchandises qu'on leur porte, et tellement suracheter les Négres, la Poudre d'Or, et les autres Marchandises qu'on y va chercher, que le Commerce y devient ruineux et impraticable ; Sa Majesté a résolu d'y pourvoir en acceptant les offres de la Compagnie des Indes, de faire transporter par an jusqu'à Trois mille Negres, au moins, ausdites Isles Françoises de l'Amerique, au lieu du nombre de Mille Negres porté par les Lettres Patentes de 1685 ; s'il plaît à Sa Majesté de rétablir en faveur de ladite Compagnie des Indes le Privilege Exclusif pour le Commerce de ladite Côte de Guinée, lequel sera d'autant plus facile à ladite Compagnie et d'autant plus avantageux à l'Etat, que ladite Compagnie se trouvant en situation de porter, tant des Indes que du Royaume, toutes les Marchandises nécessaires pour le Commerce de ces Côtes, et d'y faire des Etablissements par le moyen desquels les Vaisseaux qu'elle y envoyera, trouveront à leur arrivée des Cargaisons prêtes pour leur retour. Elle pourra non-seulement fournir aux Colonies Françoises de l'Amerique, à un prix raisonnable, le nombre des Négres nécessaires pour l'entretien et l'augmentation de la Culture dans leurs Terres, mais encore faire entrer dans le Royaume une quantité considérable de Poudre et Matieres d'Or, et d'autres Marchandises propres pour le Commerce" (septembre 1720, p. 516-517).
A quoi sert la liberté ? (bases de discussion...)
L'Article "Negres" du Dictionnaire de Savary expose ce qui suit :
"Les Européens depuis quelques siécles font commerce de ces malheureux Esclaves, qu'ils tirent de Guinée et des autres Côtes de l'Afrique, pour soutenir les colonies qu'ils ont établies dans plusieurs endroits de l'Amérique et dans les Isles Antilles.
Il est difficile de justifier tout-à-fait le commerce des Negres ; cependant il est vray que comme ces misérables Esclaves trouvent ordinairement leur salut dans la perte de leur liberté, et la raison de l'instruction Chrétienne qu'on leur donne jointe au besoin indispensable qu'on a d'eux pour les cultures des sucres, des tabacs, des indigos, etc. adoucissent ce qui paroit d'inhumain dans un négoce où les hommes sont les Marchands d'autres hommes, et les achètent de même que des bestiaux pour cultiver leurs terres" (Savary, Dictionnaire universel de commerce, tome second, 1723, col. 858).
Les justifications – pour ceux qui se posent la question de la légitimité du commerce des Noirs – sont donc : l'instruction chrétienne qu'on donne aux esclaves et la nécessité économique (soutenir les colonies…) et comme la liberté des Noirs est sans objet, ces deux utilités s'aditionnent dans le paradoxe suivant : "Les esclaves trouvent leur salut dans la perte de leur liberté"… C'est l'opinion professée par le Père Labat qui fait de la sujétion des Africains dans les îles le seul moyen de les convertir durablement, la polygamie native des sociétés africaines constituant un obstacle dirimant à la conversion quand "la mortification, l'humilité, la continence, la fuite des plaisirs [...]" sont des vertus (Nouveau Voyage aux iles de l'Amérique, Paris, 1743, t. 4, p. 435 et p. 436).
Au-delà de l'évidence, celle d'aujourd'hui étant radicalement autre que celle d'hier, pour comprendre le déni de reconnaissance en cause, la facilité de la réification de l'esclave, la banalité et l'ampleur de l'institution, il faut avoir à l'esprit, s'ajoutant aux considérations immédiatement économiques, l'inversion des valeurs que peut constituer, aux yeux de l'européen, le mode de vie des sociétés "exotiques" : l'étonnement de la différence sociale n'est pas moindre que l'étonnement de la différence physique. La vulnérabilité de l'Afrique aux traites négrières est celle, mutatis mutandis, des chasseurs-cueilleurs face à l'avancée des "fermiers" (voir : L'invention néolithique ou le triomphe des fermiers…) : contraints au repli sur la peau de chagrin de leur écosystème et n'ayant plus les moyens écologiques de leur survie, ils se rendent à la "civilisation" et s'y louent ; décivilisés en réalité, ils constituent le lumpenproletariat des fermes, des haciendas, des banlieues…
Lorsqu'on lit les jugements anciens sur l'homme noir, il s'y révèle d'abord une morphopsychologie taillée à la mesure de la face européenne (voir infra : la sémantique d'Othello : chapitre 20.1 Othello, ou la tragédie de l'apparence). Pour les hommes du XVIIe ou du XVIIIe siècle, l'homme noir n'est pas seulement un être qui est naturellement dans la nature ou près de la nature par son écologie et sa culture, il est condamné à cette place par son anthropologie physique. "Ils ont de la laine sur la tête". "Leur psychologie se résume dans leur face grossière". "Leur âme est proprement dans leur physique"... Alfred Michiels, traducteur français de La Case de l'oncle Tom et abolitionniste lui-même, déclare "que l'esclavage avait non pas provoqué la dégénération des Africains mais au contraire favorisé leur accès à la civilisation. Si l'on voulait se donner la peine d'observer les Noirs dans leur Afrique natale, 'loin de toute influence européenne', on se rendrait compte qu'ils forment 'la plus stupide, la plus perverse, la plus sanguinaire des races humaines' et qu'ils 'croupi[ssent] dans cette immobilité', ne faisant preuve d''aucun progrès, aucune invention, aucun désir de savoir, aucune pitié, aucun sentiment'. Et Michiels d'ajouter : 'La couleur noire, la couleur des ténèbres, est vraiment le signe de [leur] dépravation'" (cité par William B. Cohen, Français et Africains, Les Noirs dans le regard des Blancs, 1530-1880, Paris, 1981, p. 290-291).
Ces clichés paraissent essentiellement alimentés, confirmant la morphopsychologie différentielle, par le constat de d'une inversion de valeurs propre au mode de vie associé à l'homme noir et notamment d'une anti-morale économique, celle du "fermier" étant fondée sur le travail, l'accumulation, la réserve, la prévision, soit un sens économique et responsable du temps... "Oubliant le passé, contents du présent, sans inquiétude pour l'avenir", ils sont dans une "éternelle enfance" (Charles, A.Walckenaer, Recherches géographiques sur l'intérieur de l'Afrique septentrionale, Paris, 1821, p. 182) "La jouissance du moment est la seule qu'ils désirent" (Degranpré, 1801, p. 80-81, Voyage à la côte occidentale d'Afrique fait dans les années 1786 et 1787, Paris, Dentu, 1801). Ils pratiquent une agriculture extensive. Les travaux des champs sont exécutés par les femmes. Ils sont polygames ("L'usage de la polygamie les autorise à prendre tout autant de femmes qu'ils jugent à propos ; elles sont esclaves" - Degranpré. op. cit. p. 101). "Les hommes pour la plupart ne font rien" '(Louis Moreau de Chambonneau, "Traité de l'origine des nègres du Sénégal, coste d'Afrique, de leur pays, religion, coutumes et mœurs", dans Notes et documents", B.I.F.A.N. 30, 1968, p. 321) Ils utilisent la houe (et non la charrue). Chez eux, la terre est commune et n'est pas bornée. "N'ambitionnans point les Richesses, tout est commun chez eux pour les immeubles; car la terre qu'ils cultivent ne leur est point vendue et ils ne la vendent point. Ils en prennent ou bon leur semble" (Moreau, op. cit. p. 320). La femme est juridiquement inférieure à l'homme et ils épousent sans dot. Le fils n'hérite pas du père... Au-delà de l'utilité immédiate dans la course économique où il est engagé et au-delà de la dévaluation morale et intellectuelle, l'européen, s'il se pose la question – mais la longue durée de la traite, ajoutée aux arguments religieux, la rend quasi naturelle – voit vraisemblablement dans l'homme africain un archaïsme économique… L'idéologie de la traite (et de la colonisation) se légitime dans une apologie de la responsabilité civilisatrice de ceux qui font un usage adéquat de la liberté : celui de l'initiative économique.
Le Code Noir moralise ainsi à propos de l'affranchissement (art. 59) : "Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets". A Bourbon, Auguste Delabarre de Nanteuil, développe dans sa Législation de l’Île Bourbon, répertoire raisonné, (Paris, 1844) à propos de "l’institution de l’esclavage [qui] remonte à l’enfance de la Colonie" (p. 89) : "Il est reconnu que les Européens ne peuvent sans danger pour leur existence, se livrer à la culture des terres sous la zone torride, et que les noirs seuls peuvent y être employés, principalement ceux qui habitent les pays les plus rapprochés de l’équateur. L’esclavage existait à Madagascar ; le voisinage de cette île rendit alors facile l’introduction des Noirs à Bourbon." Delabarre de Nanteuil cite alors une "Statistique de Bourbon" établie par un certain M. Thomas, ayant résidé dans l’île de 1818 à 1824 et qui argumente ce qui suit : "L’homme ne travaille que pour satisfaire à ses besoins et aux projets de son ambition. Le noir ne connaît pas l’ambition et n’a que très peu de besoins. Abandonné à sa volonté, il ne fait rien ; sa vie n’est qu’un long repos entrecoupé de rares instants d’activité. Il faut, pour sortir de cette inertie, qu’il soit forcé au travail et l’on n’y parvient qu’en lui imposant une entière soumission aux ordres d’autrui […] L’esclavage est dans les colonies françaises une domesticité viagère, tandis qu’en France la domesticité est un esclavage annuel et temporaire. Voilà sa véritable définition." (p. 90) "Il serait difficile de concevoir un régime plus doux et plus ferme en même temps. Les maîtres sont aimés, parce qu’ils sont justes […] certains articles de l’édit de 1685, vulgairement appelé le Code noir, sont inconnus à Bourbon et n’y ont jamais reçu d’exécution : ce qui autorise à penser, dirai-je ici, qu’on connaît bien moins en France que dans les colonies le régime intérieur qui convient à celles-ci." (p. 113) Dans les États du sud, aux États-Unis, John Calhoun (1782-1850), théoricien de l'idéologie sudiste, explique que la liberté se mérite. "It follows from what has been stated, that is a great and dangerous error to suppose that all people are equally entitled to liberty. It is a reward to be earned, not a blessing to be gratuitously lavished on all alike – a reward reserved for the intelligent, the patriotic, the virtuous and deserving, and not a boon to be bestowed on a people too ignorant, degrated, and vicious to be capable either of appreciating or of enjoying it." (John Caldwell Calhoun,1782-1850, A Disquisition on Government, 1995, p. 42-43, Shannon C. Stimson, Hackett Company, Indianapolis).
Il ressort de ces quelques citations que la liberté n'est pas un donné de nature partagé par tous les hommes, mais l'expression juridique de la responsabilité économique individuelle, soit le propre d'une société stratifiée à l'européenne où la vie est "civile" et les mœurs "paisibles". Sans cet investissement, la liberté est sans objet. Preuve en est, la situation de dépendance à laquelle sont condamnés les peuples dont la liberté est en friche. "Ceux qui dépassent les autres par la sagesse [prudentia] et par la raison [ingenio], même s’ils ne l’emportent pas par la force physique, ceux-là sont par nature même les seigneurs [hos esse natura dominos] ; par contre les paresseux et les torpides [tardos et hebetes], même s’ils ont la force physique pour exécuter toutes les tâches nécessaires, sont par nature des serfs [servos esse natura]. Et cela est juste et utile qu’ils soient serfs, et nous le voyons sanctionné par la loi divine elle-même […] Telles sont les nations barbares et inhumaines, réfractaires à la civilité et à l'urbanité. Et il sera toujours juste et conforme au droit naturel que ces gens soient soumis au pouvoir de princes et de nations plus cultivés et humains, de façon que, grâce à la vertu de ces dernières et à la sagesse de leurs lois, ils abandonnent l'état de nature et se plient à une vie plus humaine et au culte de la vertu.
Et s’ils se refusent à cet empire, on peut le leur imposer par le moyen des armes et cette guerre sera juste, ainsi que le décrète le droit naturel…"
(Juan Ginés de Sepulveda, Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, [Dialogum de justis belli causis], traducción al español de Marcelino Menéndez y Pelayo, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1941, p. 84).
Le Chasseur-cueilleur, le Fermier, l'"Interessé"…
On peut rappeler ici l'analyse de Tocqueville chez les Indiens d'Amérique, comparant l'écologie du fermier et celle du chasseur-cueilleur, notant qu'"un mille carré pouvait nourrir dix fois plus d'hommes civilisés que d'hommes sauvages" et qu'en (funeste) conséquence "la raison indiquait que partout où les hommes civilisés pouvaient s'établir, il fallait que les sauvages cédassent la place" (Lettres choisies. Souvenirs, 1814-1859, Gallimard 2003, p 254-259). "Ce monde-ci nous appartient, ajoutaient-ils ; Dieu en refusant à ses premiers habitants la faculté de se civiliser, les a destinés par avance à une destruction inévitable. Les véritables propriétaires de ce continent sont ceux qui savent tirer parti de ses richesses." (Voyage en Amérique, 1991, édition de la Pléïade, I, p. 364) L'"intéressement", l'investissement financier des "intéressés", démultiplie la production de la terre non seulement en étendant la glèbe à la colonie et en mettant la production agricole sous la coupe du commerce, mais en soumettant la productivité de la terre à la productivité de l'argent. A l'extinction silencieuse des chasseurs-cueilleurs, la mise en place des cultures de rente, sucre, café, coton... ajoute la nécessaire déportation d'hommes arrachés à leur écologie de culture extensive.
Le café
"A la fin du siècle, écrit Albert Lougnon, on ne savait plus bien de qui relevait Bourbon. Les directeurs de la Compagnie des Indes invoquaient les rétrocessions successives de Madagascar, des 'forts et habitations en dépendant', pour affirmer avec véhémence que Mascarin ne leur appartenait pas, pour assurer qu'ils n'avaient jamais rien prétendu en faire et qu'ils n'en voulaient pas user à l'avenir 'étant trop loin de l'Europe et trop près des Indes… n'y ayant nul abri, mauvais ancrage, des courants affreux '" (Les directeurs de la Compagnie des Indes à Pontchartrain. Paris, 9 février 1698, AOMN, C2 f° 11. cité par Lougnon, 1956, p. 16-17). En 1710, "il n'y a que le quart des étendues concédées qui soient en culture" (Mémoire de la Cie à Parat, Recueil, cité par Mas, p. 53) "Les quelques 1500 personnes qui habitent l'île en 1715, conclut Lougnon, l'historien du café, passionnées de chasse et de pêche, aussi bien les maîtres que les esclaves, paraissent réfractaires à tout effort et sont dépourvues de toute initiative." "Ce rocher qui lui est à peu près inutile, la Cie des Indes orientales a d'abord feint de l'ignorer." (Lougnon, p. 333-334)
Dès 1716, l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences (1716, p. 34-35) fait mention officielle de la découverte d'un caféier indigène à Bourbon. "Les habitants de l'Isle de Bourbon prés de celle de Madagascar ayant vû par un Navire François qui revenoit de Mocha en Arabie des branches de Cafier ordinaire chargées de fëulles et de fruits, ils reconnurent aussi tôt qu'ils avoient dans leurs Montagnes des Arbres tout pareils, et en allèrent chercher des branches, dont la comparaison convainquit nos gens. Seulement le Caffé de l'isle de Bourbon est plus long, plus menu, plus vert que celui d'Arabie, et l'on dit qu'étant torréfié ou brûlé il a plus d'amertume. M. de Jussieu tenoit cette relation de M. Gaudron Maître Apoticaire de Saint-Malo. Ce seroit un avantage pour le Royaume d'avoir une Colonie, d'où il pût tirer ce fruit qui a une vogue si prodigieuse. La différence du Caffé de l'Isle Bourbon à celui d'Yemen seroit peut-être à l'avantage du premier, quand elle seroit bien connuë, sinon on pourrait trouver le moyen de la corriger." Le transport, par le Chasseur, d'une soixantaine de caféiers de Moka, en 1715, qu'un agent du nom d'Imbert est parvenu à se procurer, la nouvelle, rapportée par le gouverneur Parat que Bourbon possède un caféier indigène, l'opinion d'Antoine de Jussieu que c'est du vrai café, l'engouement pour les entreprises coloniales, tout cela détermine, en 1717 la mise sur pied d'un plan d'exploitation rationnelle de l'île. (Lougnon, p. 334)
L'histoire du café à La Réunion...
par Albert Lougnon
L'île Bourbon pendant la Régence, Desforges-Boucher, les débuts du café
(Paris, Larose, 1956)
Le secrétaire général de la Compagnie, Louis Boyvin d'Hardancourt, est chargé d'une mission par les directeurs pour évaluer les comptoirs. Il séjourne à Pondichéry et à Bourbon du 20 avril au 3 septembre 1711. Au cours d'une excursion dans les environs de Saint-Paul, il découvre un caféier indigène. "Ce café est un peu plus gros que celui de Moka et pointu par les extrémités." (Mémoire de M. Hardancourt, pp. 132-33) (Lougnon, p. 61) Ce caféier indigène n'a été décrit qu'en 1783, par Lamarck, sous le nom de Coffea Mauritiana. La première mention publiée du café indigène de Bourbon se trouve dans l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences, année 1716, 1718, p. 34 sous le titre de "Observations botaniques" (supra).
Ponchartrain, secrétaire d'État à la marine : au capitaine de l'Auguste, le 31 octobre 1714 : "Les directeurs de la Cie des Indes ayant besoin de tirer de Moka où vous devez aller des arbres qui produisent le café, l'intention du Roi est que vous y chargiez la plus grande quantité que vous pourrez de ces arbres pour les remettre au gouverneur de l'île Bourbon qui aura soin de les faire planter et cultiver. Comme vous devez passer à la côte de Malabar, Sa Majesté désire aussi que vous y preniez des plants et arbustes qui produisent le poivre et la canelle sauvage [ces derniers devant servir de porte-greffes], et que vous les remettiez pareillement à ce gouverneur." (p. 69-70)
Vu l'importance "d'un événement aussi avantageux" que la "nouvelle découverte du café faite en cette île", il était urgent d'"envoyer quelqu'un en France, tant pour informer la Cour... que pour donner les éclaircissements qui pourraient être nécessaires sur ce qu'il y aurait à faire en pareille conjoncture". Ce fut le gouverneur Parat lui-même qui fut député...(11 nov. 1715).
Le Chasseur "jette l'ancre à Saint-Paul le 25 septembre 1715 et y déposa vingt caféiers des soixante embarqués à Moka, les autres ayant péri" (p. 73)
"Des vingt caféiers de Moka que le Chasseur avait déposé à la fin de septembre 1715, dix-huit n'avaient pas résisté à la transplantation. Les deux derniers, confiés à la sollicitude des frères Martin, habitants de Saint-Denis avaient fini par prendre racine. Au mois de septembre 1717, ils étaient couverts de fleurs. On voyait bien alors, écrivait Justamond, qu'il s'agissait d'une autre espèce que l'indigène car "le bois et la feuille étaient différents". Des graines que l'on cueillit au début de 1718, 605 furent distribuées à 32 habitants de Saint-Denis dont 450 aux seuls frères Martin, et 78 à 23 colons de Sainte-Suzanne. De ces 603 graines, 484 ne levèrent pas, et sur les 199 plants issus du reste, 82 furent encore détruits pas les bêtes. Peu s'en fallut que la souche elle-même disparut." (p. 115) Au mois de janvier 1719, le caféier des frères Martin commence à donner, pour la deuxième fois, des graines mûres. Une distribution en avait été faite jusqu'en juillet. [..] 2.693 semences avaient été distribuées à 123 habitants. [...] On s'était trouvé riche de 779 sujets, ce qui joint aux 117 rescapés de la plantation de l'année précédente, faisait à la fin de 1719 un total de 896 rejetons. En mai 1720, troisième récolte [..] 15.000 graines furent cette fois mises en terre qui, en octobre donnaient 7.000 sujets." (p. 151) (A. Lougnon d'après les calculs de Guet)
Dix-huit à vingt mois après que la graine a été mise en en terre on a un sujet de cinq pieds de haut. Dès lors il fleurit et le fruits sont mûrs avant la deuxième année. La caféier de Moka porte à la fois des fleurs et des fruits si bien que l'on peut faire deux récoltes, l'une en mars et avril, l'autre en juin et juillet, mais la deuxième est moins abondante des trois quarts et la graine n'est pas plu grosse que celle qui vient d'Arabie alors que les fèves de la première ont un volume double.Le total est considérable. L'arbre-souche en trois ans, n'a pas produit moins de "quinze livres de café, quoi qu'il en ait coulé plus de la moitié". Un seul point noir, et d'importance : les baies murissent pendant la saison des ouragans. Il serait intéressant d'obtenir que ce soit en novembre et décembre. On se propose, pour y atteindre, de greffer le caféier de Moka sur le caféier indigène." (p. 152)
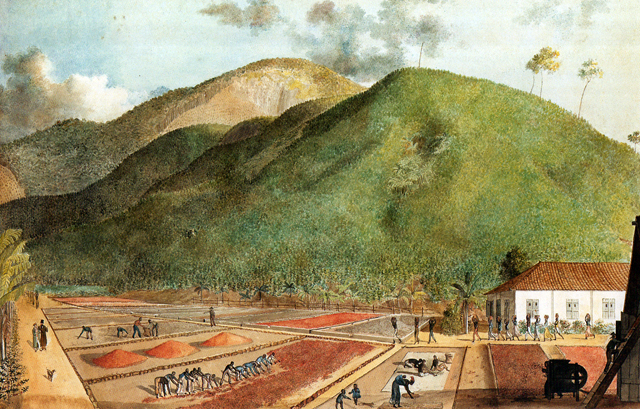
La culture du café à l'île de Bourbon, aquarelle attribuée à J. J. Patu de Rosemont, début du XIXe siècle
(Paris, Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie)
"Lorsque par une belle matinée j'arrivai au pied de ces fertiles coteaux, je crus entendre, j'entendis en effet, mais d'une assez grande distance, un chœur à deux parties dont les voix parfaitement d'accord tombaient et se relevaient tour à tour : les chants étaient interrompus par des sons prolongés pareils à ceux du cor. "Comment trouvez-vous cette musique ?" me dit un habitant dont j'étais accompagné [...] Le créole, ajouta-t-il, qui après un long voyage reviendrait dans sa patrie, ne pourrait, ce me semble, entendre sans émotion ce chant des nous qui travaillent dans la montagne, ce bruit éloigné de l'encive qui résonne ainsi dans les rochers [...] Il y avait un grand mouvement sur l'argamasse de l'habitation ; deux cents noirs et négresses étaient occupés à piler du café de l'année précédente ; ils étaient rangés des deux côtés d'une longue pièce de bois dans laquelle de grands mortiers étaient creusés ; avec de forts pilons qui marquait le mouvement de leur chanson, ils brisaient la pulpe coriace et desséchée qui enveloppe la fève du caféier. rager les noirs dans les premiers moments ; elles se réunirent bientôt aux enceintes qui occupaient une autre partie de l'argamasse. A mesure qu'il y avait du café de pilé, des noirs le portaient au moulin à vanner, semblable à notre moulin à vanner le blé, ou, ce qui valait mieux, le montaient sur un échafaudage assez élevé d'où ils le laissaient ensuite retomber : l'écorce brisée s'envole comme la paille de nos épis ; les fèves, plus lourdes, demeurent au-dessous de l'échafaud ; les négresses les reprenaient pour achever de le monder, en les débarrassant des grains défectueux ou de ceux que le pilage avait brisés. Les nourrices faisaient des sacs de vacoi, dans lesquels vous voyez nos cafés de Bourbon arriver en Europe.Le géreur blanc avec son bâton ferré à la main, les commandeurs armés du chabouc, parcouraient les travaux, gourmandant les paresseux, et distribuant l'ouvrage de tous les côtés." (Auguste Billiard, Voyage... 1822, p. 92-94)
"Quel bonheur d'avoir en terre française des drogues et des épices que les Arabes et les Indiens ne cédaient que contre des métaux précieux ! Les bons Bourbonnais borneraient leurs prétentions, on s'en flattait du moins, à échanger contre des marchandises de la métropole le produit de leur cueillette, et les principes du mercantilisme seraient sauvegardés" (Lougnon, op. cit. p. 79). Les "bons Bourbonnais" ? Le recensement de 1713 dénombre 633 personnes de condition libre et 533 esclaves. "On en avait reçu une demi-douzaine de Maurice, quatre en 1707 […] La plupart provenaient de navires de passage qui les avaient pris au Mozambique, à Madagascar ou dans l'Inde, vingt-six d'un anglais en1699, seize de deux écossais en juin 1702 […] un trentaine de Pondichéry en 1707 et encore quelques-uns en 1710". En termes prosaïques Lougnon conclut : "Tout cela était bien peu de chose, et si l'on voulait sérieusement s'adonner à la culture des épiceries, il fallait envisager une importation massive de main-d'œuvre" (id. p. 105). Il fallait aussi intéresser les colons à cette culture de rente et réorganiser la colonie en conséquence.
Le plan de colonisation de 1717
En appui à ses deux agents administratifs, le gouverneur et le garde-magasin, la Compagnie installe un major et un aide-major, le garde-magasin étant promu lieutenant au gouvernement. Les directeurs de la Compagnie délèguent au gouverneur les pleins pouvoirs administratifs, judiciaires et législatifs. Un état des lieux des titres et des possessions s'imposait dès lors qu'une exploitation rationnelle du café était attendue. "Considérant que plusieurs habitants avaient obtenu des gouverneurs des terres d'une étendue telle qu'ils ne pouvaient les cultiver toutes, écrit Lougnon ; que certains, alléguant l'épuisement de leur fonds, en sollicitaient constamment de nouvelles tout en s'opposant à ce que les domaines laissés à l'abandon fussent concédés à des tiers, les directeurs [...] avaient obtenu de Louis XIV , le 27 février 1713, une ordonnance suivant laquelle tous les titres de concession de terres à Bourbon seraient représentés au Conseil provincial "pour ne connaître les étendues", après quoi il serait délivré gratuitement de nouveaux contrats "aux redevances dont on conviendra". Cette ordonnance n'avait pas été exécutée. Les directeurs enjoignirent de le faire" (id. p. 86-87).
C'est aussi l'occasion pour la Compagnie, "après rappel de l'obligation de mettre en valeur dans un délai de trois ans sous peine de réunion au domaine de la Compagnie", d'introduire de nouvelles clauses. "Chaque année, au mois de janvier le concessionnaire aurait à verser la somme de cinq sous par arpent, en argent ou en nature, à titre de cens et rentes recognitifs de seigneurie, et à remettre au magasin une poule et un chapon à titre de redevance. En outre les habitants livreraient une partie du café et du poivre qu'ils recueilleraient aussi bien sur les terres non concédées que sur leur propre fonds, la moitié ou le tiers dans le premier cas, le cinquième dans le second. Enfin il serait perçu à chaque mutation un droit de lods et de ventes de un sou huit deniers par livre numéraire, soit 12 % du prix. Moyennant quoi les habitants n'auraient pas à payer de dîme au clergé." (id. p. 87 : 10 nov. 1717 "Instructions et ordres de la Cie des Indes pour Messieurs Beau voilliers (sic) de Courchant, gouverneur, Boucher lieutenant..." Après quelque difficulté du Conseil de marine, liée à sa naissance et à sa réputation de légèreté, Boucher est fait second du gouverneur. Il aurait à "exciter, dresser et instruire les habitants à la culture de tous les fruits qui y croissent et qui pourront y être cultivés... faire rechercher les mines, métaux et minéraux... veiller à la restriction des [terres] qu'on a ci-devant concédées sans mesure et sans proportion à la force de ceux qui les ont demandées... [en] régler le cens et les rentes annuelles... régir en chef tout le commerce dans ladite île de Bourbon." (id. p. 90)
Ce programme a pour première disposition des contraintes renforcées sur les colons. D'abord l'insertion dans les contrats de l'obligation de cultiver le café. La formule est inaugurée par la concession faite à Jacques Auber, le 4 septembre 1719, qui "promet et s'oblige de cultiver et faire valoir le terrain qui lui sera concédé et de s'attacher principalement à la culture du café." (Mas, op.cit. p. 57) Le 4 décembre 1715, le Conseil provincial statue que "chaque homme travaillant, tant blanc que noir, depuis l'âge de quinze ans jusqu'à soixante" serait tenu d'en cultiver cent plants qu'il irait prendre dans les bois et replacerait en terre à cinq pieds de distance les uns des autres, comme de cueillir une livre de ce café sauvage pour être remis, sec et net, au commandant de l'île "au plus tard à la Notre-Dame de mars." (ADR, C° 1, f° 32) "Les vagabons et fainéants sans aucune distinction seront s'ils ne se mettent pas au travail employés aux usages publics selon que les gouverneurs jugeront à propos" (ordonnance du 21 novembre 1718). La Cie entend également faire respecter son monopole. Les habitants qui "en 1715 ne versaient au suzerain à peu près aucune taxe" doivent maintenant participer aux dépenses. Ordre a été donné, en 1717, de réviser les contrats de concession des terres, de limiter l'étendue des domaines, de les charger d'un cens recognitif de seigneurie et d'une redevance en nature, de les assujettir au droit de mutation des lods et ventes, de contraindre les habitants de remettre gratuitement à la Cie le cinquième du café qu'ils récolteraient sur leur propre fonds. En 1724, la corvée seigneuriale est instituée au seul profit du suzerain et non de la collectivité. (Lougnon, op. cit. p. 338)
Ces contraintes se révèlent d'une efficacité toute relative. Desforges-Boucher fit prendre en 1724 une ordonnance portant mise en séquestre des concessions qui ne portaient des "caffeyers originaires de Moka". Les "fulminations" de Desforges-Boucher contre les habitants ont souvent été rapportées, note Lougnon. Depuis sept ans il n'a cessé de les exciter à cultiver le caféier de Moka "par des moyens qui auraient flatté l'ambition de gens plus zélés à l'exécution des ordres de leur souverain et plus sensibles à la prompte et visible fortune qu'une telle culture pourrait leur procurer que ne sont la plupart des habitants de cette île." Il constatait que le plus grand nombre n'avaient pas livré "une seule livre de café" dans les magasins de la Compagnie. Il qualifiait une telle conduite de "mutine désobéissance" dans une île que "nulle autre du monde de son étendue n'égalerait en richesse si tous les habitants à l'imitation de quelques-uns, s'appliquaient à la faire fleurir par la culture du vrai café originaire de Moka." En conséquence, le Conseil supérieur déclarait "dès maintenant en séquestre toutes les concessions sur lesquellles... au mois de mai prochain... il ne se trouvera pas au moins deux cents caféiers portant fruits ou prêts à rapporter l'année suivante, par tête de noir travaillant" (id., p. 272). Les directeurs de la Compagnie s'impatientent et envoient Pierre Lenoir en mission aux Mascareignes.
Pierre Lenoir, qui sera gouverneur de Pondichéry, arrive avec des instructions qui sont "la récapitulation des ordres donnés depuis 1717" (id. p. 310). Il devait notamment dénombrer les caféiers plantés, chose impossible la quantité étant « considérable » (id. p. 329). En effet, « le caféier est définitivement lancé […] le caféier introduit d'Arabie vient à merveille. Il n'est plus question, en 1726, d'en faire le recensement. » Après des débuts laborieux, « dès 1727 l'exportation dépasse les 100 000 livres » (id. p. 340) Lenoir conclut sa mission en déniant à Desforges-Boucher son rôle dans la promotion de la culture du café. "Ce ne sont pas les sollicitations que M. Desforges dit avoir faites auprès des habitants qui ont multiplié la culture du café, mais bien le seul motif d'intérêt qui les y a engagés." (id. p. 331)
La période du café, avec la mise en œuvre du plan de colonisation de 1717, révèle la nature des relations des "seigneurs de la Compagnie" et de leurs colons et la réalité du régime de l'exclusif. L'obligation de culture avec le double péage lié au monopole des échanges confine les colons dans une situation de dépendance extrême. Les moyens de production et le produit du travail, la terre, les semences, les outils, la main-d'œuvre, les récoltes et les biens de consommation, tout est dans la main de la Compagnie. Et les prix à son agrément. L'argent est en théorie inutile dans cette configuration économique où les colons se pourvoient en marchandises au prorata de leurs récoltes apportées au "magasin du roy". En réalité, les questions de la monnaie et de la pénurie des marchandises sont récurrentes dans la colonie "exploitée" et "abandonnée"…
"Habitants" versus "officiers de la Compagnie" ; "Créoles" versus "Heuropiens" (ou hiropiens)...
Les habitants, "une peuplade, écrit Lougnon, qui ne rappelait que d'assez loin l'Europe" (op.cit. p.17), nouveaux ilotes, exploités par les féodaux de la Compagnie, se définissent comme "créoles" face à "des personnes nouvellement arrivees dans l'isle", qualifiées d'"Hiropiens" ou "Heuropiens". Deux mémoires, qui se répondent et qui et ne portent aucune signature, datés du 9 décembre 1726 et du 9 mars 1727 (AOMN, F3 208 p. 273 et F3 206, f° 19 permettent de juger de leur condition – alors que la culture de café est lancée – par rapport à la pétition de 1678 (supra). Le premier mémoire est adressé à "nos Seigneurs du Conseil des Indes" et le second au "Tres haut et Puissant Prince Monseigneur le Duc de Bourbon".
Les habitants, "informant [le duc de Bourbon] de ce qui regarde le commerce, la culture du caffé qui seroit veritablement dans tres peu de tems la richesse de cette colonie" (tout en le "priant tres humblement de ne point s'arrêter à la difficulté de [leurs] signes"), formulent leurs doléances à propos des "tirannies" exercées par les "gouverneurs, gardes magasins, et autres officiers" (assorties de menace d'exil, de bannissement et de confiscation des biens) et développent, eux qui s'estiment les mieux à même de "rendre cette isle fertille et marchande", une manière d'audit de la colonie et de l'administration coloniale.
- Premier constat : les ressources de la chasse et de la cueillette sont épuisées et l'insécurité qui règne dans l'île (le marronnage) dissuade les habitants de pratiquer l'élevage : "L'isle n'est plus ce qu'elle étoit, les vivres diminuant de jour en jour, n'ayant plus de tortue ny cochon, aussy ce que l'on eleve ne profite point, vu les friponneries qu'il s'y font actuellement par les esclaves".
- Désignés de manière insistante, les "gouverneurs, gardes magasins, et autres officiers" de la compagnie sont les principaux auteurs de l'injustice faite aux créoles et du désordre qui règne dans la colonie. "L'état déplorable ou nous sommes reduits qui est en verité plus a plaindre que celui des forçats des Galeres par les tirannies qui nous sont journellement faites par nos gouverneurs, et gardes magasins, et autres officiers de ladite isle et la crainte dans laquelle ils nous ont tenus, et nous tiennent journellement, nous menaçant de fortes protections dont ils disent être appuyés par Mrs de la Compagnie, et la crainte des exiles dont ils nous menacent, et même qu'ils nous font subir aux moindres representation que nous leur faisons de nos droits, en nous faisant abandonner nos pauvres familles ou en nous envoyant à l'Isle de France, et de nous menacer de bannissement et de confiscation de nos biens [...]".
- L'un des principaux griefs tient dans la contradiction, soulignée par les habitants, qu'ils doivent mettre la colonie en culture et qu'on leur refuse les noirs nécessaires à cette mise en culture ou qu'on les leur vend à des prix "prohibitifs". Les officiers de la Compagnie s'adjugent, de fait, les "noirs de traite", laissant les habitants sans main-d'œuvre :
"Il est impossible que le café puisse reussir tanque que Mrs les gouverneurs, garde magasins et officiers feront ce qu'ils font" "si votre grandeur ne fait pas quelques avances à ceux qui sont dans l'impuissance d'avoir des esclaves". "Nos superieurs [en effet] s'accommodent avec les capitaines de vaisseaux en leur payant les noirs de traite deux cents livres la piece, que lesdits officiers de vaisseaux avaient traités a Madagascar pour leur compte que pour cacher leurs jeux les faisaient vendre audit ancans [...] lesquels dits noirs nous ont eté poussé jusqu'à 300 piastres pour nos officiers, tant qu'il ne leur coutoient que 200 par l'accord qu'ils avoient faits avec les officiers des vaisseaux." "Lorsque les vaisseaux arrivent de traiter des esclaves, on a grand soins de tiré tout ce qu'il y a de meilleur et [...] nous sommes obligé d'avoir tout ce qu'il y a de mauvais." Le prix fixé par M. Lenoir "personne n'en profite que Mrs du Conseil, et leurs associés, et les privilégiés, les pauvres les payant toujours au même prix, n'ayant que les estropiés et le rebus". "Cette derniere traitte les noirs n'ont point esté mis a lanquand. Mais estimé bien chere les pieces deinde, 350 livres les negresses aussy piece deinde 300 livres" (qui valait 150 livres "il y a pas plus de 7 ans") "nous ne pouvons pas nous y sauver a ce prix". "Mais il y en a qui en ont jusque a 60 d'autres 23 et de reste", "on n'a mesme point d'égard pour les plus pauvres" qui en "ont le plus de besoin". "Il y a environ cinq ans que l'on nous avoit fait entendre" que l'on laisserait "les noirs pieces deinde à 200 francs..."
En réalité, les esclaves sont monopolisés par les "féodaux" de la Compagnie : "N'y ayant dans toute la colonie qu'une trentaine d'habitants" "qui soient en pouvoir de faire des fournitures encore la plus grande partie sont forbans qui se sont retiré avec de l'argent dans cette isle"...
- Visés parmi les fauteurs de désordre : les "nouveaux habitants", les nouveaux arrivants dans la colonie, injustement favorisés au détriment des créoles : les "Hiropiens" ou "Heuropiens", ces "forbans", précisément, retirés avec de l'argent dans l'île, qui ne donnent rien à manger aux noirs dont on les dote et qui sont bien incapables d'aller à la recherche des marrons...
Incipit du mémoire du 9 décembre 1726
"Nous avons eu le chagrin de voir par cette derniere traitte que lon a donné des noirs a des personnes nouvellement arrivees dans l'isle aussy de la terre que lon a refusé a plus de douze de nous. On a mesme donné des noirs a des personnes qui doivent plus de 3000 livres preferablement a ceux qu'il y a plus de 40 ans qui portent le pois du pays, mesme qui ont voulu payer comptems" ; "nous demandons pour qu'oy on nen ous fait pas la mesme chose, estant ceux qui ont toutes les peines"... On leur donne des esclaves et ils ne sont pas en capacité d'assurer leur subsistance "et pour ce faire les pauvres esclaves sont obligés de voller tout ce qu'ils trouvent mesme d'aller dans les bois, et puis on nous oblige d'alller [les] chercher à nos propres depand..." "C'est nous qui avons toutes les peines sans pouvoir nous flater d'avoir eu la moindre reconnaissance, au contraire. S'il y a quelque avance a faire on le fait a des gens qui arrivent dans l'isle. Cela est si visible que" l'on nous a tirré nos terres "pour favoriser leur établissement".
- Enfin, l'accaparement des marchandises envoyées par la Compagnie par les officiers et les "continuels trafics des Mrs du Conseil Supérieur" font aussi l'objet de critiques et de dénonciations. "Nous passons de la traitte des noirs à celle des marchandises que la compagnie envoye icy pour l'utilité des habitants, "les gardes magasins, les officiers ont choisi le plus beau et le meilleur pour eux afin de le vendre à des prix excessifs" ; "le choix de ces messieurs, leurs privilégiés ensuite", ces derniers ayant "en appprence permission de trafiquer"... "Aussy lon nous vend toutes les marchandises a haut prix" et l'on achète "les nostres a bas prix".
L'"ingratitude" de la Compagnie envers ceux qui ont "porté le poids du pays" et "conservé l'île" pour ses intérêts est criante :
"Nous avons eu grand soin de conserver l'isle tant pour vos interêts que pour la surete de ceux qui y sont"
"ceux qu'il y a plus de 40 ans qui portent le pois du pays"...
Nous avons "peine de voir que l'on n'ait point fait aucune gratification à Antoine Martin et Hyacinthe Martin son frère, des peines et soins qu'ils ont pris a cultiver les premiers arbres de caffé que l'on ait pointé dans l'isle" "et si on voit que aujourd'hui on est en estat de faire grosse fourniture c'est a eux à qui nous sommes redevables" "loin de les favoriser en aucune chose on leur a encore refusé des noirs a cette derniere traitte pour leur argent".
"Depuis 20 et 25 ans que nous sommes dans une colonie à cultiver une habitation qui nous a été donnée de la part de la compagnie que nous justifions par des contrats ... [les officiers de la Compagie] ne les trouvent pas solvables, et nous les dechirent en plain conseil ... nous traittant de Paresseux, et de Mutins...nous envoyant dans des quartiers qui n'est ny habité, ny habitable."
Au lieu de prendre en considération ce qui est dû aux habitants, "sans examiner toutes ces choses on a soin de nous dire de dures paroles mesme, mesme de nous reprocher avec mepris nostre pauverté il est cuidant que nous serons toujours réduits à ce point tant que l'on ne voudera pas nous aider. Malgré cela nous n'avons pas de cesse que de recueillir cette année cent milier de caffe." "Il est impossible que le café puisse reussir tanque que Mrs les gouverneurs, garde magasins et officiers feront ce qu'ils font" "si votre grandeur ne fait pas quelques avances à ceux qui sont dans l'impuissance d'avoir des esclaves"... Il faut aider les premiers habitants afin de "rendre cette isle fertile et marchande..."
Le Conseil de Bourbon dans une lettre du 9 juin 1731 fait état d'"assemblées illicites tenues par les habitants de l'Isle Bourbon, sans aucune autorité ni aveu, sous prétexte d'aller en France porter des plaintes contre la Compagnie" (Correspondance, T I, p. 133) et se défend, dans une lettre du 20 décembre 1731, de l'accusation de favoritisme : "Vous dites, Mrs, est-il répliqué aux directeurs de la Compagnie, que nous ne paroissons pas favorables aux petits habitants. Telle n'a jamais été notre idée : mais sans les priver des avances que vous voulés bien leur faire, et de tous les secours dont ils ont besoin, nous avons cru que, sans blesser la justice, on pouvoit mettre une différence entre le maître et le valet, et un officier et un soldat. Un soldat, un matelot, reste malade d'un vaisseau de la Compagnie : il se rend habitant, luy fairons-nous les mêmes avances, en noirs et autres effets, que nous faisons à des personnes dans un certain rang qui, pour pousser une habitation, avant et outre les crédit que la Compagnie leur a fait, ont fournys des avances considérables de leur propre bien ? Tels sont plusieurs de nous, tels sont Mrs de la Farelle, Justamont et plusieurs autres. Cinq ou six habitants de ce calibre valent mieux, pour la Compagnie et la colonie, qu'un centaine des autres. De quelle utilité peut être pour la Compagnie, et pour la colonie, des habitations qui à peine pourront nourrir leur maître ?" (Correspondance. t I, p. 146-147)
Dans une lettre adressée à "Mrs les sindics et directeurs de la Compagnie des Indes", datée du 4 novembre 1754, Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, gouverneur de l'île de France, rappelle les termes de la doctrine coloniale : il y a la Compagnie et ses officiers d'un côté et les habitants, noirs et blancs plus ou moins confondus dans une même "créolité", de l'autre. "La letttre de la Compagnie du 1er mars dit, à l'occasion des mariages des employés, que 'par le terme de créoles, elle n'entend que les filles méticés provenant d'un sang noir meslé avec le blanc, et non les filles nées de blancs et de blanches.' Cette règle peut suffir pour l'isle de France d'icy à quelque temps, mais quant à l'isle Bourbon, il semble que la Compagnie a donné jusqu'à présent plus d'extension au terme de créole, et qu'elle a craint non seulement que ces alliances n'empêchassent de porter respect à ses employés, mais encore qu'elles ne fussent un obstacle aux affaires". S'il arrive qu'une affaire, en effet, concernant les familles "dans lesquelles les employés de plume et d'épée qui sont établis se sont alliés" "doive estre portée au Conseil", "on peut penser que les conseillers établis dans l'isle seront plus portés pour l'habitant que pour la Compagnie". De fait, "la Compagnie a défendu plusieurs fois [...] de donner entrée au Conseil à aucun habitant". Ainsi le sieur Dehaume, qui "s'est toujours conduit avec sagesse et capacité", "n'a contre luy que d'estre marié avec une créolle" (Archives d'Outre-Mer d'Aix-en-Provence, cotes C4 8 et C4 9). Inégalité des hommes et régime de l'exclusif sont en effet constitutifs de la féodalité coloniale.
Sans doute, plus on charge un vassal moins il a d'ardeur et le système d'exploitation des colons pourrait-il être moins implacable et donc plus productif, mais son "injustice" est de droit. L'appréciation des habitants de Bourbon, savoir que "la richesse de la colonie serait certaine" si "l'on ot[ait] l'hautorité aux gouverneurs et officiers de posséder aucune concession dans la colonie parce que autrement il ne seroit pas nécessaire qu'il y eut d'autres habitans qu'eux, car ils posséderaient bientôt toutes les concessions de ladite isle", au style près, vise une réalité. Desforges-Boucher s'est vu ainsi concéder un terrain entre la Ravine de l'Étang du Gol et la Ravine des Cafres. Pierre Benoist-Dumas, Directeur Général du commerce de la Compagnie des Indes se taille en un an un patrimoine évalué à 885 hectares. "En 1731, écrit Mas, les quatre plus forts producteurs de café de l'île sont Justamont et Dioré, anciens gouverneurs, Dumas, gouverneur et Feydau-Dumegnil, membre du Conseil Supérieur" (op. cit. p. 36) (voir : Les biens de P.B. Dumas à l'île Bourbon" dans Recueil... VII, p. 111) Dumas plante 45 000 caféiers à Sainte-Suzanne et il en possède 30 000 à Saint-Paul, Dioré 40 000... Il faut ajouter qu'au début du peuplement, "on concéda avec libéralité et sans précaution... le vice de contrats dont il résultait le plus grand inconvénient venait de l'immensité des terrains données à chaque habitant" (témoignage de 1785 de Davelu, cité par Mas, op. cit. p. 163). Mas donne des exemples : Jacques Auber et Gilles Dennemont à qui l'on concède environ 5000 hectares (comprenant ravines et sommets), Samson Lebeau 1.500 (id. p. 164). En 1710, le Mémoire d'Antoine Boucher constatait : '"il est des habitants qui ont cent fois plus de terrain qu'ils n'en peuvent cultiver" (Recueil Trimestriel, T. V).
Mise en œuvre impolitique et prodigue, sans doute, des biens que constituent la terre et les colons, mais parfaitement articulée dans son intention, comme l'exprime une lettre du 10 octobre 1725 des directeurs de la Compagnie au Conseil supérieur de Bourbon (dans laquelle la Compagnie se plaint du peu de succès du café : "Elle est lasse de vous entendre luy promettre, depuis quatre ans, une ample récolte de café [...] et de se voir au bout de ce terme aussi peu avancée que le premier jour"): "Vous ne devez avoir que deux choses en vue, et ce sont deux points capitaux : la première, c'est la fructification intérieure de l'isle à laquelle vous devez vous appliquer uniquement ; la seconde c'est de rendre l'habitant toujours débiteur à la Compagnie. Par ce second point vous viendrez à bout aisément du premier parce que l'habitant redoublera ses soins et son travail pour s'acquitter, et vous fournira des fruits de sa terre" (Correspondance... 1724-1731, p. 6-7, nous soulignons). L'exploitation de l'île repose sur le "travail forcé" d'habitants endettés, astreints à rembourser la Compagnie avec le café qu'ils produisent à des prix fixés par elle. "L'habitant qui n'aura pas d'argent pour payer le montant de son adjudication, et auquel on fera crédit, ne pourra s'acquitter qu'en denrées du cru de la terre, et payera pour lors en caffé" (id. p. 19). En effet, la majorité des habitants, sans moyens, deviennent nécessairement les débiteurs de la Compagnie. Dans une lettre du 20 octobre 1731, le Conseil supérieur de Bourbon diagnostique : "Ils sont prêque tous très gueux, que les plus riches en argent comptant ne possèdent pas 4 ou 5 m. écus, qu'il n'y en a pas six dans toute l'isle qui soit dans ce cas, ny vingt dont la richesse aille à mille écus d'argent comptant" (Correspondance 1724-1731, p. 142-143). Une lettre du 1er avril 1732 précise que seuls "les vieux habitants, gens qui ayant eu des esclaves depuis lontems, et un nombre suffisant, ont mis leurs habitations en valeur, planté des caffés des premiers, et ne se sont pas par conséquent endettés avec la Compagnie, mais au contraire devenus ses créanciers... c'est pour ceux-là qu'il faut annuellement de l'argent et quelques marchandises pour payer les caffés et denrées" (id. 1732-1736, p. 145). La même lettre ajoute, qu'à l'inverse, ceux qui sont établis récemment "qui ont acheptés des noirs de 2 à 3 cents piastres, et tout ce qui leur a été nécessaire pour pousser leur habitation, qui leur a bien plus couté dans ces derniers tems que cela ne coûtoit autres fois. Ces gens... s'y sont fourrés jusqu'au col et doivent considérablement" (id. 1732-1736, p. 2, nous soulignons). En effet, sans compter les "avances indispensables, pendant les quatre premières années", il ne faut "[pas] moins de 12 Noirs" pour faire fructifier une habitation – en 1732 plus de trois cents habitations "ne [faisant] que commancer" (id. p. 4). Les douze Noirs en cause sont supposer coûter 24 fusils de traite à la Compagnie qui les revend 4 000 livres à l'habitant. Quand la crise du café se déclare, "6 % des producteurs de l'île [...] fournissent 47,8 % de la production totale, et emploient 1 163 esclaves (moyenne supérieure à 58 esclaves par habitation)" (C. Mazet, "L'Ile Bourbon en 1735..." p. 33). Dans la première opération de traite organisée de Paris et confiée au Courrier de Bourbon commandé par le capitaine Antoine Dufour, en 1717 et 1718, le point n° 10 des "Instructions et ordres" (document A) de la Compagnie précise : il "fera son possible pour avoir trois Noirs, jeunes et bien faits, pour deux fusils, ou au moins trois Négresses s'il ne peut en avoir deux pour chaque fusil, ou un Noir pour un pistolet." (Recueil trimestriel de documents et travaux inédits pour servir à l'histoire des Mascareignes françaises, 1932-1933-1934, Saint-Denis, p. 385)
"Une société de servitude" (Mas, 1989, p. 109)
Les premiers Bourbonnais sont, ainsi qu'il ressort de plusieurs articles de l'ordonnance de Jacob de la Haye, des engagés rétribués par "gages et sallaires".
Art. 12. - "Que personne n'ira à la chasse...""Six mois de service sans gages ni salaire pour la première fois et en cas de récidive à peine de vie" à défaut de paiment d'une amende de vingt écus.
Art. 21. - "Que tous ceux qui ont déserté et fait les quivis dans la montagne, seront exclus et privés de toute récompense , sallaires et payement, et leurs biens confisqués au roy."
Art 25. - "Deffense [aux chasseurs] de trafiquer, commercer, vendre ni porter de gibier ailleurs qu'aux magasins" [...] sur peine [...] de rester dans l'isle deux ans à leurs dépens, sans aucun gage ni sallaire, et, en cas de récidive, d'être pendus et étranglés."
Leur sort, l'île étant inexploitée, n'est pas celui des engagés des Antilles, où il y a des plantations et des "maîtres" (et où "les maistres [font] beaucoup moins de cas d'un engagé que d'un noir esclave, et se mettent bien moins en peine de la mort d'un engagé que de celle d'un esclave parce qu'ils perdent plus à l'un qu'à l'autre" - l'intendant Robert, en 1698, cité par Debien, p. 206-207 ; voir : Madagascar : l'“Originaire”, l'“Engagé” et l'“Habitant”). Les hommes de Fort-Dauphin, sous Pronis, eux, "trouvaient bien étrange de faire en ce pays la fonction de portefaix et d'esclaves, [alors qu']ils voyaient beaucoup de Nègres dans l'habitation que l'on ne faisait point travailler" (Flacourt, Histoire..., p. 269). Ces engagés deviennent, de fait, des colons et leur propos est le plus souvent d'établissement. Ils sont attributaires de terres sous condition de mise en culture et sous peine de retrait. Ils apportent avec eux l'idéal de propriété et de transmission familiale, expression de l'unité domestique gérée par le mari, l'épouse et leurs enfants, propre aux sociétés paysannes d'Europe. Un document portant concession, daté du 20 janvier 1690 et signé du gouverneur Vauboulon, résume cet idéal : "Anathase Touchard, écrit Vauboulon, nous remontre que depuis vingt ans qu'il est dans cete ile, il a toujours travaillé avec le chagrin de savoir que la terre qu'il cultivait n'était pas à lui, et que selon le caprice de ceux qui ont commandé jusques à présent, il fallait qu'il fut toujours prêt à la quitter avec l'inquiétude qu'après sa mort, il ne pourrait rien laisser à sa femme et à ses enfants, ce qui rendait sa condition aussi malhereuse que celle des esclaves qui n'ont rien en propre, et qui ne peuvent rien acquérir [...] Il a recours à notre justice et autorité et nous demande la propriété et fonds de la moitié de l'habitation où il demeure..." (cité par Mas, 1971, annexe n° 3).
Avec la crise du café, dès 1736, la situation des habitants se dégrade en conséquence et la plupart s'avèrent incapables de rembourser les emprunts. "Nous sommes accablés de dettes immenses. Les unes sont vos bienfaits, et le titre que notre reconnaissance leur défère ne recevra jamais la moindre altération ; mais ces grâces ont trop tôt cessé et le changement nous a forcé d'en contracter de nouvelles… nous avons eu recours à des particuliers qui moins touché du bien public que de leurs intérêts, nous ont rendu la victime de leur soif pour les richesses. Malheureuse nécessité qui subsiste depuis 1735…et qui nous a conduits jusqu'à la plus affreuse pauvreté… Loin de pouvoir liquider nos dettes, nous serions dans vingt ans plus obérés qu'aujourd'hui"
"Supplique des colons de Bourbon à propos du prix de leurs cafés en décembre 1746" (Recueil trimestriel... janvier-mars 1938, p. 176) (voir la lettre des Dr de la Cie du 30 mars 1746, Correspondance, tome 4, p. 247). Au moment de la reprise de Bourbon, les 8/10° des habitants sont endettés vis à vis de la Compagnie (dvper)
[On peut laisser la conclusion de ce développement à Adam Smith : "Quelques nations ont abandonné tout le commerce de leurs colonies à une compagnie exclusive, obligeant les colons à lui acheter toutes les marchandises d'Europe dont ils pouvaient avoir besoin, et à lui vendre la totalité de leur produit surabondant. L'intérêt de la compagnie a donc été non-seulement de vendre les unes le plus cher possible, et d'acheter l'autre au plus bas possible, mais encore de n'acheter de celui-ci, même à ce bas prix, que la quantité seulement dont elle pouvait espérer de disposer en Europe à un très-haut prix : son intérêt a été non-seulement de dégrader, dans tous les, cas, la valeur du produit surabondant des colons, mais encore, dans la plupart des circonstances, de décourager l'accroissement de cette quantité, et de la tenir au-dessous de son état naturel. De tous les expédients dont on puisse s'aviser pour comprimer les progrès de la croissance naturelle d'une nouvelle colonie, le plus efficace, sans aucun doute, c'est celui d'une compagnie exclusive. (p. 316-317 de la traduction de Garnier de 1881, tome III, 1802, nous soulignons).]
La question du statut juridique de la terre…
Selon Schérer, cité par Mas, il y a, en 1731, 800 concessions (y compris les emplacements) pour 1 716 habitants et 4 494 esclaves (id. p. 26) Le recensement de 1735, en complément de celui de 1731 qui avait pour objet de connaître "la situation des habitations et des progrès qu'elles pourront faire pour la suite" et de mettre en place l'assiette d'imposition, "pour constater la redevance en onces de café par arpent de terre" dresse un état assez fidèle de la société bourbonnaise d'alors. Il permet notamment de constater que la configuration des concessions dévolues aux premiers habitants a évolué du fait de successions, mariages, échanges ou cessions. Plus de 53 000 hectares ont été attribués "en propriété roturière" à 430 habitants (pouvant être attributaires de plusieurs concessions), mais le taux de terres "en rapport" n'excède pas 10 % du total (Mazet, 1989, p. 27). Parmi les empêchements à une exploitation rationnelle des terres, régulièrement incriminée, la division liée aux partages successoraux en application de la Coutume de Paris, qui impose une division égalitaire en nature entre les héritiers.
La Coutume de Paris
"Ceux qui ont la direction de cette île [Madagascar], écrit Vincent de Paul au missionnaire Nacquart, en partance pour Fort-Dauphin, sont des marchands de Paris, qui sont comme les rois du pays" (cité par Galibert 2007, p. 172). La formule juridique de cette "quasi royauté" s'exprime dans une charte qui garantit des droits féodaux sur les pays occupés. Ce régime est celui de la Coutume de Paris, dite nouvelle Coutume, élaborée à partir de l'ancienne Coutume en 1580. L'application de la Coutume de Paris aux colonies remonte à la colonisation de la Nouvelle France et fut généralisée aux compagnies à charte. C'est un ensemble de lois féodales garantissant un ordre social fondé une hiérarchie des personnes (seigneurs et vassaux) et des biens (fiefs et censives). En 1664, en vertu de l'édit royal créant la Compagnie des Indes Occidentales, la coutume de Paris devient la loi de la colonie. A l'origine recueil de préceptes et de maximes juridiques appliqués circa parisius, la Coutume de Paris exprime un ensemble de valeurs fondé sur le fief et la famille et où la possession de la terre est le fondement de la hiérarchie politique et sociale. La règle de transmission successorale (en cause à La Réunion) concernait les biens roturiers, les successions nobles favorisant l'aîné mâle. En provoquant le morcellement des patrimoines familiaux roturiers – en neutralisant juridiquement leur capacité d'extension – et en consacrant l'unicité juridique du fief, la Coutume de Paris exerçait une fonction politique. D'autres dispositions existaient dans le droit féodal (la substitution, le droit de retrait, le droit de franc fief) qui permettaient de renforcer le caractère héréditaire de la puissance foncière de la noblesse en faisant obstacle à la division et à la cession des domaines. (Tout système de lois a un "législateur sociologique" et celui de la Coutume de Paris est bien celui du droit féodal.) Considérées comme des entraves à la liberté des échanges et un déni de l'égalité civile, ces prérogatives seront supprimées par le Code Napoléon.
L'application stricte de l'égalité de partage à La Réunion signe donc l'appartenance féodale de la colonie et réaffirme le caractère roturier de la propriété, mais comporte, dans un environnement de forte natalité, des conséquences économiques et sociales inéluctables. Barassin fait état, pour la population d'origine européenne, d'un taux de natalité de 57 pour mille sur la période allant de 1705 à 1712. Les familles ont en moyenne 8 ou 9 enfants et le taux de mortalité à Bourbon est inférieur à celui de la France (Barassin, La vie quotidienne... p. 159 et s.) A propos du partage en nature imposé par la Coutume de Paris, le curé Davelu note, en 1750, que les concessions d'origine ont été émiettées en "si petit terrains qu'ils deviennent nuisibles à la culture" (cité par Mas, p. 9). "Depuis longtemps la plupart des terrains concédés n'appartiennent plus en entier à leurs concessionnaires ni à leurs descendants ou ayants cause. Il ont été morcellés par des ventes entre les enfants, petits enfants et même arrières petits enfants des concessionnaires. [...] Il s'en est suivi de ces subdivisions qu'il existe aujourd'hui peu d'habitants qui ont de grandes propriétés et qu'il y en a au contraire un très grand nombre qui n'ont que de très petits morceaux de terre et quelques uns point du tout" (id. p. 185). A cette mécanique du partage se superpose un mode de division en lanières dont la justification est le souci de répartition égalitaire des différentes qualités de sol (Mas p. 186). "Les habitants de cette ile tiennent beaucoup à déviser leurs terrains par la base à aller au sommet n'eussent-ils à cette base que quelques pieds. L'inégalité de la valeur du sol l'avantage et la proximité, et plusieurs considérations rendent le partage des terres très difficile à faire avec exactitude en ne suivant point la méthode de prendre du bord de la mer au sommet [...]" (Davelu, Lettre à Chanvalon, citée par Mas, p. 185). Mais ces "subdivisions ont produit des rubans fort étroits sur une longueur immense cela a multiplié le travail du cultivateur sans aucun profit" (Davelu, cité par Mas, p. 9). Un arrêt du Conseil supérieur de la Cie du 20 mai 1761 consacre cet usage du partage en lanières et rejette le "partage par carreaux" : Le Conseil ordonne la "division par experts en lignes droites du haut en bas de tous les terrains."
[C'est l'opposition entre patrimoine et propriété... Balzac dans Le Curé de village (in La Comédie humaine, tome IX, Paris, éditions de la Pléïade, 12 vol. , 1976-1981, p. 817), vilipende ce nouveau droit : "la cause du mal gît dans le Titre du Code civil, qui ordonne le partage égal des biens. Là est le pilon dont le jeu perpétuel émiette le territoire, individualise les fortunes en leur ôtant une stabilité nécessaire, et qui décomposant sans recomposer jamais, finira pas tuer la France".]
Dès 1732, le Conseil Supérieur alertait la Compagnie sur le problème du démembrement des habitations : "Il n'est plus possible pour l'habitant de pallier par quelque concession à la modicité de son patrimoine", "ce mal qui vient de l'abus de morceler ne commence encore qu'à se montrer... Mai sy on continuait il est aisé de concevoir que la terre deviendrait inutile à l'habitant et l'habitant à charge à l'ile... le remède à cet abus qui peut être la source de tant de maux serait que la Compagnie décide jusqu'à quelle quantité elle veut que l'on démembre les terres et au-dessous de quelle portion ces divisions ne seraient plus permises. Dans ce cas l'aîné de la famille obtiendrait pour lui seul cette portion qu'il serait deffendu de morceller en dédommageant par lui ses cohéritiers..." (AN Colonies...) (Mas, p. 190). La réponse de la Compagnie, le 17 novembre 1732, est sans appel : "Cet expédient n'est praticable en aucune manière et serait absolument contraire à la coutume de Paris". Quand le Conseil supérieur duplique : "Les coutumes ont été établies pour l'avantage et l'utilité des pays où elles passent en force de loi et non pour en causer la ruine" (lettre du 12 décembre 1733), la Compagnie tranche, sans égard aux conséquences économiques et sociales : "Quelque inconvénient que le Conseil trouve aux divisions des biens patrimoniaux elles sont de droit et doivent être autorisées. L'intention du Roi a toujours été que l'administration et la justice dans toutes les colonies dont le partage fait une partie essentielle fut réglée par la Coutume de Paris." (Corresp. II, 214-15) La Compagnie recommande alors l'émigration des "sans-terre" à l'Ile de France. (12 janvier 1737, Corresp. III, p. 74) Au début du XIXe siècle, le botaniste Joseph Hubert explique : "La pauvreté dans cette colonie a pour cause radicale l'accroissement de la population et la division et la subdivision des terres... une émigration volontaire serait sans doute un moyen efficace..." (Mémoire à M. Millius). En 1848, 70 % des propriétés avaient moins de 5 hectares contre seulement 26 % en 1778 (Schérer p. 60) qui constate qu'à la fin du XIXe siècle "quoi qu'il y eût plus du double de la surface actuelle cultivée en canne, les indigents formaient les deux tiers de la population blanche". Crise du café, endettement, partages successoraux, concentration des terres liée à l'appauvrissement des habitations et à la mise en culture de l'île en canne à sucre, la paupérisation des créoles qui ont "porté le poids du pays" et "conservé l'île" est continue et irréversible.
Les "petits créoles"
Les Notices statistiques sur les colonies françaises parlent pour la première fois de "petits blancs" : "les blancs peu aisés, connus dans la colonie sous le nom de petits créoles ou de petits blancs, à qui l'exercice de quelque industrie assurerait de quoi vivre, ont de l'éloignement pour le travail manuel" (1838, seconde partie, p. 100).
Yves Pérotin, "Le prolétariat blanc à Bourbon avant l'émancipation des esclaves", (Recueil...)
"Le mot prolétaire que j'emploie également à la suite des auteurs du temps de Louis-Philippe, ne doit pas évoquer ici les prolétariats industriels, mais signifier prolétariat rural, on pourrait même dire "forestier" ; il faudrait d'ailleurs dire sous-prolétariat, Lumpenproletariat, asocial et sans conscience de classe." (196)
"Les colons arrivés d'Europe sont souvent des gens misérables par leur extraction." (196)
Recensement de 1735 : 29 de ces "miséreux" (= "créoles vivant dans un foyer sans esclave ou servi par un ou deux esclaves seulement, signe presque certain de dénuement") sur un total de 1716 blancs. (197). Selon le recensement de 1779, cette proportion a décuplé : "on compte 1 131 de ces pauvres créoles sur 6 464 blancs, et sur ces 1 131, 509, soit presque la moitié vivent dans des familles sans esclaves, signe de misère certaine." (197)
Une lettre du 2 janvier 1776 du Conseil supérieur de Bourbon note : "L'île Bourbon a trois classes d'habitants : la première [composée] de dix pères de familles pouvant passer pour riches, dont la moitié compte huit, dix et même quinze enfants ; la seconde, des gens dans la médiocrité ; la troisième, composée d'une multitude de créoles qui n'ont qu'un ou deux esclaves et le quadruple d'enfants." (198)
Betting de Lancastel,
puis de Thomas, Essai de statistique de l'île Bourbon, 1828, 2 vol.
Ces blancs sont les descendants des premiers habitants "à la différence des blancs riches dont l'ascendance est remplie d'apports métropolitains" (204)
Dans les Notices statistiques sur les colonies françaises de 1838 : les indigents représentent les deux tiers de la population blanche.
Rapport de la commission chargée d'examiner les questions contenues dans le mémoire de M. Dureau aîné sur le manque de bras nécessaire à l'agriculture... signé de Gibert des Molières :
Problème à résoudre : "la diminution progressive du nombre des cultivateurs [esclaves] en présence d'une population libre, valide, nécessiteuse, qui s'accroît sans cesse et croupit dans la plus dégoûtante et la plus funeste oisiveté."
Le colonat
discussion :
"En 1950, l'Inspection du Travail estimait, après sondage, qu'un tiers du sol était cultivé en colonage, les deux tiers en faire-valoir direct. Il y aurait eu à cette époque 15 000 colons." (DR p. 215) "Quelques colons apparaissent après l'émancipation des esclaves en 1848, surtout pour la culture du maïs. Puis le mouvement s'étend et de généralise après 1881, lorsque l'immigration se meurt lentement." (id.)
"Nos enquêtes personnelles nous ont montré que les grands domaines à la mode ancienne sont de véritables seigneuries rurales. A Saint-Gilles les Hauts, de Villèle règne sur 400 colons et leurs familles, soit 2 500 sujets au bas mot, pour 1 600 hectares dont beaucoup sont incultes. Au Tampon, un domaine "à monter" (Avril) utiise 200 colons pour 190 000 gaulettes, 100 bœufs, 4 000 tonnes de cannes, 500 à 1 000 kilos de géranium. Un autre grand domaine voisin (Isautier) possède 211 colons, dont les 211 parcelles totalisent 1 649 ha." (DR p. 217)
En instaurant une "société de servitude", sans classe intermédiaire et sans mobilité, où les "Seigneurs de la Compagnie" sont d'une autre nature que les "sujets", la Compagnie des Indes a fondamentalement marqué, non seulement les premiers temps, mais l'histoire de la colonie. Une disposition réglementaire qui date du début de cette année 2011 suffira ici à marquer les effets à long terme de la structure socio-économique constitutive de la colonie. Il concerne la fin de l'existence légale du colonat partiaire, typique de cette relation inégalitaire entre "maîtres" et "sujets" et considérée comme un héritage de l'époque coloniale. En 1971, le nombre des colons réunionnais est évalué à 15 000 par Mas. En 2007, le bail à colonat concernait encore 1 233 hectares et 386 agriculteurs. La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche votée le 27 juillet 2010 entrant en application, les baux à colonat partiaire en cours sont donc automatiquement convertis en baux à ferme pour une durée identique à celle du contrat de colonat. Depuis le vote de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, la conclusion de nouveaux baux à colonat partiaire n'était plus possible. La préfecture de La Réunion a commenté cette application en ces termes : "La mise en place automatique des nouveaux fermages tourne une page de l’histoire agricole de la Réunion et inscrit les relations locataires – propriétaires dans le cadre général" ; elle précise que "dans l’attente de nouveaux contrats de bail à ferme écrits, "ces fermages sont réputés être de nature verbale" et qu'"il est vivement recommandé d'engager au plus tôt la signature d'un bail à ferme écrit pour établir une relation contractuelle claire et sereine entre les deux parties". Le compte rendu des débats du Sénat dans sa séance du 9 novembre 2005 permet de prendre connaissance du jugement d'une sénatrice de La Réunion sur cette évolution juridique : "Je voudrais tout d'abord dire combien je me réjouis, avec l'ensemble de la profession agricole de la Réunion, de la disparition progressive du colonat partiaire dans les départements d'outre-mer. Ce dispositif archaïque, qui n'avantageait pas le preneur et ne l'incitait pas à augmenter ses rendements, était une survivance de l'esclavage et de l'engagisme, que Victor Schoelcher avait combattu et qualifié d''esclavage déguisé'. C'est donc le dernier bastion de l'esclavage qui vient de tomber."
Dans l'économie féodale, la terre et les hommes qui l'exploitent forment un tout indivisible, un fief. Le caractère féodal de cette économie se marque par son recours à la prestation en nature et par la dépendance. A des degrés divers, ces formes de travail que sont l'engagisme, pour partie, ou le colonat partiaire se coulent dans cette forme juridique, elles ont en commun rémunération en nature et dépendance physique qui font apparaître, par contraste, la liberté, au moins théorique, associée au salariat ou au fermage. L'argent délie la relation duelle de patronage et permet d'entrer virtuellement dans le monde abstrait d'échanges impersonnels. L'émergence du colonat partiaire est historiquement liée au phénomène de paupérisation des "petits créoles" (conséquence, on l'a rappelé, de la mécanique des partages successoraux, de l'endettement, de la crise du café et du développement de l'économie sucrière). Ceux-ci vont cultiver, dans les Hauts, des terres ingrates et inexploitées que le propriétaire préserve ainsi de l'usucapion. Le colonat se développe ensuite en réponse à la crise alimentaire provoquée par le passage de l'économie servile à l'engagisme. En 1862, 63 % des terres cultivées sont occupées par la canne. Alors que la main-d'œuvre servile assurait la production des vivres sur des terres spécialement affectées (les Notices statistiques sur les colonies françaises, publiées en 1838, précisent que sur les 65 702 hectares de terres cultivées, 14 530 le sont en canne et 23 587 en maïs et qu'aux 32 242 porcs répertoriés il faut ajouter "environ 70 000 [animaux de cette espèce] appartenant aux esclaves" - seconde partie, p. 79 et p. 80 note 1), la monoculture et le recours massif à l'immigration indienne provoquent une crise alimentaire que les propriétaires tentent de résoudre par le faire-valoir en colonat de cultures vivrières. Enfin, la cessation de l'immigration indienne contraint les gros planteurs à mettre en place, un nouveau type d'exploitation de la main-d'œuvre, cette fois, pour produire la canne destinée à alimenter les usines. La corvée...
Bien que ce mode de faire-valoir soit associé à l'image du petit exploitant des Hauts, il exprime en réalité une relation d'inégalité constitutive de la société coloniale. S'agissant de la misère sociale, anachronique, de ce statut, "dernier bastion de l'esclavage", on pense immédiatement à l'ouvrage de James Agee sur les métayers du coton en Alabama (enquête menée en 1936), ou encore à l'engagement de l'auteur de La misère du monde, petit-fils et fils de métayer (Sud-Ouest du 30 juillet 2011), dont la sociologie a réduit la diversité des objets scientifiques à l'opposition dominant/dominé. Toucher le public parisien en mettant la misère du Tiers monde sous ses yeux, c'est aussi le propos des Leblond dans leur conférence "La Réunion et Paris", publiée en 1930 quand ils plaident la cause de ceux envers qui ils sentent "un profond respect très affectueux", "ces représentants de la première Colonisation" (Les Îles sœurs, p. 169), les petits blancs. "L'autre jour, rapportent-ils, nous faisions le tour de l'île, nous suivions la route de St-Benoit à St-Joseph, les yeux éblouis de la beauté des panoramas, et cependant les cœurs tristes. C'est que cette route est jalonnée de misères ; près des vacois dépenaillés s'effilochent dans des maisons éclopées de pauvres familles dont des carnations européennes se sont flétries, jaunies jusqu'aux tons de la vavangue (fruit de la Réunion). Nous nous sommes alors juré de faire tout ce que nous pourrions pour tirer de la croupissante désolation cette race attendrissante qui vit dans des paillottes aussi misérables que celles des indigènes du Sud de Madagascar, dans des cases dont le parquet est de boue, ne buvant que de l'eau de pluie, ne vivant que de ce que rapporte la confection des sacs [de vacoa], éteints par la résignation et par la fièvre dans les petites cases silencieuses embaumées de bégonias et des héliotropes comme des tombeaux. Aidez-nous, Mesdames et Messieurs, pour que nous arrivions à accomplir l'œuvre de régénération avant que trop d'enfants ne meurent ! Soyons forts, unissons-nous, associons nos bonnes volontés, développons une activité à la fois commerciale et intellectuelle qui permette aux voyageurs de trouver dans notre Ile, le reflet du grand foyer parisien" (43).
James Agee, Walker Evans, Let Us Now Praise Famous Men,
with an Introduction by Blake Morrison,
Penguin Books, 2006.
(Traduction française, Louons maintenant les grands hommes, Plon, coll. Terre humaine, 2002.)
'Description' est un mot dont je me méfie.
(p. 237)
"Gudger ? Un assez bon métayer [a fair farmer]. Il s'y connaît en coton [a fair cotton farmer], mais pas un grain d'atome de bon sens.
Tous ces gens-là n'ont rien dans la tête, aucune initiative. Sinon, ils n'en seraient pas à gagner leur vie avec leur part de la récolte [on shares]." (p. 92)
"Gudger n'a pas de maison qui lui appartienne, par de terre, pas de mule ; ni aucun des moyens de culture d'une certaine importance. Toutes ces choses, il doit les obtenir de son propriétaire. Pour sa part du blé et du coton, Boles lui consent des avances d'argent, quatre mois dans l'année, de mars à juin. C'est 'l'argent des vivres'. Il emprunte aussi à Boles pour les engrais.
Gudger le rembourse avec son travail et celui de sa famille" (p. 126).
"Woods et Ricketts ne possèdent ni maison ni terre, mais Woods possède un mulet et Ricketts deux mulets, et tous deux sont propriétaires du matériel indispensable à leur culture [...] Ils ne remettent au propriétaire qu'un tiers de leur coton et qu'un quart de leur blé. Sur leur propre part de récolte néanmoins, ils ont à lui verser les deux tiers des dépenses en engrais pour le coton, et les trois quarts des engrais pour le blé; plus l'intérêt ; et en plus de l'intérêt, les avances sur 'l'argent des vivres'.
Woods et Rickett font figure de cultivateurs à bail [tenants] ; l'accord passé avec le propriétaire est dit du tiers et du quart" (p. 126).
"Durant six à sept mois chaque année – donc pendant le temps exact où leur travail cotonnier est d'une nécessité absolue au propriétaire –, ils peuvent être sûrs de subsister grâce aux avances sur l'argent des vivres et à l'argent des pousses de coton. Durant cinq à six mois de l'année [...] ils ne peuvent compter sur rien, et la dernière aide sur laquelle ils pourraient compter est bien celle de leurs propriétaires" (p. 126-127).
[Le terme dialectal est "sharecropper". Le terme usuel est "tenant". (p. 434)]
1848
Les deux faits majeurs du XIXe siècle à Bourbon sont l'abolition de l'esclavage et la culture à grande échelle de la canne à sucre qui est à l'origine de l'immigration indienne. Avec l'extension de la canne, "l'appel à a main-d'œuvre étrangère va être pratiqué sur une telle échelle qu'il va drainer en quinze ans à titre définitif 68 000 nouveaux venus dans l'île, peuplée en 1850 de 103 000 habitants". "L'île qui était passée de 1 500 habitants en 1711 à 46 000 en 1788 en raison, principalement, de l'introduction de 35 000 esclaves (DR p. 143) va "artificiellement augmenter, en quinze ans [...] de 66 %" (DR p. 156).
De même que la Compagnie des Indes a organisé la traite des esclaves pour l'exploitation du café, les grands planteurs, nouveaux "seigneurs de l'île", vont organiser l'immigration massive d'engagés pour exploiter la canne.
Sur les 60 000 esclaves libérés, 40 000 ne s'engagent pas...
20 000 PB descendants d'Européens sont marginalisés d'où : importation de 60 000 Indiens.
La différence raciale, ethnique ou sociale est indice et une justification d'asservissement.
servage, esclavage, engagisme, colonat...
Servitude des terres, servitude des habitants, poly-dépendance / emprise / subordination,
accaparement des biens par les officiers de la compagnie (et quelques premiers habitants) ;
endettement générique et morcellement des héritages...
Defos du Rau, 72 % des propriétaires occupent 7 % du sol et 2,1 % occupent 60 % du sol (chiffres de 1952-53)
Après le café...
"Le "café Bourbon" évoque encore de nos jours les fastes et les grâces de la vie créole du XVIIIe siècle. Il règne sans conteste sur les places de commerce européennes jusque vers 1750, et jusqu'à la fin du siècle apporte l'aisance aux "habitants" … il fait de la petite île le symbole d'une civilisation". (DR p. 142)
Avec le peuplement de Saint-Joseph, la boucle est bouclée : ce sont des familles blanches misérables... Entre deux recensements, 1735 et 1779, ce mouvement de paupérisation s'est affirmé.
La prospérité de la fin de l'A. Régime...
"Il est évident que les 80 % des habitants qui étaient établis sur les 9,6 % des terres, toute cette quantité de petits planteurs [...] qui végétaient déjà difficilement avec un ou deux esclaves, ne pouvaient plus vivre de leurs terres du jour où leur faudrait partager avec des colons ou payer des "engagés"' (DR p. 155).
En regard la citation du Père Caulier R. Vailland p. 117...
"Dès 1815, La Réunion possède une sucrerie et exporte 21 tonnes de sucre ; en 1860, la canne à sucre y occupe 62 000 hectares (70 % des terres cultivées), alimentant 116 usines, qui fournissent à l'exportation 68 469 tonnes de sucre. Comment expliquer ce prodigieux effort ? " (Hisnard, p. 105)
"Toujours en quête d'une culture spéculative, qui leur permettrait de réaliser rapidement une fortune suffisante pour rentrer en France, les grands colons réunionnais se lancèrent dans les plantations de canne à sucre, avec d'autant plus d'ardeur que les cyclones, celui de 1806 en particulier, avaient ravagé leurs cafèteries. La pénurie de main-d'œuvre résultant de l'abolition de l'esclavage ralentit un temps les plantations; mais celles-ci reprirent de plus belle, lorsque le décret du 25 mai 1852 eut octroyé au sucre réunionnais la détaxe de distance : la superficie consacrée à la canne doubla en quatre ans, passant de 27 000 hectares en 1851 à 56 000 en 1855. Elle couvrait les plaines côtières et s'élevait sur les premières pentes jusqu'à six cents mètres d'altitude. Les usines se multiplièrent le long de la route qui, depuis 1829, reliait les communes du littoral. Ce fut l'âge d'or de la colonie." (Hisnard, p. 105)
"Les hommes sont exclusivement occupés de s'enrichir le plus possible. Le sucre est leur veau d'or, et tout ce qui ne s'y rapporte pas n'a pas de prix pour eux." (Louis Simonin en 1860)
"... pour enrayer la hausse des salaires, les colons recoururent à l'immigration [...] En 1860, sur un total de près de 200 000 individus, l'île comptait plus de 64 000 immigrants." (Hisnard, p. 106)
Paludisme : par des coolies de Calcutta ± 1867 = abandonner les plaines inhospitalières pour les Hauts...
[(avec une opposition entre les Hauts et les Bas que l'éradiction du paludisme – je connais une grand-mère de Salazie qui ne voulait pas descendre à Saint-Denis pour ne pas attraper le "palu" – et la mode des plages introduite par les zoreils a aujourd'hui complètement inversée) : "Ah ! mon cher, s'écria-t-il, autant les gens du littoral vous attristent en pleurant fièvre et pauvreté comme des Malabares, autant cette souche de petits blancs des hauts vous fouette le cœur !...]
Parlant des "petits-blancs", Hisnard rapporte que "le poids moyen des conscrits y atteignait 50 kilos en 1949.
"L'immigration est un mal qui réduit les créoles à la misère dans les Hauts" (Defos du Rau, p. 193)
Accroissement des domaines de plus de 100 ha en 1848... (Defos du Rau, p. 192)
Les expropriations commencent en 1862. Le Crédit Foncier Colonial se retrouve presque immédiatement à la tête de 10 000 hectares... (B. 167).
"Les sucreries n'achètent pas les cannes qu'elles travaillent : elles répartissent entre leurs clients au prorata de leurs apports, les deux tiers du montant de la vente du sucre obtenu et gardent l'autre tiers en paiement de la fabrication." (H. p. 111)
"L'abolition de l'esclavage et l'entrée en scène du capitalisme industriel à la fin du XIXe siècle ont modifié les conditions de la production sucrière" :
à côté des "Planteurs" se sont constitués les domaines des sucreries : en 1948, 12 d'entre elles produisaient 31 % du total soit le tiers de la surface des terres.
Les usiniers exploitent directement les 3/5 de leur domaine.
La "faisance valoir directe" petites propriétés entre qq ares et un 10ne d'h. Sur tout le reste colonat partiaire : les exploitations sucrières à la Réunion = "de grands latifundia en colonage". (113)
Le leitmotiv concernant les Petits-Blancs : le travail et l'état de nature :
"De tous les habitants de l'île, ceux de Saint-Joseph sont les plus rapprochés de ce que nous sommes convenus d'appeler l'état de nature ; les missionnaires qui les vont visitern car il y a long-temps qu'ils n'ont eu de curé, les missionnaires se scandalisent de l'innocence de ces bonnes gens, à qui les formalités civiles et religieuses ne semblent pas d'une grande nécessité." (Billiard, p. 149)
"Il faut avant tout songer à détruire les mœurs actuelles des petits créoles, et à déraciner cette malheureuse prétention qui leur représente le travail comme le partage exclusif des esclaves." (Delsauses de Freycinet, gouverneur de 1821 à 1826, Bourquin, p. 50)
Cp des paysans français et des PB :
"Les premiers ne sauraient se dispenser de travailler, et le travail détourne du penchant au désordre. Les autres abhorrent toute occupation capable de les tenir assujettis, et vivent dans une oisiveté presque absolue." (Freycinet, B. p. 71)
Nudité ou haillons (l'esclave est vêtu), pêche et cueillette, ils "ont suivi le gibier" dans les Hauts (rapport d'une tournée faite en octobre 1832).
Thomas p. 323 :
"... la position d'une grande partie de la population blanche à Bourbon, celle notamment que l'on appelle dans l'île les petits créoles. Pour la plupart d'entre eux, comme je l'ai fait remarquer, leurs propriétés, à force de divisions, ne produisent plus une quantité de denrées suffisante à la nourriture de la famille. Repoussant le travail comme ravalant la dignité de leur couleur, repoussant le travail à gages comme humiliant, réduits aux faibles ressources de la chasse et de la pêche, ils n'ont plus le moyen de se procurer, par la culture de la petite bande de terre dont ils peuvent être encore propriétaires souvent indivis, le maïs, cette substance qui fait la base de leur nourriture. Il est donc extrêmement important de chercher à diminuer dans l'île le nombre de ces prolétaires, et de leur procurer des établissemens au dehors" (323-324).
De ces anecdotes qui n'ont pas besoin d'être vraies pour être authentiques, tant elles contractent la vérité et la finalité des stéréotypes /
"Et cependant tel est le ridicule orgueil de cette espèce d'hommes, que l'un d'entre eux, et ceci est un fait connu de toute la colonie, étant allé chez une respectable propriétaire [...] afin d'en solliciter le secours, et ayant reçu un sac de maïs, lui demanda encore, avec une assurance que je n'ose caractériser, de lui prêter un noir pour le porter ! Son état de misère avait pu le forcer à réclamer cette aumône d'une femme, blanche comme lui ; mais sa vanité ne lui permettait pas de se charger lui-même de ce fardeau, en présence des esclaves de l'habitation" (p. 324).
Roger Vailland, de passage à Marla :
M. et Mme Paul, nés en 1884 et 1887 : "en deux générations, les techniques de la civilisation européenne ont été oubliées ; ils vivent du piégeage, de la cueillette et de l'élevage le plus sommaire [...] Ils n'ont gardé que les manières, mais ce qu'il y a de plus exquis dans les manières, l'effort pour rendre la maison plaisante à l'hôte, la nappe sur la table et les fleurs sur la nappe." (p. 132-133).
Roger Vailland (La Réunion, éd. Rencontres 1964, Kailash Éditions, 1998)
"Pour l'amant de l'Histoire, la Réunion est un lieu privilégié.
Tout est rassemblé là dans une île, isola, parfaitement isolée :
le passé le plus éloigné encore présent
et le présent déjà en train de se décomposer dans un avenir de peu d'espoir."
Roger Vailland en 1958
([1964] 1998, p. 67)
Question : que se passe-t-il dans cette île ? Un concentré de l'aventure humaine selon la loi du quatrième ordre (celui qui est régi par le diable...) Esclavage, engagisme, prolétarisation, exclusion, misère physiologique... Les outils qui servent à fabriquer la richesse de quelques-uns, sous-produits d'une évolution économique qui commande tout le reste, sont les épaves du progrès.
"Dieu a ordonné trois genres d'hommes, les paysans et autres travailleurs pour assurer la subsistance des autres, les chevaliers pour les défendre, les clercs pour les gouverner, mais le diable en a ordonné un quatrième, les usuriers. Ils ne participent pas au travail des hommes et ils ne seront pas châtiés avec les hommes mais avec les démons" (The "Exempla" or Illustrative Stories from the "Sermones vulgares" of Jacques de Vitry, Londres, [1890], 1967, n° 59, 14, cité par Le Goff, p. 60-61, nous soulignons). En réalité, ce gain sans travail et sans sueur (labor, sudor, dolor…) est aussi anachronique qu'illégitime après la révolution néolithique. C'est une caricature du Paradis, de l'innocence avant la Chute, quand la cueillette assurait sans effort la subsistance d'Adam, un antimonde diabolique qui contredit l'œuvre de Dieu et l'histoire de l'homme – et dont l'empire serait en capacité d'inverser, puis de maîtriser le temps.
"Ils ne peuvent donc faire venir d'outre-mer que les nourritures les moins coûteuses : la morue de Terre-Neuve ou le riz de la Thaïlande ou de la Birmanie. Ils ne mangent rien d'autre tout au long de l'année. La morue, au demeurant, est un luxe qui n'est pas permis tous les jours de la semaine. Comme le riz manque de goût et comme le goût de la morue manque de variété [...] ils sèment en bordure des plantations de cannes toutes sortes de piment très fort avec lesqueles ils préparent diverses variétés de sauces appelées "rougail" ; c'est ce qu'on appelle la cuisine locale dont on vante le charme aux étrangers." (RV p. 81)
Histoire de Saint-Leu, par le marquis de Chateauvieux, 1865.
"Les habitants acceptèrent avec résignation la position qui leur était faite. Les esclaves quittèrent presque tous leurs anciens maîtres, mais plusieurs les remercièrent des soins qui leur avaient été prodigués. Ils cherchèrent à se réunir par familles et le premier usage qu'ils firent de leur liberté fut de rechercher les conditions de bien-être qu'ils ambitionnaient.Pour obéir à la loi, ils durent contracter des engagements et ils cherchèrent les conditions qui leur offraient le travail le moins pénible et surtout le moins assujettissant. Ils désertèrent les grands ateliers et se répandirent sur les propriétés où un sol médiocre avait été laissé sans culture. Ils prenaient des fermages à moitié de revenus... Mais ce qu'ils ambitionnaient avant tout c'était d'avoir un lieu pour y établir une demeure, y élever des animaux domestiques et y vivre en famille, sans se préoccuper de l'avenir ni souvent même d'assurer leur subsistance par des cultures bien entretenues." (p. 16-17)
Les sources de la dépendance…
Continuité entre le servage (du fief colonial),
le colonat partiaire,
l'engagisme,
l'esclavage…
Les discriminations sociales, le système servile se prolongeant par des formes d'asservissement connues sous les termes d'engagisme, de "coolie trade", de colonat partiaire.
Un employé de la Compagnie, originaire de Bourgogne, chargé de liquider les biens de la Compagnie à Bourbon, épouse en 1742 la fille d'un forban anglais ayant lui-même épousé une fille de "Panon l'Europe", l'un des plus riches colons de l'île durant la première moitié du XVIIIe siècle. Ce mariage lui apporte en dot quatre esclaves, 400 piastres de rente, des meubles et un terrain d'habitation de 12,5 h. au quartier Sainte-Suzanne. C'est le fondateur de la "dynastie" Bellier dont le nom sera associé à Bois-Rouge.
Les bases du sous-développement furent par la suite constamment reproduites. Esclavagisme, engagisme, colonage ont ceci en commun que la rémunération du travailleur est extrêmement basse, versée en grande partie en nature, limitant la demande solvable. (339)
« Spécialité législative » à La Réunion et Code Napoléon à Maurice…
Discussion :
Le Code Napoléon à Maurice voir Jean Mas…
Une paysannerie ne peut se développer à partir de la décomposition de l'EP.
Un ménage sur deux a été candidat au RMI.
Un RMIste sur deux est un rural.
3 niveaux explicatifs :_- l'âge à la déportation,_- l'absence de toute possibilité de résistance culturelle (dif. des Indiens), la résignation chrétienne, la provenance d'une société homogène (et non stratifiée)._Ce type d'évaluation est pratiquement impossible (jgt de valeur). Mais il existe un certain nombre de paramètres objectifs : dans la cp avec le destin de la communauté indienne.
I = libres (immigrants "volontaires") préservent leur culture, leur cohésion familiale = stratégies collectives. Ce sont des "paysans"... le dharma (contre la résignation).
- La situation de la communauté indienne est plus proche d'une diaspora et non une déportation sélective fonctionnelle (âge, force de travail), investissement économique (mécanique) cp l'âge moyen de l'esclave et l'âge moyen de l'engagé ;
- la perspective de retour (engagé)
Le chef du service de l'immigration en 1893 :
"La population immigrante indienne [...] n'est plus guère sollicitée pour le rapatriement, elle a le goût de la propriété foncière et s'élève graduellement au-dessus de la classe correspondante créole qui ne peut rien produire et ne sait rien prévoir."
Il regrette qu'on n'ait pas cherché depuis longtemps à "l'attacher au sol par le catholicisme qui seul pouvait le moraliser et le retenir sur nos établissements agricoles." (extrait du rapport de M. Malcor, protecteur des immigrants, 1893, Pr, p. 259)
À la Réunion, comme à la Guadeloupe, les Indiens acquièrent de la terre.
L'exploitation des colons
Les récriminations des habitants à propos de la monnaie..._
voir texte sur cet ordi : esclave_droit et Colonat.docx
___________________________________________________________________________
Paupérisation mais pas prolétarisation : l'existence du système esclavagiste empêche l'intégration du pt blanc comme salarié dans la plantation (c'est l'explication reçue...)
Là où il y a eut, brièvement, coexistence :
- le moindre coût de l'esclave ;
- un investissement à long terme et a priori plus malléable…
- absence de salariat ; comment rétribuer le petit colon ruiné et pour quoi faire ?
- absence d'argent en théorie inutile dans l'île sauf pout rétribuer les employés de la Cie.
(Lougnon p. 223 « En principe, la vente des marchandises doit s'effectuer contre remise des produits du cru. L'argent est donc inutile sauf pour payer la solde des employés, des militaires et des ouvriers, et aussi, il faut en convenir, les quantités de denrées dont la valeur dépasserait celle des besoins des producteurs en marchandises et en esclaves de traite ».)
- seul le métayage-colonat répond aux conditions socio-éco…
Les microfundias en colonage partiaire ?
a constitué le moyen grâce auquel le propriétaire peut assurer l'alimentation des sucreries en canne. Les "avances", le colon ne possédant aucun capital, accordées au début de chaque campagne, permettent la mise en culture. La récolte : 2/3 pour le colon, 1/3 pour le propriétaire. (cp la "cinquette"...)_Avec l'engagisme le coût du travail est fixe ; avec le colonat, la charge de reproduction de la force de travail est assumée par le seul colon (pas de salaire en nature : riz, poisson séché, logement...) et celui-ci supporte une éventuelle baisse des cours (les fluctuations sont partagées). (Pour le géranium, le colon doit distiller...) (on revient à l'exploitation de l'habitant comme aux premiers temps...)
Après l'abolition, la classe des colons partiaires augmenta par l'addition d'esclaves affranchis n'entretenant aucune relation avec l'économie sucrière. A partir de 1882, les nouveaux colons sont d'anciens engagés indiens, ils cultivent la canne et fournissent de la main-d'œuvre d'appoint pour les exploitations en faire-valoir direct. (36)
La coexistence de latifundia et de microfundia : monoculture extensive, fuite de revenus, augmentation des coûts de production, sous-emploi, analphabétisme, bas niveau de vie. (- cit.)
Selon Mas 15 000 colons à la Réunion (1971).
La prolétarisation des Petits Blancs dès la fin du XVIIIe, leur refus d'assurer les tâches jugées serviles, les conduit à s'installer dans les Hauts sur les terres inexploitées. A ce premier contingent s'ajoute la pression des émancipés de 1848. (Mas 265)
Le colonat sert aussi à l'époque à esquiver le contrat de travail réglementé : le contrat d'engagement des immigrés indiens. L'essor de la canne pousse le propriétaire à l'établissement d'un contrat, fût-il verbal, qui empêche la prescription trentenaire tout en lui assurant un revenu sur des terres marginales (de Chateauvieux…
Après l'abolition de 1848, la moitié des esclaves libérés se dérobèrent au contrat d'engagement qu'ils étaient incités à signer. Acteur de cette époque, de Châteauvieux écrit : “Ils désertèrent les grands ateliers et se répandirent sur les grandes propriétés où un sol médiocre avait été laissé sans culture. Ils prenaient des fermages a moitié de revenus... Mais ce qu'ils ambitionnaient avant tout c'était d'avoir un lieu pour y établir une demeure, y élever des animaux domestiques et y vivre en famille, sans se préoccuper de l'avenir ni souvent même d'assurer leur subsistance par des cultures bien entretenues.”)
"...en respectant l'esprit d'indépendance créole."
L'abolition du colonat partiaire_CLICANOO.COM | Publié le 29 octobre 2007_Considéré par les syndicats agricoles comme une réminiscence de l'organisation sociale de l'esclavage, aboli depuis plus d'un siècle et demi, le colonat partiaire a perduré jusqu'il n'y a guère plus d'un an.__Il y a tout juste un an, fin novembre 2005. Le public apprend par voie de presse que, lors d'un débat sur l'orientation agricole, le Parlement a - à la demande de la Chambre d'agriculture - adopté un amendement qui modifie le code rural et vise à abolir le bail à colonat partiaire à la Réunion. Le nouveau texte de loi interdit l'installation de nouveaux colons. Et prévoit, si le renouvellement est demandé, à l'expiration des contrats en cours, la reconversion en bail à ferme. Ce qui signifie que le colon pourrait, en accord avec le propriétaire, continuer à obtenir la direction générale de l'exploitation à titre de fermier, et ce en échange d'un loyer fixe annuel versé à ce dernier. Pour résumer, le versement d'un fermage annuel (donc fixe) se substitue à l'ancienne rémunération en parts de fruits (variable, puisque proportionnelle à chaque récolte). La profession agricole applaudit d'une part “cette démarche visant à supprimer cette réminiscence de l'esclavagisme”, qui concerne 800 agriculteurs dans l'île, et d'autre part “cette grande victoire qui permettra aux centaines d'agriculteurs concernés de retrouver leur dignité”, lisons-nous dans la presse.
___________________________________________________________________________
Points :
La population considérée comme non sédentaire s'accroit après 1848 : de 12 % de la population totale en 1849, elle passe à 33 % en 1856. INSEE
Concentration agraire au profit des habitations sucrières dont la taille s'accroît. Appauvrissement des petits propriétaires ne possédant pas le capital suffisant pour la reconversion vers le sucre. De nouvelles terres sont gagnées sur la forêt._Remembrement au profit du sucre et mise en culture de terres impropres à la canne.
La surface consacrée au café diminue de moitié entre 43 et 53. La surface cultivée se maintient autour de 61 000 hectares. Ellle régresse légèrement en 1847 et augmente régulièrement pour atteindre 69 000 hectares en 1853.
En 1847, le sucre constitue en valeur près de 80 % des exportations.
Parmi les importations, la morue de Terre-Neuve pour 300 à 1000 tonnes par an (moins qu'en Guadeloupe). Importation de viande salée et plus grand nombre de porcs.
Caractéristique : une société duale, sans classe moyenne.
L'EP engendre une pauvreté fonctionnelle de ses bras et une pauvreté marginale de ses exclus (qui n'entrent pas dans le circuit de la production) : les descendants des esclaves, les descendants des petits blancs...
L'absence d'argent, équivalent universel de ce qui peut être consommé,
Dans le colonat, le propriétaire est au départ et à l'arrivée, à la semence et à la récolte.
Le paiement en nature, aggrave la dépendance économique par la dépendance géographique et humaine, paternalisme, clientélisme…
Le magasin, s'il n'est plus le « magasin du Roy » peut être celui du propriétaire.
A la Réunion, le commerce, abandonné par les propriétaires (qui ne résident pas) va être essentiellement tenu par des allocthones, « Chinois », « Zarabs ». Au moment de la départementalisation, ils seront à la réception de l'investissement national à la R. et les principaux bénéficiaires locaux de la défiscalisation…
Jean Albany
Et la cour de prison : le pénitencier de la rue du Dragon…
Jean Albany
(1917-1984)
Albany ou Le retour au pays natal
a écrit :
Outremer : retour au pays natal (1966)
Fare fare ou le retour aux isles (1978)
Un poète de l'exil...
“Il n'était pas question d'écrire en créole” dans un entretien au Quotidien du ...1978
Albnay vit un exil parisien. Il nous reçoit “sous les toits”
Un auteur qui se définit
“sans amour et sans politique, plus voué que jamais à l'art et à la poésie” (cit. M.) V. p. 15.
Vavangue, 1972
Le grondement de la mer (...) ce chant qui fut l'essence de ma nostalgie, je l'entends, et, les yeux fermés, dans mon sommeil d'enfant, cet enfant retrouvé, cet enfant prodigue, je l'aurai, à moi seul, pour me bercer. (5)
enfant retrouvé = enfance retrouvée
enfant prodigue = enfant qui fait retour à la maison paternelle : à la langue maternelle.
Cette odeur de corail et de paradis (...) joie de vivre et de vacances : la vavangue. (5)
Oui j'ai retrouvé mon île merveilleuse, je suis redevenu l'enfant dont le sommeil sera ce galet, tourné et retourné par la vague tiède et de tendresse. (5)
...je vis (...) ce qui est incompréhensible pour mon esprit mais ne l'est pas pour mon corps. (6)
...ce voisinage des maisons de Paris, si déplaisant, et jamais accepté
le “pénitencier” de la Cour du Dragon. (6)
Ce printemps à Paris, préparant les fiches de mon glossaire (...) je me suis débattu parmi mes souvenirs d'enfance, cherchant par exemple à définir le cadoque (...) Je découvre, de plus en plus, la difficulté, mais quelle joie dans la réussite de décrire un fruit ou une fleur.
En fait, ils sont si rares ces fruits de notre enfance (...) que seul leur souvenir peut me permettre de les décrire par petites touches mais avec quelle tendresse !
“Fait' attention ! chaudrons !” (11) Je souris (...) à ce mot de mon enfance, venu tout à coup me piquer au talon d'Achille : chaudron ! Que de fois, en des calanques d'Espagne ou de Grèce (...) j'en ai vu des champs d'oursins - mes yeux voyaient oursins, mon cœur disait chaudrons.
l'oeil du cœur, le sentiment et la perception.
Après le temps de la morue salée, arrive celui du poison congelé. (13)
La morue "cet aliment forcé du pauvre" (L'Ami de la vérité, n° 3, 21 octobre 1865)...
Solde…
La cie assume une véritable aide économique (pour l'île de France, le système a été précisé dans une lettre de la Cie du 31 décembre 1727 : Correspondance, T I p. 59).
Les relations de la compagnie et de ses "employés" sont de nature féodale… Pas de "classe moyenne", ce sont les administrateurs qui s'enrichissent (voir dans JM les plus gros producteurs de café). La relation de dépendance : l'exclusif : tout doit passer par la cie qui achète les produits et vend le matériel._ Endetttement des colons vis-à-vis de la cie. Les "vieux habitants" ont pu s'enrichir ; les nouveaux venus à qui il faut faire des avances pendant les quatre premières années (pas d'habitation à moins de 12 noirs).
Le statut juridique de Bourbon (Mas 247)
[Cp le domaine de Kerveguen qui crée sa propre monnaie. Une relation de dépendance cp à celle qui était celle des habitants endettés. La pratique du carnet : quand on a fait la soustraction des achats, reste-t-il un sou vaillant ?]
"Les concessions consenties sous la régie de la Cie des Indes portent toutes mention de la réserve de cens ou redevance." (voir 2 ex. en annexe) (Mas 259) Le gouverneur doit en assurer la recette (instruction à Desforges-Boucher du 10 novembre 1717; ADR…)
----------------------------------------------------------------
A voir :
La production des colonies ne doit pas doubler celle de métropole. La colonie doit absorber le surplus de la production métropolitaine. Les produits de l'Inde : liste limitative de produits dont l'achat était toléré, spécialement les tissus. Mais vendus à 150 % alors que les marchandises d'Europe sont soumises au taux de 100 %._Les échanges avec la métropole s'ils se règlent bien en livres, monnaie de compte, ne doivent provoquer la sortie du royaume d'aucun métal précieux. (Mas ? p. 191-192 : non)_Concernant le commerce. Le monopole est réaffirmé. Cette position est rappelée dans un règlement du 10 janvier 1709. "Les colons peuvent trafiquer entre eux des denrées et des marchandises du cru, mais il leur est interdit de rien vendre aux navires de passage, français ou étrangers de ce qui excède leur consommation. Ils doivent le porter au magasin de la Cie où on leur délivrera en échange des marchandises des manufactures de France." (97-98) "Certaine que la mise en valeur de l'île lui procurerait désormais des retours avantageux, la Cie invitait Desforges-Boucher à dresser un état des effets nécessaires à la consommation des habitants pour qu'elle pût y pourvoir. (98)
|
|
|